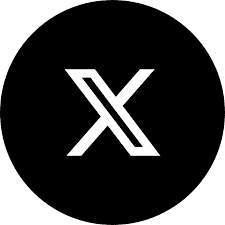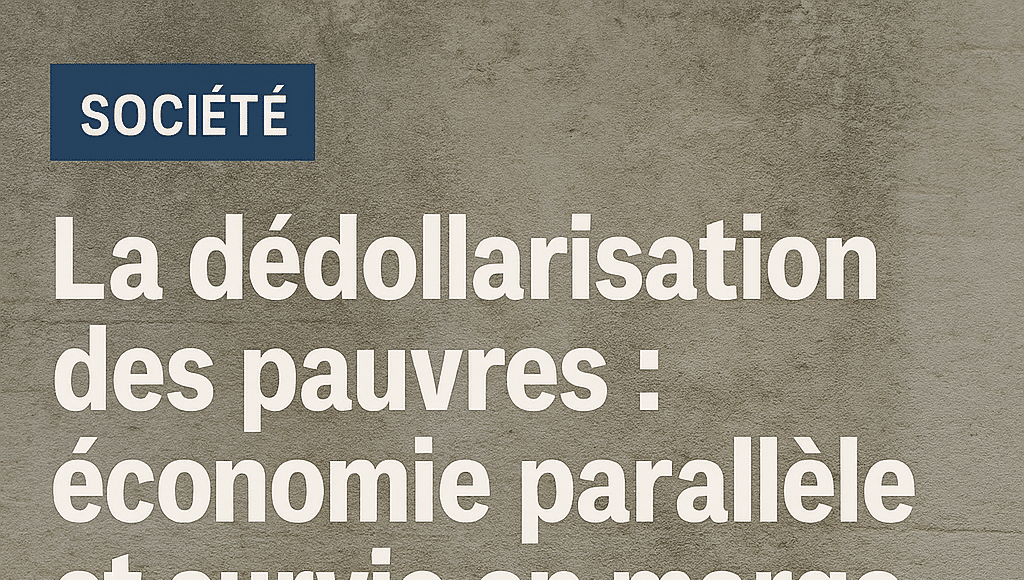Une économie sans banques, sans loi et sans devises
Dans les quartiers populaires de Beyrouth, Tripoli ou Saïda, l’infrastructure bancaire ne répond plus à la demande des plus modestes. Les guichets fermés, les distributeurs souvent vides, et la fermeture progressive de nombreuses agences dans les zones non rentables ont totalement marginalisé des dizaines de milliers de foyers libanais. Aujourd’hui, pour les classes populaires, l’économie se déroule presque exclusivement hors des circuits financiers officiels.
Depuis le déclenchement de la crise financière en 2019, et la défaillance persistante du système bancaire, les familles dont les revenus sont en livres libanaises ou qui vivent d’activités informelles opèrent intégralement en cash. Les dollars leur sont inaccessibles, sauf via des transferts de proches expatriés. Le taux de change officiel reste figé à 89 500 LBP/USD, tandis que le taux parallèle dépasse désormais 100 000 LBP/USD, selon les indicateurs informels cités dans la presse du 20 août 2025. Mais pour beaucoup, ces chiffres sont abstraits : leurs transactions se font en livres uniquement, souvent sur la base de taux variables d’un quartier à l’autre, fixés arbitrairement par les commerçants ou les transporteurs.
Livres contre dollars : fracture monétaire, fracture sociale
La dédollarisation vécue par les couches populaires n’est pas un choix de politique économique, mais une conséquence de leur éviction des réseaux monétaires mixtes. À Beyrouth, selon les données issues des témoignages de commerçants, plus de 60 % des transactions dans les quartiers défavorisés se font en livres uniquement, souvent à crédit. Dans certaines zones du Akkar et de la Békaa, ce chiffre dépasse les 80 %.
Suivez les principaux indicateurs économiques en temps réel.
Un enseignant contractuel du secteur public touche en moyenne 10 à 15 millions de livres libanaises par mois, soit entre 100 et 130 dollars selon le taux parallèle. Ce salaire ne suffit ni à couvrir un loyer — qui atteint 300 à 400 USDmensuels dans les villes — ni à payer les frais scolaires ou médicaux, souvent exigés en devises. Les retraités de la fonction publique, dont la pension mensuelle tourne autour de 6 à 8 millions de livres, sont encore plus exposés.
Les consommateurs paient le bundle de pain jusqu’à 50 000 LBP, une bouteille de gaz autour de 1 million LBP, et un kilowatt d’électricité privée jusqu’à 25 000 LBP, contre un revenu mensuel médian largement inférieur à ce seuil de dépenses. L’accès au dollar, utilisé dans les grandes surfaces, les pharmacies et pour les produits importés, leur est tout simplement impossible.
Une économie parallèle structurée par la nécessité
Face à cette exclusion monétaire, des systèmes alternatifs se sont généralisés. Dans de nombreuses régions, les achats à crédit sont redevenus la norme. Les “carnets de dettes” sont utilisés dans plus de 50 % des épiceries et commerces de proximité dans les quartiers de Tripoli, Bourj Hammoud, Hay el Sellom et Nabatiyeh. Les ménages y inscrivent leurs achats quotidiens — pain, légumes, essence, médicaments — qu’ils remboursent lorsque leurs revenus deviennent disponibles.
Les transferts de la diaspora, qui se font massivement via des canaux informels comme OMT ou Western Union, représentent souvent la seule entrée de devises pour ces familles. Ces transferts sont retirés immédiatement en cash, dépensés dans des circuits de survie, et ne passent jamais par le système bancaire. Le montant moyen des transferts familiaux, selon des chiffres cités en 2024, oscille autour de 150 à 200 USD par mois, une somme vitale mais instable.
Le troc se développe également dans les zones rurales et semi-rurales. À la périphérie de Zahlé ou dans le Sud, des échanges de biens et services remplacent la monnaie : réparations contre légumes, garde d’enfants contre transport, soutien scolaire contre produits ménagers. Ces micro-accords sont souvent encadrés par les associations locales ou religieuses.
Les banques : absentes ou hostiles
Pour les classes populaires, les banques n’inspirent ni confiance ni utilité. Le retrait maximum autorisé pour les comptes en “lollars” est souvent plafonné à 100 ou 200 USD par mois, à des taux de conversion allant de 15 000 à 30 000 LBP/USD, bien inférieurs à ceux du marché parallèle. Les dépôts sont gelés depuis 2019. Les recours judiciaires sont rares, coûteux, et sans résultat concret à ce jour. Aucune banque n’a repris une activité de crédit au profit des ménages à revenus faibles.
La Banque du Liban n’a diffusé aucune directive spécifique sur la bancarisation des catégories défavorisées. Aucune mesure n’a été prise pour rétablir des comptes à faibles frais, promouvoir la micro-épargne, ou encadrer les pratiques des institutions de transfert. Le secteur bancaire, déjà largement délégitimé, a fermé ses agences dans les zones les plus pauvres et concentre ses ressources sur les transactions en devises et les clients solvables.
Un filet social absent, une informalité institutionnalisée
Le programme Aman, censé assurer un minimum de protection sociale aux plus démunis, est en suspension depuis plusieurs mois, selon les publications du 20 août 2025. Les aides directes du gouvernement sont irrégulières, en livres, et ne couvrent qu’une faible proportion de la population. En l’absence de coordination avec les ONG ou les institutions internationales, les mécanismes de soutien ont glissé vers l’informel.
Le Liban n’a pas adopté de politique de “cash assistance” à grande échelle. Les tentatives de subvention ciblée sont épisodiques et inefficaces. Dans ce vide, les mosquées, églises, comités de quartier et diasporas se substituent à l’État, dans un système d’aide fragmenté et souvent politisé.