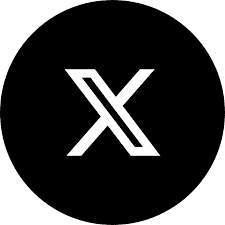Le chantier de l’extension de l’aéroport international de Beyrouth, présenté comme l’un des rares projets structurants du pays ces dernières années, est désormais suspendu pour une durée indéterminée. Ce gel illustre l’incapacité de l’État libanais à mener à terme ses projets d’infrastructure, même lorsqu’ils bénéficient de financements extérieurs et d’un consensus sur leur nécessité.
Les raisons officielles avancées pour expliquer cette interruption sont multiples. D’une part, des litiges persistants entre le ministère des Travaux publics et la Direction générale de l’aviation civile ont bloqué le processus de validation de l’appel d’offres. Les divergences portent sur la nature des contrôles budgétaires, les critères d’attribution du marché et les modalités de supervision technique. D’autre part, les partenaires financiers étrangers impliqués dans le financement du projet ont exigé des garanties accrues quant à la transparence du processus d’exécution.
Ces exigences ne sont pas nouvelles, mais elles prennent un relief particulier dans un pays dont les institutions de contrôle sont perçues comme faibles, voire captives des équilibres politiques. Les bailleurs de fonds, échaudés par des précédents, exigent désormais des mécanismes de vérification indépendants, une traçabilité complète des fonds alloués et la certification des appels d’offres par des instances externes. En l’absence de réponse satisfaisante, ils ont suspendu leur participation, ce qui a mécaniquement entraîné le gel du projet.
Comparez rapidement les prix des vols avec Fly2Leb.
Le terminal 2, qui devait voir le jour dans le cadre de ce programme, était censé absorber une partie du trafic croissant de l’aéroport, particulièrement en période estivale. Sa réalisation aurait permis la création de 1 200 emplois directs et indirects, dans un pays frappé par un chômage endémique et un exode massif des jeunes diplômés. Sa suspension signifie non seulement une perte d’opportunité économique, mais aussi un signal négatif envoyé aux investisseurs internationaux.
L’impact immédiat se fait sentir sur l’organisation aéroportuaire actuelle. Déjà surchargé, le terminal existant ne permet pas d’assurer un service fluide aux passagers. Les plaintes s’accumulent concernant les retards, les pannes de climatisation, et la gestion des flux de voyageurs. En pleine saison de départs estivaux, cette désorganisation génère une frustration supplémentaire pour une population déjà éprouvée par les défaillances de l’État.
Transports publics paralysés : la ville sous l’emprise de l’informel
La situation des transports collectifs à Beyrouth reflète une autre facette de la déliquescence des services publics. Le projet de remise en service du réseau de bus publics, pourtant relancé avec insistance depuis 2022, est à l’arrêt. Prévu pour être opérationnel dès le début de l’année 2025, il est aujourd’hui bloqué à un stade préliminaire en raison d’un conflit administratif sur la maîtrise d’ouvrage. Le ministère des Transports et la direction générale de l’Établissement des transports ferroviaires et routiers publics se disputent la tutelle du projet, retardant ainsi tous les jalons techniques et budgétaires.
La réhabilitation des dépôts de bus, préalable indispensable à tout redémarrage du réseau, est suspendue depuis mars. Les ateliers de maintenance, censés être modernisés avec le soutien logistique de partenaires européens, restent à l’abandon. Les équipements livrés n’ont pas été installés, les équipes techniques ne sont pas mobilisées, et les contrats avec les fournisseurs locaux sont caducs. La situation crée une confusion généralisée, où chaque acteur institutionnel tente de se désengager de ses responsabilités, invoquant le flou juridique ou l’absence d’autorisation budgétaire.
En l’absence de réseau structuré, le vide est comblé par le secteur informel. Selon les estimations, 78 % des trajets urbains à Beyrouth sont désormais effectués via des modes de transport non officiels : taxis collectifs, minibus privés, motos-taxis. Ce phénomène n’est pas nouveau, mais il a connu une accélération marquée depuis 2023. En un an, les tarifs de ces transports informels ont augmenté de 22 %, en raison de la hausse des coûts du carburant, de la dépréciation de la livre libanaise et de l’absence de subventions publiques.
Pour les usagers, cette mutation du paysage urbain est synonyme d’instabilité. Les horaires sont imprévisibles, les règles tarifaires inexistantes, et la sécurité rarement assurée. Des cas d’accidents graves impliquant des véhicules de transport non réglementés sont régulièrement signalés, sans que des mesures de régulation soient mises en œuvre. Le résultat est une perception croissante d’anarchie urbaine, où l’espace public est dominé par des acteurs privés sans encadrement.
Cette informalisation pose également un problème structurel pour les autorités. Elle échappe à toute fiscalité, ne permet aucun investissement planifié, et rend inopérante toute stratégie de transition écologique des transports. Le Liban, qui peine déjà à atteindre ses engagements environnementaux, voit s’éloigner toute perspective de politique de mobilité durable. Les projets de flottes électriques, de régulation par GPS ou de billetterie centralisée ne dépassent pas le stade de la rhétorique ministérielle.
Un appareil public fragmenté : rivalités administratives et absence de pilotage central
Au-delà des litiges ponctuels sur l’aéroport ou les bus, c’est l’ensemble de l’appareil administratif libanais qui montre des signes de fragmentation chronique. Dans le domaine des infrastructures et des services urbains, plusieurs niveaux de responsabilités se superposent sans coordination claire. Chaque ministère, direction générale ou établissement public agit selon sa propre logique, souvent sans se référer à une stratégie globale.
Les conflits de tutelle sont fréquents. Le ministère des Travaux publics se heurte à la Direction de l’aviation civile sur les projets aéroportuaires ; le ministère des Transports entre en concurrence avec l’Office des transports publics sur les dépôts de bus ; les municipalités avancent des projets de voirie sans concertation avec les plans nationaux de mobilité. Ce désordre institutionnel est renforcé par le manque de données fiables, l’absence de systèmes d’information partagés, et une culture administrative fondée sur la méfiance et la rétention d’information.
Les procédures de passation de marchés souffrent du même cloisonnement. Les appels d’offres sont rarement standardisés, souvent contestés pour manque de transparence, et rarement exécutés dans les délais. Les retards s’accumulent, les coûts augmentent, et les projets échouent à atteindre leurs objectifs. Cette désorganisation mine l’image de l’État auprès des partenaires étrangers, qui réclament de plus en plus des garanties formelles, notamment des audits indépendants et des comités de suivi pluripartites.
Le blocage administratif est aggravé par la vacance de certains postes-clés. Plusieurs directions générales sont occupées par des intérimaires ou laissées sans titulaire. Les nominations, gelées pour des raisons politiques, paralysent le fonctionnement interne. Le manque de motivation du personnel, les faibles salaires, et les conditions de travail précaires achèvent de désengager une partie de la fonction publique. Les cadres compétents sont nombreux à avoir quitté le pays ou à s’être reconvertis dans le secteur privé ou les ONG.
Cette fragmentation structurelle empêche toute planification à moyen ou long terme. Les plans directeurs, lorsqu’ils existent, sont rarement mis à jour. Les stratégies multisectorielles – mobilité, transition énergétique, développement régional – restent à l’état de projets, sans traduction budgétaire. L’État est réduit à une logique de réaction à court terme, fondée sur l’urgence et le sauvetage ponctuel, plutôt que sur l’investissement et la structuration.
Perspectives d’assainissement : réformes avortées et attentes citoyennes en suspens
Les annonces de réforme dans le secteur des services publics se succèdent depuis plus de dix ans, sans qu’aucune ne se concrétise durablement. À plusieurs reprises, les gouvernements ont présenté des plans de modernisation des infrastructures, de relance du transport collectif, de mise à niveau de l’aéroport, ou encore de digitalisation des services urbains. Mais à chaque tentative, les blocages politiques, les carences administratives et les tensions communautaires ont rendu les promesses caduques.
Dans le cas du transport public, plusieurs bailleurs de fonds avaient proposé un appui technique et financier sous condition de pilotage centralisé et d’indicateurs de performance. Ces initiatives ont échoué à cause du refus de certains acteurs politiques de céder la maîtrise d’ouvrage à des entités indépendantes. La politisation extrême de chaque projet a rendu inopérante toute tentative de planification neutre. Même les agences de coopération internationale, longtemps tolérantes, ont restreint leur engagement, préférant désormais des micro-projets sectoriels à faible visibilité.
Pour les citoyens, le constat est amer. La qualité des services continue de se dégrader dans tous les domaines – électricité, eau, transport, santé, voirie – sans perspective d’amélioration. Le rapport entre l’usager et l’État est devenu essentiellement conflictuel. Les manifestations sporadiques contre la hausse des prix, les défaillances des infrastructures ou la corruption des chantiers publics révèlent un niveau de tension sociale élevé. La population ne croit plus aux annonces officielles, perçues comme des opérations de communication déconnectées du réel.
Certaines propositions émanant de la société civile visent à contourner l’appareil d’État en créant des régies locales ou des coopératives de services, notamment dans les transports ou la gestion des déchets. Ces expériences, bien que limitées, montrent une volonté de réappropriation citoyenne des fonctions publiques essentielles. Elles se heurtent cependant au manque de cadre légal, à l’opposition des structures traditionnelles, et à l’absence de relais institutionnel.
À moyen terme, seule une réforme en profondeur des règles de gouvernance pourrait inverser la tendance. Cela implique non seulement des lois, mais surtout un changement de culture administrative : reddition de comptes, accès à l’information, dépolitisation des nominations, évaluation des politiques publiques. Ces transformations, longtemps évoquées, ne pourront émerger sans une volonté politique explicite, portée par une alliance durable entre acteurs institutionnels, société civile, et partenaires internationaux.