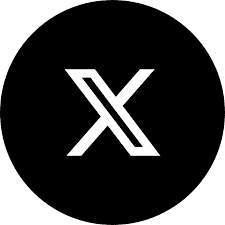L’argumentaire du Hezbollah : résistance ou rupture
Le 17 août 2025, dans une allocution retransmise à la télévision depuis la banlieue sud de Beyrouth, Naim Kassem a fixé une ligne rouge claire : « Il ne peut y avoir de discussion sur le désarmement tant que l’occupation persiste, tant que les agressions israéliennes se poursuivent, et tant que l’État ne démontre pas sa capacité à défendre la souveraineté nationale. » Cette déclaration, prononcée dans un contexte de recrudescence des attaques au sud, s’adresse aussi bien aux chancelleries occidentales qu’aux responsables libanais favorables à l’application intégrale de la résolution 1701.
Le ton de Kassem ne laisse aucune place à l’ambiguïté. Évoquant les pressions internationales et les propositions formulées par certains partis internes, il déclare : « Supprimez le terme désarmement de votre discours. C’est un mot hostile. C’est un piège. » Selon lui, il ne s’agirait pas d’un débat national mais d’un agenda imposé par les États-Unis pour neutraliser le seul levier de pression contre Israël.
Lors d’une commémoration à Tyr, Kassem a enfoncé le clou : « Il n’y aura pas de vie au Liban si vous décidez de vous opposer à nous. Ceux qui soutiennent ce projet de désarmement mettent en péril l’unité nationale. » Ces propos ont été interprétés comme une mise en garde directe à l’exécutif. Dans le même discours, il annonce que « tout plan qui tenterait de soumettre la Résistance à une autorité extérieure, qu’elle soit locale ou internationale, ne sera pas toléré. »
Suivez les principaux indicateurs économiques en temps réel.
Cette position n’est pas nouvelle, mais elle s’est radicalisée au fil des semaines. Face aux discussions sur une éventuelle reconfiguration du dispositif militaire libanais dans le Sud, Kassem oppose un refus absolu, estimant que « l’armée n’est pas encore capable de défendre seule les frontières, et qu’un retrait du Hezbollah ouvrirait la voie à une invasion. »
Le président Joseph Aoun face à l’impératif d’unité nationale
Le président de la République adopte une ligne plus institutionnelle, mais non moins ferme sur le principe de souveraineté. Lors d’un discours officiel au palais présidentiel le 16 août 2025, il affirme : « Il n’y a pas d’État sans monopole de la violence légitime. Il est de notre devoir constitutionnel d’assurer que toutes les armes soient sous le contrôle de l’État. »
Cette déclaration, prononcée devant un parterre de diplomates et d’officiers supérieurs, a été perçue comme une tentative de réaffirmer le rôle central de l’armée libanaise dans la défense nationale. Toutefois, Aoun n’ignore pas l’importance stratégique du Hezbollah dans l’équilibre militaire actuel. Ainsi, il ajoute immédiatement : « Toute réforme sécuritaire doit s’opérer dans le cadre du dialogue national. Le consensus est la condition de notre stabilité. »
En privé, selon une source proche du palais présidentiel, Aoun envisagerait un scénario progressif, dans lequel une partie des unités combattantes du Hezbollah pourrait être intégrée à l’armée, sur le modèle d’une garde nationale ou d’un corps d’élite spécialisé dans la défense du Sud. Une telle proposition nécessite toutefois l’accord du commandement militaire et l’adoption d’une loi cadre par le Parlement.
Le chef de l’État a également exprimé des réserves sur la méthode employée par certains partenaires internationaux, soulignant que « toute pression extérieure est contre-productive » et que « l’agenda du désarmement ne peut être dissocié de l’agenda de la reconstruction et du renforcement des capacités de l’État. »
Le Premier ministre Nawaf Salam et l’équilibre fragile du pouvoir
Nawaf Salam, nommé Premier ministre en février 2025, tente de maintenir une position médiane entre l’exigence internationale d’un désarmement ordonné et la réalité du rapport de force interne. Intervenant devant la commission parlementaire conjointe de la Défense et des Affaires étrangères le 15 août, il déclare : « Il ne saurait y avoir de double légitimité armée. Mais la transition vers un modèle unifié nécessite des garanties sécuritaires, diplomatiques et économiques. »
Ce propos traduit la volonté du chef du gouvernement d’inscrire le désarmement dans un cadre élargi, incluant la question des réfugiés syriens, la relance de l’économie nationale, et surtout l’obtention de garanties régionales sur la neutralité du Liban. Salam, ancien juge à la Cour internationale de Justice, entend faire valoir une approche juridique du processus, en impliquant notamment la FINUL dans un rôle de supervision élargie.
En conseil des ministres, il aurait proposé la création d’une commission mixte État-Hezbollah, placée sous l’égide du président de la République, pour discuter d’un plan d’intégration. Cette proposition, rejetée par les membres du camp chiite, n’a pas été rendue publique mais a été confirmée par deux ministres.
Salam se montre également attentif aux lignes rouges imposées par les alliés de l’Occident. Lors de sa visite à Paris début août, il a rappelé que « tout soutien financier à l’armée et aux infrastructures dépendra de l’évolution du dossier sécuritaire. » Un message que les États-Unis ont renforcé par une note diplomatique classifiée transmise à Beyrouth le 10 août.
L’implication américaine : feuille de route ou diktat ?
Depuis début juillet, Washington pousse pour l’adoption d’un plan en trois étapes : cessation immédiate des hostilités au Sud, retrait du Hezbollah au-delà du Litani, puis transfert progressif des responsabilités à l’armée. Ce schéma, inspiré du modèle irakien post-2008, est présenté comme un compromis viable. Mais à Beyrouth, il est perçu comme irréaliste.
Le Hezbollah y voit une tentative déguisée de neutralisation. Dans un message adressé aux diplomates occidentaux, Naim Kassem affirme : « Nous savons très bien que la paix que vous promettez est une capitulation. Votre désarmement est notre suicide. » Il accuse directement les États-Unis de vouloir « redessiner les équilibres internes pour servir leurs intérêts et ceux d’Israël. »
Des sources diplomatiques confirment que la proposition américaine a été présentée au gouvernement libanais lors d’une réunion confidentielle le 8 août. Le plan prévoit un calendrier de 18 mois, assorti de mesures incitatives : aide humanitaire, levée partielle des sanctions, soutien à la réforme de l’État.
Mais le président Aoun a fait savoir que « tout plan étranger ne sera retenu que s’il est conforme à l’intérêt supérieur du Liban. » Cette position de principe masque une réalité complexe : sans l’appui financier de l’Occident, la réforme militaire reste théorique. Et sans l’assentiment du Hezbollah, aucune mesure concrète ne pourra être appliquée.
Un front interne fragmenté : entre prudence et lignes rouges
Dans les rangs parlementaires, les divergences sont profondes. Le Bloc du Changement, issu du soulèvement populaire de 2019, plaide pour une solution radicale. Son président estime que « le désarmement est la condition première de toute reconstruction. » À l’opposé, le camp chiite considère cette exigence comme « une déclaration de guerre civile déguisée. »
Le président du Parlement, dans un entretien accordé à des journalistes le 18 août, appelle à « préserver la paix civile par le dialogue, et non par l’imposition. » Une formule qui reflète l’essoufflement d’un système fondé sur le compromis permanent mais incapable d’imposer des réformes structurelles.
Sur le terrain, la tension est palpable. Des unités de l’armée ont été déployées en renfort dans certaines zones du Sud, tandis que les patrouilles conjointes avec la FINUL sont renforcées. Toutefois, aucun incident majeur n’a été signalé. Les autorités évitent toute provocation, conscientes du risque d’un dérapage incontrôlé.
L’armée, dernier rempart ou acteur sous tension ?
Au sein du commandement militaire, les avis divergent. Un haut gradé confie : « L’armée est prête à prendre en charge le Sud. Mais elle n’a ni les moyens techniques, ni les marges politiques pour agir seule. » Il souligne l’importance de la coordination avec la FINUL, mais surtout la nécessité d’un consensus politique pour éviter la fragmentation du commandement.
L’armée bénéficie encore d’un capital de confiance élevé auprès de la population. Mais cette légitimité est fragile. Si elle devait apparaître comme l’instrument d’un camp contre un autre, elle perdrait son rôle d’arbitre. C’est précisément ce que redoute Joseph Aoun, qui multiplie les réunions de concertation avec les chefs des partis pour éviter une militarisation du conflit politique.