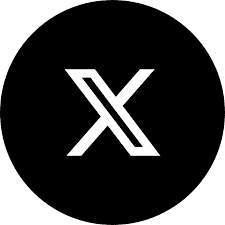Le départ du pape depuis l’aéroport international de Beyrouth, mardi, a mis fin à une parenthèse dont personne, au fond, n’ignorait le caractère précaire, mais dont chacun a immédiatement perçu les effets. Pendant quelques jours, le Liban a semblé vivre sous une forme de suspension, comme si la présence d’une autorité morale mondiale suffisait à troubler le cours ordinaire de la guerre, à en perturber le déroulement attendu, à en différer l’expression la plus visible. En ce sens, le pape a bien été un trouble-guerre : non pas celui qui attise le conflit, mais celui qui, par sa seule présence, empêche momentanément qu’il se manifeste pleinement.
Cette retenue imposée n’avait toutefois rien d’un apaisement durable. Elle ne procédait ni d’un changement stratégique ni d’une inflexion politique, mais d’un calcul évident lié à la portée symbolique de l’événement. La présence du pape rendait la guerre momentanément coûteuse en termes d’image, difficilement soutenable sous le regard international. Elle contraignait les acteurs régionaux, Israël compris, à suspendre les manifestations les plus visibles de la violence, non par renoncement, mais par opportunité. Le silence relatif observé au-dessus de Beyrouth n’était pas celui de la paix retrouvée, mais celui d’une guerre empêchée.
La fin de cette séquence n’a d’ailleurs laissé place à aucune ambiguïté. Dès le départ de l’avion pontifical, les survols de drones au-dessus de la capitale ont repris, comme un mécanisme aussitôt réactivé, réinstallant dans le ciel libanais une présence devenue familière. Ce retour quasi immédiat a dissipé toute illusion : la guerre ne s’était jamais éloignée, elle s’était simplement tenue en retrait, contenue par une présence jugée incompatible avec son déploiement. Le départ du pape a levé cet empêchement, la parenthèse était fermée, Back to Life and back to reality. Ce basculement rapide rappelle une réalité bien ancrée au Liban : la paix n’y existe jamais comme un état stable, mais comme une condition temporaire, suspendue aux regards extérieurs et aux équilibres diplomatiques du moment. Tant qu’une figure comme celle du pape occupe l’espace médiatique et symbolique, la guerre se fait discrète, différée ; dès que cet obstacle disparaît, les logiques militaires reprennent leur cours. Les bombardements persistants au Sud, y compris durant la visite, avaient déjà montré que cette retenue était partielle, sélective, limitée à ce qui pouvait heurter directement l’image.
Comparez rapidement les prix des vols avec Fly2Leb.
Dans ce cadre, le départ du pape apparaît moins comme la fin d’un événement que comme la levée d’une contrainte. Le trouble-guerre n’était pas le conflit lui-même, mais celui qui en empêchait momentanément l’expression. Une fois ce trouble guerre parti, sa présence dissipée, les témoins qui l’accompagnait, ces journalistes, le Liban a été ramené à sa position structurelle : celle d’un territoire exposé, pris dans un rapport de force où la violence n’est jamais absente, seulement parfois retardée, et où la paix demeure un état toléré, jamais garanti, dans un environnement régional dominé par des décisions qui se prennent ailleurs, notamment à Jérusalem, sous l’autorité du gouvernement de Benjamin Netanyahou.
Un pays profondément vidé depuis 2020
L’impression d’une mobilisation plus contenue que lors des visites papales précédentes n’est ni un mirage ni un signe de désaffection spirituelle. Elle renvoie à une transformation profonde, lente et désormais visible du pays, à une érosion humaine qui a précédé et accompagné l’effondrement économique. Depuis 2020, entre 700 000 et 800 000 Libanais ont quitté le territoire. Ce chiffre, désormais solidement établi dans les estimations internationales, pèse lourdement sur la lecture de tout événement à vocation populaire ou nationale. Il explique en grande partie l’atmosphère de retenue qui a entouré cette visite, non comme un recul symbolique mais comme une conséquence directe d’un pays démographiquement amputé.
Cet exode n’a pas touché toutes les catégories de manière uniforme. Il a frappé de façon disproportionnée les chrétiens, très présents dans les classes moyennes, les professions qualifiées, les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’ingénierie et des services spécialisés. Lorsque l’effondrement économique s’est installé dans la durée, ce sont ces catégories qui ont simultanément perdu leurs garanties de stabilité et disposé encore, par leurs compétences et leurs réseaux, de la possibilité de partir. Le mouvement s’est fait sans bruit, par vagues successives, laissant derrière lui des quartiers clairsemés, des paroisses vieillissantes, des écoles appauvries en familles, une société progressivement rétrécie.
À cette saignée libanaise s’ajoute une autre réalité, moins directement visible mais tout aussi lourde de sens : celle du départ massif des chrétiens de Syrie au cours de la dernière décennie. Beaucoup d’entre eux, qui entretenaient jusqu’alors des liens familiaux, ecclésiaux et culturels étroits avec le Liban, ont quitté la région dans son ensemble, affaiblissant un tissu chrétien levantin historiquement interconnecté. Cette disparition progressive des chrétiens d’Orient, du Levant dans son ensemble, renforce le sentiment d’un monde qui se vide, non seulement d’un pays mais d’un espace civilisationnel ancien, fragilisant encore davantage la portée des grands rassemblements religieux.
Le peuple libanais, pourtant, a longtemps tenu. Bien plus longtemps qu’on ne le croit depuis l’extérieur. La jeunesse a résisté, encaissant tour à tour l’effondrement du système bancaire, la disparition des économies familiales, la dévaluation continue de la monnaie, la paupérisation accélérée, les pénuries, les coupures chroniques et l’insécurité diffuse. Beaucoup ont tenté de rester, parfois au prix de concessions profondes, nourrissant l’espoir que la crise serait temporaire ou qu’un sursaut politique finirait par se produire. Le départ n’a pas été immédiat. Il s’est imposé comme une contrainte, presque comme une capitulation intime, lorsque toute perspective de stabilité et de dignité s’est refermée.
Derrière ces chiffres, il y a une réalité plus discrète, rarement mise en avant dans les images officielles : celle des mères libanaises qui pleurent. Elles pleurent des enfants partis vivre sous d’autres cieux, parfois provisoirement, souvent durablement, parfois sans certitude de retour. Ce n’est pas le deuil brutal de la mort, mais celui, plus silencieux, de l’absence prolongée, de la distance imposée, de la vie familiale éclatée. Dans ces foyers, l’appel du pape à rester, à ne pas abandonner le pays, trouve un écho réel. Il touche une corde intime, celle de l’enracinement, de la continuité, du refus de voir la terre natale devenir un simple souvenir.
Mais cette résonance n’est pas universelle. Elle ne touche pas tous les milieux de la même manière. La question demeure ouverte : cet appel, si audible dans les cœurs brisés des familles ordinaires, est-il entendu par les élites politiques et économiques ? Résonne-t-il chez ceux qui, par les mécanismes mêmes ayant conduit à la crise – corruption systémique, captation des ressources publiques, impunité financière –, se sont enrichis pendant que le pays se vidait de ses enfants ? L’asymétrie est frappante entre la douleur silencieuse des mères et la distance apparente de cercles dirigeants largement préservés des conséquences humaines de l’effondrement.
À ces absences structurelles s’en sont ajoutées d’autres, plus conjoncturelles mais tout aussi révélatrices. De nombreux Libanais établis dans les pays du Golfe, traditionnellement très présents lors des grands événements religieux ou nationaux, ont choisi de ne pas faire le déplacement. La crainte d’une escalade militaire, alimentée par les menaces israéliennes explicites et par l’instabilité régionale, a pesé lourdement dans ces décisions. Pour ces expatriés, l’attachement au pays n’a pas disparu, mais la perception du risque a prévalu. Leur absence s’est ajoutée à celle, plus durable, de la diaspora récente issue de la crise, renforçant l’impression d’un pays momentanément réuni autour d’un événement, mais structurellement dispersé.
La comparaison avec la visite de Benoît XVI en 2012 s’impose dès lors presque naturellement. Le Liban était alors fragile, déjà traversé de tensions régionales, mais il n’était ni économiquement exsangue ni humainement vidé à ce point. Les foules étaient plus présentes parce que le pays était encore peuplé, parce que l’exil n’avait pas encore creusé ce vide profond. La différence observée aujourd’hui ne traduit pas un recul de la foi, mais l’ampleur d’une saignée silencieuse qui, en quelques années, a profondément altéré la substance même de la société libanaise.
La visite officielle, un cadre lourd de sens
Le choix d’inscrire cette venue dans un cadre officiel n’avait rien d’anodin. Une visite officielle ne se réduit jamais à une suite de gestes protocolaires. Elle organise un ordre des présences, hiérarchise les acteurs, place les détenteurs du pouvoir au centre de l’image et suggère, même involontairement, une forme de normalité institutionnelle. Dans un État fonctionnel, ce langage symbolique passe presque inaperçu. Dans un pays marqué par l’effondrement économique, la défiance généralisée et l’absence persistante de reddition de comptes, il devient immédiatement signifiant.
Le fait que la réception de Baabda ait eu lieu dès le jour de l’arrivée du pape a renforcé ce malaise. Avant même que la dimension pastorale de la visite ne s’installe pleinement, avant que les gestes de proximité avec la population ne prennent le dessus, l’image inaugurale a été celle d’un palais présidentiel, d’un protocole rigide et d’un parterre politique omniprésent. Cette séquence initiale a pesé lourdement sur la perception de l’ensemble de la visite, en imposant d’emblée un cadre officiel dans un pays où l’autorité de l’État est précisément ce qui est le plus contesté.
À Baabda, le message visuel a été reçu de manière immédiate et brutale. Là où le pape développait un discours explicitement moralisateur, centré sur la justice, la vérité, la responsabilité et la dignité des plus pauvres, une partie importante de l’opinion publique ne regardait pas d’abord la solennité du moment. Elle voyait des visages. Et derrière ces visages, elle revoyait des dossiers. Des années de débats publics sur les détournements de fonds, les gabegies publiques, les milliards disparus, les mécanismes financiers opaques qui ont effacé l’épargne de dizaines de milliers de familles. L’image officielle n’était pas lue comme un symbole national, mais comme une superposition de responsabilités individuelles non assumées.
Ce décalage a été d’autant plus choquant que parmi les personnes présentes figuraient des responsables politiques et anciens ministres demandés par la justice, notamment dans le cadre d’enquêtes majeures toujours ouvertes, comme celle relative à l’explosion du port de Beyrouth. Leur présence au premier rang de la cérémonie contrastait violemment avec le fait qu’ils ne se présentent pas devant les autorités judiciaires, malgré les procédures engagées. Cette juxtaposition, perçue dès la première journée de la visite, a durablement marqué les esprits. Elle a donné à voir, dès l’ouverture de la séquence libanaise, une cohabitation troublante entre un appel à la vérité et des figures associées, dans l’imaginaire collectif, à l’obstruction judiciaire et à l’impunité.
Cette dissonance n’a pas été marginale. Elle a traversé des couches sociales très larges, bien au-delà des cercles politisés. Elle n’exprimait ni un rejet du pape ni une contestation du message religieux. Elle traduisait un malaise profond face à une mise en scène inaugurale qui, dans un pays meurtri par la crise et par le drame du port, donnait le sentiment que la parole la plus exigeante était prononcée devant ceux qui, précisément, se tiennent hors de portée de toute exigence judiciaire.
Pour une population appauvrie, endeuillée, contrainte à l’exil ou à la survie, cette image de Baabda, survenue dès l’arrivée du pape, a été vécue comme une injustice supplémentaire. Elle a figé, dès le premier jour, une lecture critique de la visite officielle, non pas en raison de son existence, mais en raison de ce qu’elle donnait à voir : la coexistence, sans friction apparente, d’un discours de morale universelle et d’un système politique qui, jusqu’ici, a refusé toute remise en cause réelle.
La visite pastorale, un autre registre
La différence entre la visite officielle et la visite pastorale ne tient pas à une nuance protocolaire, mais à un renversement complet du regard. Là où la visite officielle passe par l’État, ses représentants et ses décors, la visite pastorale contourne volontairement ces filtres pour aller à la rencontre de ceux qui vivent la crise au quotidien. Elle ne cherche pas à montrer un pays tel qu’il aimerait être perçu, mais tel qu’il est réellement. Dans le Liban d’aujourd’hui, cette distinction n’est pas théorique. Elle est immédiatement compréhensible, presque instinctive.
Après la réception de Baabda, organisée dès le jour de l’arrivée du pape et vécue par beaucoup comme un moment de profonde dissonance, les séquences pastorales ont progressivement redonné de la lisibilité à la visite. Dans ces moments-là, la parole ne se heurtait plus à l’image d’élites discréditées ni à la mémoire immédiate des détournements, des gabegies publiques et des responsabilités non assumées. Elle se déployait dans des lieux où la question morale cessait d’être abstraite.
À Bkerké, lorsque le pape s’est adressé aux jeunes, le contenu du message est resté exigeant, mais sa réception a changé. L’appel à ne pas quitter le pays, à ne pas céder au découragement, à garder une espérance active ne pouvait évidemment ignorer la réalité de l’exil massif. Cet appel n’était pas formulé comme une négation de la souffrance, mais comme une prise de conscience lucide : le Liban se vide, et ce vide menace d’emporter avec lui bien plus qu’une génération. Le discours touchait alors une vérité douloureuse, celle d’un pays où rester est devenu un combat, parfois impossible, mais où partir n’est jamais un soulagement complet.
Ce message trouvait un écho particulier chez les familles, et surtout chez les mères. Celles qui pleurent en silence des enfants partis à l’étranger, souvent sans perspective de retour. Pour elles, les paroles sur l’enracinement, la fidélité à la terre et le refus de la fuite comme unique horizon ne relevaient pas de la rhétorique. Elles venaient reconnaître la blessure, sans l’effacer. Restait toutefois, en filigrane, une question que la visite officielle avait laissé intacte : cet appel à rester, si intelligible pour les familles éprouvées, est-il entendu par ceux qui, par leur gestion prédatrice, ont rendu ce départ inévitable ?
Au Carmel de Harissa le jour de son arrivé, puis à Annaya, sur la tombe de saint Charbel hier, ce contraste disparaissait. À Annaya surtout, la scène renvoyait à un autre registre de lecture. Après avoir vu, dès le premier jour, la réalité du pays à travers ses représentants politiques, après avoir entendu les récits d’un système verrouillé et d’une justice empêchée, la prière silencieuse sur la tombe du saint prenait un sens particulier. Beaucoup se sont interrogés, sans cynisme mais avec gravité : le pape n’est-il pas venu, là aussi, demander un miracle ? Non pas un miracle spectaculaire, mais quelque chose de plus radical et plus difficile : que ce pays trouve enfin la force de rompre avec les mécanismes qui le détruisent de l’intérieur.
La visite à l’hôpital psychiatrique de la Croix a renforcé cette cohérence pastorale. Là, aucune ambiguïté n’était possible. Les blessures étaient visibles, corporelles, psychiques. Elles étaient le produit direct de la guerre, de l’effondrement social, de la pauvreté, et parfois de l’exil intérieur. Dans ces lieux, la parole sur la dignité humaine, sur la nécessité de protéger la vie, sur le refus de la violence retrouvait une simplicité presque brutale. Elle ne pouvait être récupérée ni instrumentalisée.
Cette interrogation sur ce miracle auquel le Liban aspre prenait d’autant plus de poids qu’aujourd’hui même, le pape rappelait publiquement porter en lui « la douleur et la soif de justice » des familles victimes de l’explosion du port de Beyrouth. Ce rappel n’avait rien de symbolique. Il renvoyait directement à l’impasse judiciaire, aux enquêtes bloquées, aux responsables qui refusent de comparaître. Ce moment au port prenait une dimension encore plus lourde si l’on se souvenait que, lors de la visite officielle de la veille à Baabda, certaines des personnes politiquement associées à l’entrave de l’enquête judiciaire se trouvaient face à lui. La chronologie comptait. Il ne s’agissait pas de deux séquences isolées, mais de deux scènes consécutives, presque en miroir. D’abord, la rencontre institutionnelle, encadrée, avec des responsables que l’opinion publique identifie depuis des années à la paralysie de la justice. Ensuite, la rencontre avec ceux qui en subissent directement les conséquences.
Dans le cadre de la visite officielle, cette présence passait par le filtre du protocole. Elle se diluait dans le langage institutionnel, dans les discours généraux, dans une forme de neutralité diplomatique. Mais au port, ce filtre disparaissait. Les visages des familles rendaient toute abstraction impossible. Là, la question de la responsabilité ne relevait plus d’un débat politique, mais d’un vide tangible, éprouvé, incarné.
Et puis la grande messe du 2 décembre, réunissant environ 150 000 personnes, a donné une expression collective à cette même logique. Le pape y a insisté sur le refus de la violence, sur l’urgence de choisir la négociation plutôt que les armes, et sur le danger d’une société dominée par l’argent et le cynisme de ceux là même qu’il a vu dès le premier jour, assis devant lui. Ces thèmes prenaient une dimension immédiatement. Ils entraient en résonance avec la réalité d’un pays survolé par des drones dès son départ, soumis à une guerre qui ne s’interrompt jamais vraiment, et à une paix toujours conditionnelle et aux vols et autres détournements de tout genre à compter en premier de celui d’un état.
Dans son discours de départ à l’aéroport, l’appel fut encore plus explicite. Il a demandé que cessent les attaques contre le Liban, rappelant que les armes détruisent tandis que le dialogue construit. Il a évoqué la douleur du peuple libanais, la situation du Sud, la nécessité d’avancer vers une paix réelle, et non simplement proclamée. Il a également élargi cette vision en réaffirmant deux constantes du Vatican souvent sous-traitées par les médias locaux : la nécessité de préserver une présence chrétienne durable au Moyen-Orient et la position historique en faveur de la création d’un État palestinien.
Ces prises de position, loin d’être annexes, donnent un éclairage décisif à l’ensemble de la visite. Elles montrent que la parole pastorale n’était pas en retrait du politique, mais qu’elle refusait d’être enfermée dans le cadre d’un pouvoir discrédité. C’est précisément dans ce refus, dans ce déplacement constant vers les marges, vers les blessés, vers les absents, que la visite a trouvé sa cohérence.
La Foi qu’il faut retenir face à l’impunité
À l’heure d’en tirer un bilan, une réalité s’impose sans détour : la visite officielle a été, dans le contexte libanais, une erreur politique et symbolique majeure. Elle a donné un cadre, des images et une légitimité implicite à des institutions et à des responsables que la société tient pour largement responsables de l’effondrement du pays. Elle a brouillé le message au lieu de le porter. Dans un Liban ravagé par la crise financière, l’exil massif, l’absence de justice et la mémoire encore vive de catastrophes non élucidées, il aurait fallu une visite exclusivement pastorale, assumant clairement l’impasse sur la représentation officielle. La rencontre avec l’État n’a rien apporté ; elle a au contraire affaibli la portée de la parole.
Ce sont donc les moments pastoraux, et eux seuls, qui méritent d’être retenus. Il faudra garder en mémoire les sourires silencieux des carmélites, la présence paisible de novices vivant leur foi dans un pays en ruines, la joie simple et non démonstrative des communiants rassemblés pour la messe du 2 décembre. Ces images disent quelque chose de profond et de juste sur ce qu’est devenu le Liban : une société amoindrie, traversée par l’exil et la fatigue, mais pas entièrement réduite au désespoir. Elles montrent une foi sans pouvoir, sans protection, sans décor, mais encore vivante.
Il faudra aussi garder en mémoire, avec la même force, les visages graves et fermés des familles des victimes du port de Beyrouth. Leur tristesse ne relevait ni du spectacle ni de l’émotion passagère. Elle portait le poids d’une attente interminable, aggravée par l’entrave constante de la justice. Face à eux, le pape ne pouvait offrir que de la consolation. Il ne pouvait ni juger ni réparer. Cette limite, loin d’être un défaut, révélait surtout l’indigence des autorités civiles : quand la reconnaissance morale devient le seul geste possible, c’est que la justice a totalement abdiqué.
C’est précisément cette juxtaposition qu’il faut retenir, et non la séquence officielle. D’un côté, une foi vécue dans la discrétion, la fidélité et parfois la joie. De l’autre, une douleur qui ne trouve ni vérité ni réparation. Entre les deux, une classe dirigeante qui, le temps d’une visite, a pu se placer dans le champ de l’image et du protocole, sans jamais faire ce que seule une parole préalable pourrait rendre crédible : reconnaître, assumer, se confesser au sens plein, avant toute absolution symbolique.
Pour ces responsables, cette visite n’a été qu’une parenthèse. Un instant. Un moment suspendu, protégé par la présence d’une autorité morale mondiale. Pour les victimes, pour les familles endeuillées, pour les mères qui vivent l’exil de leurs enfants comme une absence définitive, la douleur, elle, ne se suspend jamais. Elle ne connaît ni protocole, ni calendrier, ni sortie de scène. À cette souffrance permanente s’ajoute désormais une inquiétude plus large, diffuse mais bien réelle : le risque d’une reprise ouverte de la guerre avec Israël. Les menaces répétées formulées par le gouvernement de Benjamin Netanyahou, et dès le départ du Pape du Liban, les survols et frappes ponctuelles rappellent que la paix reste conditionnelle, toujours révocable. La visite du pape aura, l’espace de quelques jours, contenu cette violence et perturbé les réflexes guerriers. Son départ a dissipé cette retenue. La foi continue de se tenir debout, silencieuse. L’impunité, elle, demeure intacte. Et entre les deux, le pays reste exposé, pris en étau entre une douleur intérieure qui ne guérit pas et une menace extérieure qui n’a jamais disparu.