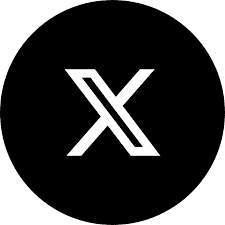Un accord ne se signe pas sur des slogans, mais sur des bilans
Le Liban peut annoncer des « avancées » autant qu’il le souhaite. Tant que le système bancaire ne reconnaît pas ses pertes et ne change pas de nature, aucun programme sérieux avec le Fonds monétaire international ne peut tenir. Le débat n’est pas seulement politique. Il est comptable, juridique et moral. Une économie ne se relève pas quand ses banques fonctionnent comme des caisses de rétention, incapables de prêter, incapables de restituer, et pourtant encore assez puissantes pour imposer leurs conditions au Parlement.
Le pays vit depuis 2019 dans une contradiction toxique. Les dépôts sont bloqués, mais les banques continuent d’exister. Le crédit est presque mort, mais les établissements réclament d’être « préservés ». Les règles de transfert ont longtemps été arbitraires, mais le secteur invoque aujourd’hui l’État de droit pour contester un texte qui encadre enfin la répartition des pertes. Cette inversion permanente du récit est devenue l’obstacle central à toute négociation crédible.
Le point de départ : l’écart financier et la crise de solvabilité
La crise libanaise n’est pas une simple crise de liquidité. C’est une crise de solvabilité. Les banques ont accumulé des passifs colossaux envers les déposants, tout en concentrant une grande partie de leurs actifs sur des placements à la Banque centrale et sur la dette publique. Quand l’État a fait défaut et que la Banque centrale s’est retrouvée incapable de rendre aux banques ce qu’elles lui devaient, le système s’est effondré comme un jeu d’écriture.
Suivez les principaux indicateurs économiques en temps réel.
Les chiffres disponibles donnent l’ampleur du déséquilibre. À la fin novembre 2025, les dépôts du secteur privé atteignaient 87,7 milliards de dollars, tandis que les actifs consolidés des banques avoisinaient 101,8 milliards. Sur le papier, le secteur paraît encore massif. Dans les faits, son rôle est réduit à l’administration d’un gel. Le crédit au secteur privé en devises est tombé autour de 5,3 milliards de dollars, signe d’une intermédiation amputée. Une banque qui ne prête plus n’est plus une banque au sens économique. Elle devient un guichet de restriction.
C’est précisément ce que le Fonds monétaire international refuse de financer. Un programme ne sert pas à prolonger une paralysie, il sert à la résoudre. Le Fonds exige donc une photographie consolidée des pertes et un mécanisme pour les absorber. Or, les banques se battent d’abord contre la photographie.
Le jeu bancaire : contester les chiffres, gagner du temps, déplacer la faute
La stratégie du secteur est connue. Elle se déploie en trois temps. D’abord, contester la méthode et exiger « des études » avant toute loi. Ensuite, attribuer l’essentiel du trou à l’État et à la Banque centrale. Enfin, avertir que toute perte imposée aux banques détruirait l’économie, comme si l’économie vivait encore grâce au crédit bancaire.
Le secteur bancaire avance un argument qui contient une part de vérité : l’État a été un débiteur vorace, et une part du déficit a été logée dans le bilan de la Banque centrale. Mais cet argument devient un écran quand il sert à protéger les actionnaires et à neutraliser tout principe de responsabilité. Les banques ont choisi leur modèle. Elles ont accepté la concentration de risques sur le souverain et sur la Banque centrale parce que cela rapportait. Elles ont continué à attirer des dépôts en promettant des rendements élevés. Elles ont bénéficié d’une rente tant que la machine tournait. Quand la machine s’est arrêtée, elles ont demandé aux déposants de financer leur survie.
Le Fonds monétaire international ne peut pas valider ce renversement. Dans une restructuration bancaire classique, les actionnaires absorbent d’abord les pertes, puis viennent les créanciers non garantis. Au Liban, la logique a été inversée dès 2019 par des restrictions de fait, imposées aux déposants, sans loi, sans égalité, sans recours simple. Le système a ainsi socialisé la perte sur les ménages et les entreprises, tout en préservant des centres de pouvoir.
Les dépôts, point de rupture politique et condition du retour de la confiance
Tout accord avec le Fonds se heurte à la question des dépôts. Le pays ne manque pas seulement de dollars. Il manque de confiance. Et la confiance ne revient pas avec un communiqué. Elle revient avec un plan lisible : qui est remboursé, quand, selon quelles règles, et avec quelle garantie juridique.
Les banques voudraient transformer ce sujet en débat technique sans fin. Elles préfèrent des calendriers ouverts, des instruments difficiles à valoriser, des promesses liées à des revenus futurs. Elles savent qu’un plan précis révélerait immédiatement les gagnants et les perdants, et qu’il imposerait une vérité simple : une partie des pertes doit être portée par le capital bancaire, donc par les actionnaires, et non par les seuls déposants.
Le coût économique de l’absence de plan est immense. Tant que les déposants ne croient pas à un mécanisme de restitution, ils évitent le système. Ils thésaurisent, ils paient en espèces, ils réduisent leur usage des banques au minimum. L’économie se transforme en économie de cash. Sans dépôts stables, pas de ressources bancaires. Sans ressources, pas de crédit. Sans crédit, pas d’investissement productif. Le secteur bancaire prétend vouloir la reprise, mais il entretient le cercle qui empêche la reprise.
La Banque centrale : une transparence tardive qui ne suffit pas
La Banque centrale a commencé à présenter certains postes de manière plus lisible, en distinguant mieux les actifs étrangers réellement liquides. Les réserves en devises dites liquides s’établissaient autour de 11,89 milliards de dollars à la fin décembre 2025. Dans le même temps, la valeur des réserves d’or dépassait 40,4 milliards de dollars. Cet écart est révélateur. L’or rassure, mais il ne remplace pas de la liquidité mobilisable. Et il ne rembourse pas des dépôts par magie.
La Banque centrale a aussi annoncé des démarches judiciaires visant à récupérer des fonds détournés ou mal utilisés. Sur le plan politique, le signal est utile. Sur le plan financier, ce n’est pas une solution structurante. Les procédures sont longues, incertaines, fragmentées. Même si des récupérations ont lieu, elles ne remplaceront pas un mécanisme de répartition des pertes. Un accord avec le Fonds ne se construit pas sur l’espoir d’un butin judiciaire. Il se construit sur une architecture stable, contrôlable et vérifiable.
Les prérequis d’un programme : quatre chantiers qui se heurtent au même mur
Le premier chantier est un cadre légal de répartition des pertes, avec des définitions claires, des mécanismes de recours et un calendrier exécutoire. Le second est une loi de contrôle des capitaux. Un pays ne peut pas prétendre à la stabilité si les transferts dépendent d’un arbitraire bancaire, variable selon les établissements et selon les clients. Le troisième chantier est la restructuration du secteur bancaire, incluant la résolution ordonnée des banques insolvables, avec recapitalisation ou sortie du marché. Le quatrième est une réforme de gouvernance : transparence des bilans, contrôle prudentiel réel, et traitement des conflits d’intérêts.
Sur chacun de ces chantiers, les banques pèsent. Elles influencent le rythme législatif, elles contestent les méthodes, elles mobilisent l’argument de la « préservation » pour limiter l’ampleur des pertes qui leur seraient attribuées. C’est pourquoi la question de l’accord avec le Fonds est d’abord une question de rapport de force. Les textes peuvent être écrits. Le problème est leur contenu final, puis leur application.
Les signaux de marché : un frémissement spéculatif, pas une preuve de guérison
Le début de janvier 2026 a montré un paradoxe. Les obligations souveraines libanaises ont bondi sur le marché secondaire, passant d’environ 23 cents à 27,5 cents pour un dollar de valeur faciale, un plus haut depuis le défaut de mars 2020. Ce mouvement n’indique pas que le Liban est solvable. Il indique qu’une partie des investisseurs parie sur une restructuration, ou sur un cadre légal susceptible de faire remonter des actifs très décotés.
Dans le même temps, le marché actions local restait fragile, avec un indice en baisse sur la semaine et des volumes modestes. Cette divergence est instructive. La spéculation peut anticiper un événement politique. Elle ne fabrique pas une économie réelle. Le Fonds monétaire international ne se satisfera pas d’un rallye de titres en détresse. Il exigera un programme cohérent.
Pourquoi les banques freinent : une question de pouvoir, pas seulement d’argent
Le blocage bancaire ne se comprend pas seulement par les chiffres. Il se comprend par le pouvoir. Une restructuration réelle implique de révéler des choix passés, de documenter des opérations, de distinguer les responsabilités entre banques, Banque centrale et État, puis d’imposer des pertes aux actionnaires. Elle implique aussi de revoir la gouvernance du secteur, ses liens politiques, et la manière dont il a fonctionné comme un centre de décision autonome.
Le secteur préfère donc une sortie graduelle, opaque et négociée. Étaler la perte sur des années. Transformer des dépôts en instruments sans prix clair. Maintenir les mêmes propriétaires. Promettre le retour du crédit demain, tout en évitant de payer la facture aujourd’hui. Cette stratégie peut offrir une respiration au secteur bancaire. Elle condamne le pays à la stagnation et rend un accord durable improbable.
Scénarios 2026 : compromis, rupture ou enlisement
Premier scénario, le plus probable politiquement : un compromis superficiel. Un texte est voté, mais il renvoie l’essentiel à des décrets, laisse des zones grises, et reporte les décisions difficiles. Un accord peut être annoncé, mais la confiance ne revient pas, car les déposants comprennent vite qu’on a surtout gagné du temps.
Deuxième scénario, le seul économiquement solide : une rupture assumée. Audit consolidé, identification des banques insolvables, résolution ordonnée, recapitalisation réelle, hiérarchie claire des dépôts avec priorité aux petits et moyens déposants. Cette option est douloureuse, mais elle restaure un principe que le pays a perdu : la responsabilité.
Troisième scénario, le plus destructeur : l’enlisement. Le contrôle des capitaux reste informel, l’économie se cashise, les restrictions internationales persistent, et le pays s’appauvrit lentement, tout en gardant un secteur bancaire fantôme.
Le contrôle des capitaux reste l’angle mort qui protège les privilégiés. Sans loi, l’arbitraire bancaire favorise les mieux connectés. Une règle écrite sert à définir des exceptions transparentes et des recours. Tant que cet instrument manque, les banques gardent la main et l’accord avec le Fonds demeure un horizon politique, pas une réalité économique.