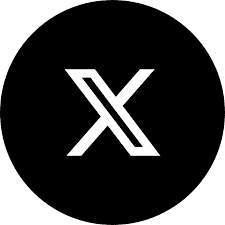Une croissance qui ne répare rien
Les chiffres de croissance annoncés pour 2025 et attendus pour 2026 alimentent un discours de reprise. Pourtant, le cœur du système reste cassé. L’idée dominante est simple: un rebond statistique après un effondrement ne suffit pas. Il ne reconstruit pas une économie. Il ne restaure pas non plus un crédit sain.
Ce diagnostic s’appuie sur une observation concrète. Les investisseurs étrangers ne cherchent pas seulement une période sans combats. Ils demandent un cadre stable. Ils veulent des règles et une visibilité. Tant que ces règles manquent, l’argent reste prudent. Il attend. Il évite le long terme.
Dans ce contexte, le pays vit sur un “calme armé” qui agit comme une taxe invisible. La consommation peut repartir. Certaines activités redémarrent. Mais l’investissement productif, lui, reste freiné. Les grands projets demandent du crédit et de la confiance. Or ces deux éléments restent bloqués.
Comparez rapidement les prix des vols avec Fly2Leb.
Le trou noir bancaire, chiffré à 70 milliards
Le verrou principal reste le secteur bancaire. Le débat est décrit comme une “guerre du déni” autour d’une perte évaluée à 70 milliards de dollars. Le point le plus lourd n’est pas le chiffre. C’est le refus de le traiter comme une perte à répartir. Tant que la perte n’est pas reconnue, elle ne peut pas être absorbée. Tant qu’elle n’est pas absorbée, aucune banque ne peut redevenir une banque normale.
La conséquence est mécanique. Sans bilan propre, une banque ne prête pas. Ou elle prête très peu. Ou elle prête à un coût trop élevé. Elle se protège. Elle réduit le risque. Elle fuit les projets productifs. Elle préfère les opérations rapides, les commissions et les produits sûrs.
Cette paralysie ne touche pas seulement les déposants. Elle touche toute l’économie. Un entrepreneur cherche de la liquidité. Il n’en trouve pas dans le circuit bancaire. Il se tourne vers des circuits informels. Le coût monte. La marge baisse. Le risque augmente avant même d’ouvrir.
Le crédit, dans une économie, n’est pas un luxe. C’est l’oxygène du quotidien. Il finance des stocks. Il finance des machines. Il finance une saison agricole. Il finance un contrat. Quand il disparaît, l’activité se transforme. Elle devient petite. Elle devient courte. Elle devient prudente. Et elle ne crée pas assez d’emplois.
Déposants, entreprises et État: un conflit qui déborde
La crise bancaire est souvent racontée comme un conflit entre banques et déposants. Cette lecture est incomplète. Le conflit est triangulaire. Il implique l’État. Il implique la Banque centrale. Il implique aussi des choix budgétaires anciens.
Dans un récit très présent, les banques sont décrites comme ayant placé leur confiance dans la Banque centrale, attirées par des rendements élevés. Les déposants, eux aussi, auraient cherché ces rendements, directement ou indirectement. Cette chaîne de comportements crée une question de responsabilité partagée. Elle rend aussi la solution plus difficile, car chaque acteur cherche à déplacer le coût vers l’autre.
La conséquence politique est immédiate. Sans récit partagé sur l’origine des pertes, aucune solution durable ne peut être vendue à la société. Chaque projet de loi est attaqué. Chaque plan est soupçonné. Le pays reste bloqué dans une bataille de versions, au lieu d’entrer dans une phase de réparation.
La racine budgétaire, bien avant 2019
Un autre point revient avec insistance. La crise ne commencerait pas en 2019. Elle serait l’aboutissement d’un déficit structurel, décrit comme ancien. Dans cette lecture, l’État aurait dépensé plus qu’il ne percevait depuis des décennies. Il aurait comblé ses trous par l’emprunt, y compris auprès de la Banque centrale.
Cette perspective ne blanchit personne. Elle déplace l’attention vers la mécanique budgétaire. Quand un État vit longtemps au-dessus de ses moyens, il finit par dépendre d’une finance de plus en plus artificielle. Quand cette finance casse, le coût explose. Il se retrouve dans les bilans bancaires. Il se retrouve aussi dans les poches des citoyens.
Ce rappel sert aussi un débat diplomatique. Les bailleurs connaissent ces réalités. Ils demandent des réformes. Ils demandent des chiffres. Certains discours internes tentent parfois de minimiser la part de l’État pour faciliter un retour de financement. Mais la crédibilité exige l’inverse. Elle exige une transparence totale.
Pourquoi la “reprise” ne se transforme pas en économie productive
Sans banques fonctionnelles, la reprise reste fragile. Elle se concentre sur des secteurs de consommation et de services rapides. Elle ne finance pas assez l’industrie. Elle ne finance pas assez l’agriculture. Elle ne finance pas assez l’export. Elle ne finance pas non plus l’innovation.
Le pays peut donc afficher une activité. Les commerces peuvent tourner. Des restaurants peuvent rouvrir. Mais cette activité ne suffit pas à reconstruire une base productive. Elle ne crée pas un tissu d’entreprises capables de grandir. Elle ne crée pas non plus des emplois stables.
La question de la confiance est au centre. Un investisseur regarde trois choses. La stabilité sécuritaire. La stabilité juridique. La stabilité financière. Le Liban peut parfois offrir la première. Il peine encore sur les deux autres.
Le coût social: l’ajustement devient explosif
Le blocage bancaire n’est pas seulement économique. Il devient social. Car l’État cherche des recettes. Il cherche aussi à réduire ses dépenses. Et il est poussé vers un programme d’ajustement.
Dans ce climat, une mobilisation dans la fonction publique est décrite avec un mode d’action précis. Les salariés restent présents sur les lieux de travail, mais refusent d’exécuter les tâches, sauf nécessité absolue. Le message est clair. Le service public tient, mais il ne peut plus fonctionner comme avant.
La peur exprimée est celle d’un ajustement jugé inégal. Les salariés redoutent des augmentations “sur le papier” qui seraient reprises ensuite par des prélèvements, des taxes, ou des pertes de droits futurs. Ils dénoncent aussi une logique où certains postes de direction conserveraient des rémunérations élevées, alors que la base est appelée à accepter l’effort.
Ce conflit social est directement lié à la crise bancaire. Tant que le pays ne traite pas ses pertes, il cherche des solutions partielles. Il bricole. Il pousse le coût vers les ménages. Il pousse aussi le coût vers les salariés. Cette méthode crée une fatigue. Elle crée une colère. Elle nourrit une instabilité qui décourage encore plus l’investissement.
Le problème de fond: pas de reconstruction sans crédit, pas de crédit sans vérité
L’équation est dure, mais elle est simple. Une économie se reconstruit avec du crédit. Une banque prête quand elle a des bilans crédibles. Un bilan crédible exige une reconnaissance des pertes.
Le refus de reconnaître la perte agit donc comme un gel. Il empêche un plan bancaire sérieux. Il empêche aussi une relance réelle. Même si certains indicateurs s’améliorent, le pays reste exposé. Il reste dépendant des flux courts. Il reste dépendant de la diaspora. Il reste dépendant d’une stabilité fragile.
Ce blocage crée aussi une injustice diffuse. Les déposants attendent. Les entreprises peinent. Les salariés contestent. Et l’État oscille entre promesses et mesures temporaires. Dans ce climat, la reprise ressemble à un mirage, parce qu’elle ne touche pas la structure.
Une crise qui se nourrit aussi de l’extérieur
L’économie libanaise n’évolue pas dans un vide mondial. Des tensions commerciales internationales et des menaces de droits de douane sont évoquées dans le même contexte, avec des inquiétudes sur les exportations européennes. Pour le Liban, ces signaux comptent. Le pays dépend des marchés, des transferts, et des pays du Golfe. Quand l’extérieur ralentit, l’intérieur souffre plus vite.
Cette dépendance renforce le besoin de règles internes solides. Plus le monde est instable, plus un pays fragile a besoin d’institutions stables. Or, le cœur financier du Liban reste contesté. Il reste suspendu à une décision que personne ne veut porter seul.
Le test de 2026: répartir la perte ou prolonger l’économie d’attente
Le débat sur les 70 milliards n’est pas une querelle comptable. C’est un choix de modèle. Soit le pays accepte de regarder la perte en face et de la répartir selon des règles assumées. Soit il continue à vivre dans l’attente, avec une économie qui tourne sans crédit, un État qui improvise, et une société qui paie par petites coupures.