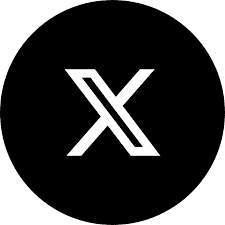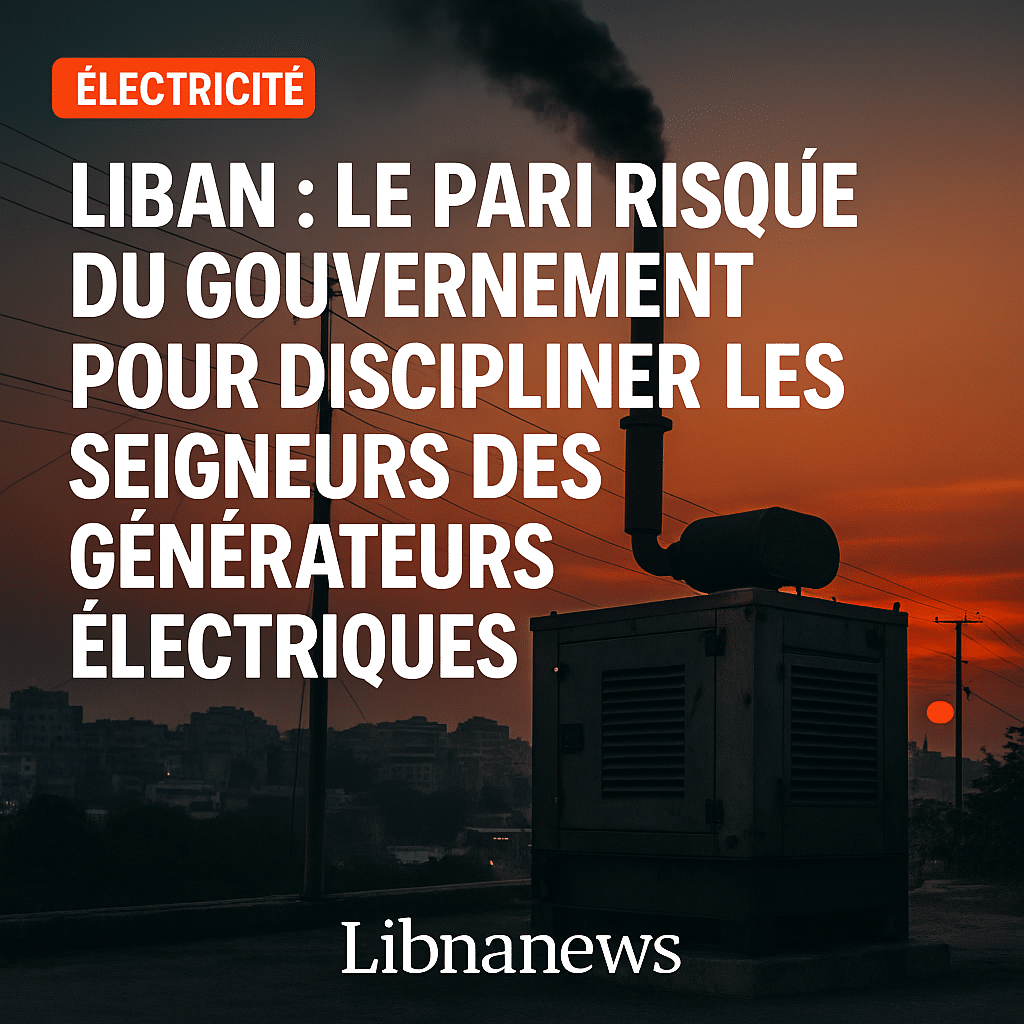Oh, quelle savoureuse pirouette verbale nous offre notre président Joseph Aoun ! Hier, fraîchement élu en janvier 2025 après des années de vide présidentiel, il a décrété avec un aplomb magistral que le Liban n’est pas en faillite, mais simplement « volé », victime d’une mauvaise gestion et de quelques larcins bien placés. Comme si renommer le naufrage en « pillage » allait faire réapparaître les milliards envolés ou ressusciter les économies des Libanais, prisonnières des coffres bancaires.
Franchement, qui oserait parler de banqueroute quand l’État, les banques et les citoyens nagent dans un océan de dettes impayables, avec des caisses aussi vides qu’un discours de campagne ? Ironie à part – ou presque –, les faits hurlent une vérité moins poétique : le Liban est en faillite, et pas qu’un peu. Une faillite classique, marquée par un défaut de liquidité criant, où l’État et les banques n’ont plus un sou pour honorer leurs engagements, en grande partie à cause d’un schéma de Ponzi orchestré par le système bancaire.
Et pendant que Joseph Aoun joue les alchimistes du verbe, ses choix – comme la nomination de Karim Souaid à la Banque du Liban, son rôle en 2019-2020 protégeant les banques des manifestants, et l’absence sidérante de volonté pour récupérer les intérêts excessifs ou les fonds transférés à l’étranger – trahissent une proximité gênante avec le lobby bancaire, au point qu’on conçoit à peine de condamner ces institutions pour abus de confiance.
Suivez les principaux indicateurs économiques en temps réel.
Commençons par le b.a.-ba de la faillite, car le président semble avoir besoin d’un rappel. Une faillite, dans la plupart des cas, se définit par un défaut de liquidité : l’incapacité d’une entité – État, entreprise ou banque – à payer ses dettes ou à honorer ses obligations faute de cash disponible. Le Liban coche cette case avec une précision presque comique.
Depuis 2019, le pays est englué dans une crise économique qualifiée par certains d’une des pires de l’histoire moderne, comparable aux grandes dépressions du XXe siècle. En mars 2020, l’État a officiellement fait défaut sur sa dette souveraine – en clair, il a levé les mains en disant : « On n’a plus de quoi payer. » La dette publique dépasse les 100 milliards de dollars, mais les caisses de l’État sont vides, incapables de financer les services publics ou de rembourser les créanciers. Le PIB a chuté de plus de 50 % depuis 2018, passant d’environ 55 milliards de dollars à un squelette rachitique. La livre libanaise s’est effondrée de plus de 95 % face au dollar, transformant les salaires en miettes. L’inflation a caracolé à 200 % par an à ses pires moments, rendant le quotidien invivable pour la majorité. Plus de 80 % de la population croupit sous le seuil de pauvreté, les hôpitaux manquent de médicaments, l’électricité est un lointain souvenir, and les banques ont gelé les dépôts des citoyens, piégeant des milliards dans un purgatoire financier.
En 2025, malgré une timide projection de croissance de 4,7 % tirée par le tourisme et des réformes au compte-gouttes, le pays reste au bord du gouffre, sans liquidités pour relancer l’économie ou rétablir la confiance et surtout incapable de répondre aux conditions débloquant l’aide internationale. Si ce n’est pas la définition d’une faillite non seulement financière mais aussi d’un système dans son entier pour ne pas dire autre chose, alors il faudrait réécrire les manuels d’économie.
Mais d’où vient ce défaut de liquidité ? Entrons dans le cœur du problème : le schéma de Ponzi qui a gangréné le système bancaire libanais. Pendant des années, sous la houlette de la Banque du Liban, les banques commerciales ont attiré des dépôts en promettant des rendements mirobolants – jusqu’à 15-20 % d’intérêts annuels sur les comptes en dollars, bien au-dessus des normes internationales. Ces taux alléchants n’étaient pas le fruit d’investissements productifs, mais une illusion entretenue en payant les anciens déposants avec l’argent des nouveaux, tout en finançant la dette publique via des eurobonds. La Banque centrale, pour maintenir cette façade, empruntait toujours plus, siphonnant les réserves en devises pour couvrir les déficits budgétaires et les intérêts exorbitants.
Ce système, digne d’un Ponzi classique, s’est effondré en 2019 quand les flux de dollars se sont taris, révélant un trou béant : les réserves de la Banque du Liban étaient quasi épuisées, et les banques, incapables de rendre les dépôts, ont imposé des contrôles de capitaux illégaux.
Résultat ? Les économies des Libanais – environ 100 milliards de dollars de dépôts – sont devenues inaccessibles, tandis que les banques, techniquement insolvables, continuent de prétendre que tout va bien. Ce n’est pas juste un « vol », c’est une escroquerie systémique qui a précipité la faillite.
Et que fait-on pour réparer ce désastre ? Presque rien, et c’est là que l’ironie atteint des sommets. Les autorités, y compris sous la présidence de Joseph Aoun depuis janvier 2025, montrent une absence criante de volonté pour récupérer les fonds détournés ou les intérêts excessifs versés par les banques.
Entre 2015 et 2019, des milliards de dollars ont été transférés à l’étranger par des élites politiques et financières, souvent via des comptes offshore, alors que les citoyens ordinaires voyaient leurs dépôts gelés. Des rapports ont estimé que jusqu’à 10 milliards de dollars auraient ainsi quitté le pays, souvent avec la complicité des banques et sous le nez des régulateurs. Pourtant, ni le gouvernement ni la justice n’ont sérieusement poursuivi ces transferts illicites.
Pire encore, les intérêts excessifs – ces rendements Ponzi qui ont gonflé les profits des banques – n’ont jamais été remis en question. Aucune réforme sérieuse n’a exigé que les actionnaires des banques, qui se sont enrichis sur le dos des déposants, remboursent ne serait-ce qu’une fraction de ces gains indus.
Et pour couronner le tout, on conçoit à peine de condamner les banques pour abus de confiance, alors que leur gestion frauduleuse a ruiné des millions de Libanais. Les enquêtes judiciaires, comme celles visant l’ancien gouverneur Riad Salameh, traînent depuis des années, entravées par des interférences politiques et un manque de volonté flagrant. Pendant ce temps, les déposants restent les dindons de la farce.
Et parlons de ce « vol » que Joseph Aoun brandit comme un bouclier rhétorique.
Élu en janvier 2025 après deux ans de chaos présidentiel, l’ex-commandant de l’armée clame que la corruption est le vrai fléau, pas la banqueroute. Beau discours, mais les faits racontent une autre histoire, surtout quand on revisite son passé.
En 2019-2020, lors de la « Thawra », ces manifestations massives contre la corruption et la crise, Aoun, alors à la tête de l’armée, a fait un choix révélateur. Face à des foules enragées par les contrôles de capitaux et les dépôts gelés, il a déployé ses troupes pour protéger les institutions, notamment les banques, ces forteresses du désastre.
Lors de la « nuit des Molotov » en avril 2020, quand des dizaines de banques ont été vandalisées et incendiées à travers le pays, l’armée sous ses ordres a affronté les manifestants, pourchassant les protestataires et défendant les façades des établissements financiers. Des citoyens, dépouillés de leurs économies, scandaient leur désespoir, accusant l’armée de protéger les banquiers et les politiciens plutôt que le peuple. Un manifestant à Saïda a même lancé à Aoun, commandant de l’armée : « Vous devriez être avec nous, pas contre nous. »
Au lieu de non seulement réclamer justice pour les déposants, ce ne sont que des mots au final, mais d’accorder justice aux déposants, – ces victimes du « vol » qu’il dénonce aujourd’hui –, Aoun a choisi de bouclier les banques, priorisant l’ordre établi sur la quête de vérité. Ce choix dessine les contours d’une loyauté aux élites financières qui se prolonge jusqu’à aujourd’hui.
Car cette loyauté persiste. Prenons la nomination de Karim Souaid comme gouverneur de la Banque du Liban en mars 2025 : un financier aguerri, ex-directeur chez HSBC et fondateur d’une firme d’investissement, mais surtout le poulain du lobby bancaire. Aoun a imposé ce choix, balayant les objections en arguant que Souaid était le « meilleur candidat » pour négocier avec le FMI et réformer le secteur. Mais les critiques pleuvent : Souaid, avec ses liens étroits aux cercles financiers, est perçu comme un gardien du statu quo, celui des banques accusées d’avoir siphonné les réserves par des prêts hasardeux et des transferts opaques.
N’est-ce pas ironique ? Le président fustige le « vol » tout en confiant les clés de la Banque centrale à un allié des banquiers au lieu d’une personne plus neutre, d’un réel arbitre entre intérêts des banques et déposants, au moment où le pays a besoin de réformes qui briseraient l’emprise des élites financières.
Cette proximité n’est pas un hasard : elle perpétue un système où les responsables du schéma de Ponzi, des transferts illicites et des intérêts indus restent intouchables.
Au final, cher président Joseph Aoun, qualifier le Liban de « volé » plutôt que de failli, c’est comme dire qu’un bateau coulé n’a juste pas assez d’eau pour flotter. La faillite est là, limpide, dans ce défaut de liquidité alimenté par un schéma de Ponzi bancaire, des fonds transférés à l’étranger, et des intérêts excessifs jamais récupérés. Les faits – dette impayable, économie effondrée, misère galopante – ne laissent aucun doute. Votre rôle en 2019-2020, protégeant les banques au lieu de défendre les déposants, votre choix de Souaid, et l’absence de poursuites contre les abus des banques ne font que prolonger cette triste saga. Ce n’est pas qu’un abus de confiance, mais un vol systémique des ressources de l’état par un endettement volontaire en vue d’entretenir non pas l’intérêt général mais d’intérêts privés.
Si la bonne gestion est la solution, comme vous le prétendez, pourquoi ne pas commencer par condamner les banques dont les profits dans les années pré-crises se comptaient en milliards de dollars transférés – à temps – depuis à l’étranger et récupérer les milliards envolés ? Les Libanais attendent des actes, pas des euphémismes. Sinon, le « vol » continuera, et la faillite avec.