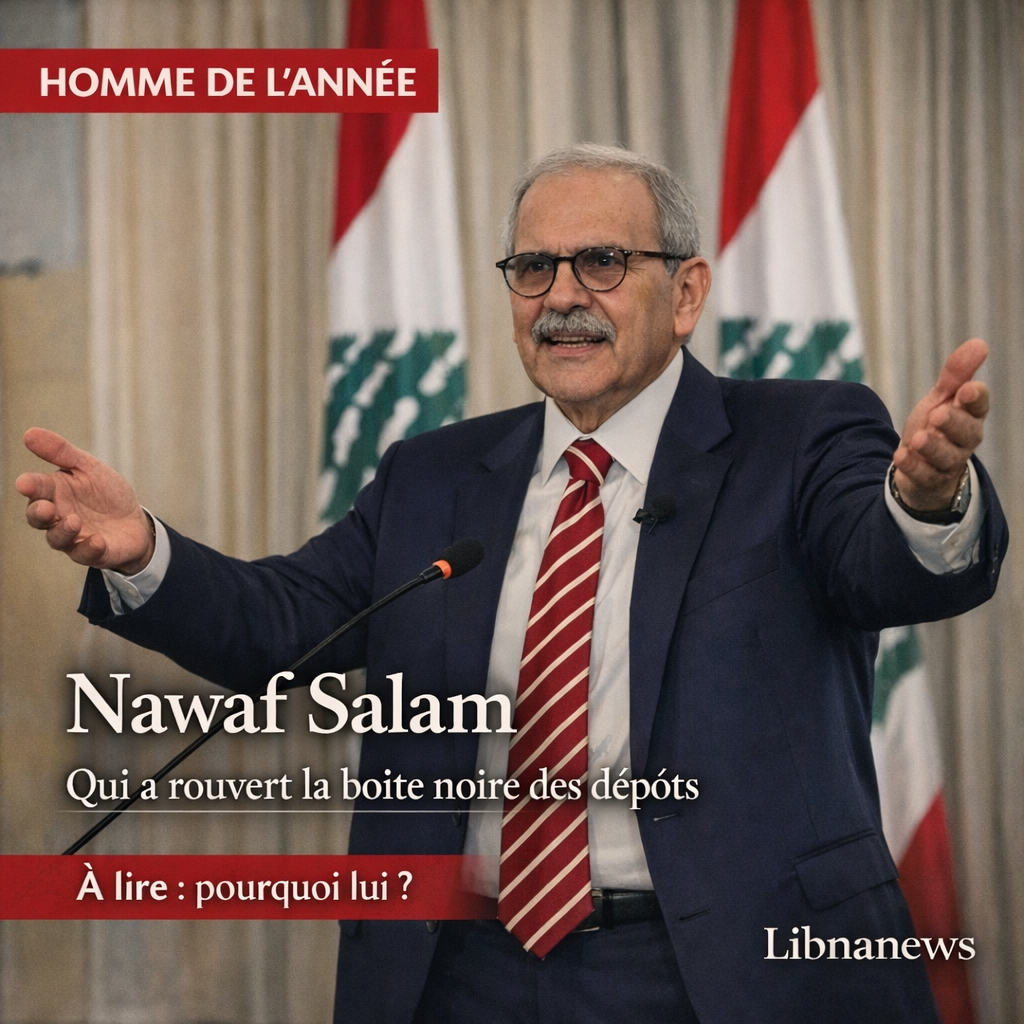Une économie sans banques, mais avec des banques partout
Le Liban vit une contradiction rare. Le pays continue d’avoir des banques, des agences, des logos, des applications et des formulaires. Pourtant, il ne vit plus avec un système bancaire au sens normal. Un système bancaire normal prend des dépôts, protège l’épargne, finance l’économie, accorde du crédit, et assure des paiements fluides. Au Liban, l’essentiel de cette promesse s’est effondré.
Le résultat est visible dans la rue. Le cash domine. Les paiements se font en billets, parfois en liasses. Les entreprises stockent du liquide. Les ménages gardent des enveloppes à la maison. Cette bascule n’est pas un détail culturel. C’est une conséquence directe d’un système qui a brisé le contrat de base entre la banque et le déposant.
Dans ce contexte, les banques ont réussi une opération de survie. Elles ont gardé leur place centrale, tout en se retirant de leur obligation principale. Elles ont conservé les privilèges de la structure, mais elles ont délégué la douleur au client. Elles n’ont pas annoncé une faillite. Elles ont imposé une incapacité.
Ce choix est lourd. Il a transformé le pays en économie de méfiance. Il a aussi créé une hiérarchie invisible. Ceux qui ont des canaux, des relations, ou des solutions offshore s’en sortent mieux. Ceux qui vivent d’un salaire, d’une indemnité, ou d’une épargne modeste paient plus cher. La crise n’a pas seulement détruit de la valeur. Elle a trié la société.
La “restriction” comme invention libanaise: pas de loi, mais une règle
Dans un État fonctionnel, limiter les retraits et les transferts passe par une loi. Cette loi fixe des conditions, des durées, des recours, et des protections. Au Liban, la restriction a été imposée sans ce cadre. Elle est devenue une règle de fait. Une règle sans responsabilité claire.
C’est là que commence le scandale. Une banque a un devoir. Elle doit rendre l’argent au déposant, selon des modalités prévues par le contrat et par la loi. Si elle ne peut pas, elle doit être traitée comme une institution en difficulté. Elle doit être surveillée, recapitalisée, restructurée, ou liquidée. Elle ne peut pas simplement dire non, puis continuer à fonctionner comme si de rien n’était.
Pourtant, c’est exactement ce qui s’est produit. Les banques ont transformé un défaut en “politique commerciale”. Elles ont naturalisé l’exception. Elles ont créé un langage: plafonds, taux internes, conversions, retraits fractionnés, chèques bancaires à prix cassé. Tout cela a servi une seule idée: payer moins que ce qui est dû, sans le reconnaître officiellement.
Cette absence de loi a aussi protégé le secteur. Sans loi, l’injustice devient diffuse. Le client ne sait pas où frapper. Il frappe la banque, qui dit: ce n’est pas nous, c’est le système. Il frappe l’État, qui dit: ce n’est pas nous, c’est la banque. Et pendant que chacun se renvoie la balle, le déposant perd du temps. Or le temps est une perte.
Le vrai crime économique: la perte transformée en lente évaporation
Une perte peut être brutale, mais claire. Elle peut être répartie selon une hiérarchie. Elle peut être assumée par ceux qui ont pris le risque. C’est la logique du capital. Le Liban a choisi l’inverse. Il a choisi l’évaporation lente.
Cette évaporation a plusieurs moteurs. Le premier est le taux multiple. Quand un déposant retire au taux le plus bas, il encaisse une décote. Le second est l’inflation, qui grignote chaque jour la valeur réelle de ce qu’il récupère. Le troisième est le délai, car récupérer plus tard équivaut à récupérer moins. Le quatrième est l’arbitraire, qui permet aux plus influents de négocier mieux que les autres.
Au final, la perte devient un brouillard. Elle est partout, mais nulle part. Elle ne porte pas un nom. Elle ne porte pas une responsabilité. Elle ne déclenche pas une restructuration. Elle ne déclenche pas la purge des banques mortes. Elle devient un régime.
Le secteur bancaire a intérêt à ce régime. Il évite un choc de vérité. Il évite l’audit qui tranche. Il évite le tri qui élimine. Il évite la perte de contrôle. Il évite surtout une conclusion simple: une partie du secteur est insolvable, et ses actionnaires doivent payer avant les déposants.
La hiérarchie normale des pertes, et la hiérarchie libanaise
Dans un pays normal, la hiérarchie est connue. Les actionnaires absorbent d’abord. C’est leur rôle. Ils ont profité des profits quand tout allait bien. Ils supportent la perte quand tout va mal. Ensuite viennent les créanciers subordonnés, s’ils existent. Ensuite seulement, on discute des créances plus sensibles. Et l’on protège strictement les petits déposants, car ils n’ont pas choisi un risque.
Au Liban, la hiérarchie a été inversée dans les faits. Les déposants ont absorbé d’abord. Ils ont absorbé par l’impossibilité de retirer. Ils ont absorbé par la décote. Ils ont absorbé par la dévaluation. Les actionnaires, eux, ont souvent gardé la structure. Ils ont gardé le contrôle. Ils ont parfois gardé des profits passés. Ils ont surtout évité la sanction de marché.
Cette inversion est le cœur de la colère. Elle n’est pas seulement morale. Elle est économique. Un système qui protège le capital contre l’échec détruit la discipline. Il dit à tous les acteurs: prenez le risque, encaissez le gain, et si ça casse, la société paiera. C’est le meilleur moyen de répéter la catastrophe.
Les banques tentent de justifier cela en parlant de stabilité. Elles disent qu’une purge serait trop violente. Elles oublient de dire que l’absence de purge a déjà été violente. Elle a détruit la confiance. Elle a détruit le crédit. Elle a détruit la monnaie. Elle a détruit une partie de la classe moyenne.
Le chantage à la stabilité: “si vous nous touchez, vous cassez le pays”
Le discours bancaire est toujours construit sur une menace. Si l’on impose des pertes aux banques, l’économie s’effondre. Si l’on force des recapitalisations, les banques ferment. Si l’on change les règles, la confiance disparaît.
Ce discours est trompeur. La confiance a déjà disparu. Le crédit normal a déjà disparu. Le pays fonctionne déjà sans banques, mais avec des banques. Il fonctionne sur du cash, sur des circuits parallèles, sur des paiements fragmentés. Il fonctionne avec des entreprises qui évitent le compte bancaire. Il fonctionne avec des ménages qui refusent de déposer.
La question n’est donc pas de protéger une stabilité imaginaire. La question est de reconstruire une stabilité réelle. Et cette reconstruction exige une chose que les banques redoutent: la transparence et la responsabilité.
Les banques veulent que l’État les protège au nom de la stabilité. Mais elles ont refusé d’assurer la stabilité de leurs clients. Elles ont demandé patience au déposant, puis elles ont offert des solutions au compte-gouttes. Elles ont exigé compréhension, tout en conservant une structure de pouvoir.
Le chantage a un effet politique. Il fait peur aux députés. Il fait peur aux gouvernements. Il fait peur à une partie de l’opinion. Il produit des lois molles. Il produit des retards. Et chaque retard est une victoire bancaire, car chaque retard affaiblit le déposant.
La fabrication d’un conflit social: petits contre gros, pour éviter banques contre justice
Le secteur bancaire a une stratégie très utile. Diviser les déposants. Il met en avant la majorité des comptes qui sont modestes. Il promet de les protéger. Ensuite, il suggère que la charge doit être supportée par les “gros”.
Cette opposition paraît logique. Elle est souvent utilisée pour éviter une autre question. Combien le capital bancaire doit-il perdre. Combien de banques doivent être liquidées. Combien d’actionnaires doivent être remplacés. Combien de dirigeants doivent rendre des comptes.
Quand on transforme la réforme en guerre entre déposants, on oublie l’acteur principal. La banque. On oublie aussi l’idée centrale du capitalisme bancaire. Une banque est un intermédiaire. Elle ne peut pas transformer un déposant en investisseur forcé après coup.
Il y a une autre injustice cachée. Une partie des dépôts au-dessus des seuils n’est pas de l’argent de luxe. Ce sont des trésoreries d’entreprises. Ce sont des fonds de fonctionnement. Ce sont des caisses professionnelles. Ce sont des montants qui paient des salaires, des fournisseurs, des importations. Les frapper sans structure ne “punit pas les riches”. Cela casse l’économie réelle.
Les banques connaissent cet effet. Elles l’utilisent. Elles disent ensuite: vous voyez, l’économie souffre, donc il faut nous protéger. C’est un cercle cynique.
Le mécanisme des “titres” et des “certificats”: le remboursement qui n’en est pas un
Quand une banque ne veut pas rembourser en argent disponible, elle propose un instrument. Sur le papier, le déposant garde un droit. Dans la réalité, il reçoit un produit financier que personne ne veut acheter à sa valeur nominale.
C’est là que la décote devient invisible. Le déposant ne voit pas écrit “vous perdez 40%”. Il voit un titre de 100. Il découvre ensuite qu’il vaut 60. On lui dit que c’est “le marché”. On lui dit que c’est “la liquidité”. On lui dit que c’est “temporaire”. On lui dit enfin qu’il doit être patient.
Ce type de mécanisme est dangereux pour trois raisons. Il transfère le risque sur le déposant. Il transfère le coût du temps sur le déposant. Et il permet aux banques de prétendre qu’elles remboursent, alors qu’elles transforment une dette en papier.
Dans une réforme sérieuse, un instrument peut exister, mais il doit être garanti, encadré, transparent, et accompagné d’une contribution ferme du secteur bancaire. Sinon, il est une arme.
Le Liban risque de légaliser cette arme, parce que les banques préfèrent un remboursement fictif à une perte assumée.
La question simple que les banques veulent éviter: “combien payez-vous, vous?”
Une réforme financière doit poser une question directe au secteur bancaire. Combien contribuez-vous, en argent réel, en capital réel, et en perte de contrôle réelle.
Les banques préfèrent répondre autrement. Elles répondent par des généralités. Elles répondent par des conditions. Elles répondent par des délais. Elles répondent par la Banque du Liban. Elles répondent par l’État. Elles répondent par les déposants.
Le débat sur les pourcentages révèle le truc. Un changement de dix points dans un article peut déplacer des milliards. Un article peut écrire 20% de contribution bancaire. Un amendement peut le transformer en 10%. L’écart est immense. Pourtant, l’opinion ne suit pas l’alinéa. Elle suit le slogan.
La bataille se joue donc en silence. Dans une commission. Dans un mot. Dans une définition. Et quand la loi est votée, les banques se présentent comme “conformes”. Elles ont obtenu ce qu’elles voulaient. Une obligation faible, mais une couverture forte.
Le rôle du Parlement: protéger les banques ou protéger le contrat social
Le Parlement est au cœur de la question. Il peut imposer une hiérarchie claire des pertes. Il peut exiger que les actionnaires absorbent d’abord. Il peut exiger des audits. Il peut exiger un tri bancaire. Il peut imposer une recapitalisation dans des délais fermes. Il peut aussi imposer des sanctions.
Mais le Parlement peut aussi devenir la machine à diluer. C’est le risque le plus probable. La dilution ressemble à de la prudence. Elle ressemble à du réalisme. Elle ressemble à une gestion de crise. En réalité, elle ressemble souvent à une protection des puissants.
Un texte dilué garde des promesses, mais retire des dents. Il garde la phrase sur la protection. Il retire le calendrier ferme. Il garde le mot “audit”. Il retire la sanction. Il garde le mot “restructuration”. Il retire la liquidation des banques mortes. Il garde la rhétorique de stabilité. Il retire la justice.
Le citoyen le découvre trop tard. Il le découvre quand il demande son argent et qu’on lui répond encore par un plafond.
L’économie réelle paie déjà la facture: entreprises sans crédit, ménages sans filet
La crise bancaire n’est pas seulement une histoire de comptes. C’est une histoire de production. Sans banques fonctionnelles, le crédit disparaît. Sans crédit, les entreprises réduisent. Elles investissent moins. Elles embauchent moins. Elles paient moins. Elles importent moins. Elles ferment parfois.
Les ménages, eux, vivent sans filet. Une maladie, une inscription universitaire, une réparation majeure, et l’épargne immobilisée devient une catastrophe. Beaucoup ont été forcés de vendre des biens. D’autres ont été forcés d’émigrer. D’autres ont été forcés de dépendre de transferts de l’étranger.
Les banques répondent souvent: nous aussi, nous souffrons. Mais elles oublient une différence. Le déposant n’a pas choisi de prêter à l’État. Le déposant n’a pas choisi de jouer sur des rendements artificiels. Le déposant a choisi une banque parce qu’il croyait au contrat.
Le secteur bancaire veut que l’on oublie ce contrat. Il veut que l’on traite le dépôt comme un investissement. C’est une manipulation. Un dépôt est un droit, pas un pari.
Le piège final: légaliser l’injustice au nom d’une “entrée vers la solution”
Le danger principal aujourd’hui n’est plus le chaos. Le chaos existe déjà. Le danger est la normalisation. Une loi mal écrite peut normaliser l’injustice. Elle peut graver l’inversion des pertes. Elle peut transformer la confiscation de fait en confiscation de droit.
Les banques pousseront toujours dans ce sens, car la normalisation les protège. Une fois la loi votée, elles diront: nous appliquons. Elles diront: c’est douloureux, mais nécessaire. Elles diront: c’est le plan. Et elles continueront à exister comme cartel, avec des banques zombies et des dépôts transformés en promesses.
La sortie de crise, elle, exige une rupture. Elle exige de traiter certaines banques comme insolvables. Elle exige de remplacer des actionnaires. Elle exige de recapitaliser réellement les banques viables. Elle exige de protéger automatiquement les petites épargnes. Elle exige d’interdire les arrangements sélectifs. Elle exige enfin une transparence totale sur les pertes.
Les banques savent que cette rupture les menace. Elles utilisent donc tous les outils pour l’éviter. Le temps, la peur, le FMI, la stabilité, la division sociale, la technicité, les commissions, les amendements.
Ce n’est pas une bataille d’experts. C’est une bataille de pouvoir. Et au Liban, le pouvoir bancaire s’est construit sur une promesse. Aujourd’hui, il cherche à survivre sans la tenir, en faisant payer ceux qui ont cru.
Ce que la société devrait exiger, sans se laisser distraire
La société n’a pas besoin de discours sur la confiance. Elle a besoin de règles.
Elle doit exiger que la loi écrive une hiérarchie des pertes claire, sans ambiguïté, et sans portes de sortie. Elle doit exiger que les actionnaires paient d’abord, et que cela soit mesurable. Elle doit exiger un tri bancaire, qui élimine les banques mortes au lieu de les protéger. Elle doit exiger des délais fermes, avec sanctions. Elle doit exiger une protection automatique des petites épargnes, garantie par des sources identifiées. Elle doit exiger que la Banque du Liban et l’État cessent d’être des poubelles à pertes destinées à sauver des structures privées.
C’est seulement à ce prix que le Liban peut redevenir un pays où déposer n’est pas un acte de naïveté. Sinon, il restera un pays où la banque est un mur, et où le déposant est un otage qui paie pour que le mur reste debout.