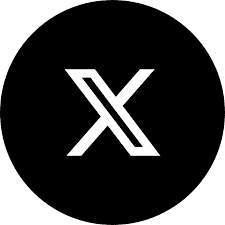Alors que le Liban entre dans sa sixième année de crise financière, la promesse de restructuration du secteur bancaire semble chaque jour plus creuse. En dépit des injonctions répétées du Fonds monétaire international et des engagements officiels des autorités, aucune mesure concrète n’a été mise en œuvre pour résoudre les déséquilibres massifs du système. Pire encore : les récentes propositions de loi sur la restructuration bancaire confortent les établissements dans une logique d’impunité. Le cœur de cette stratégie est simple : minimiser les pertes pour les actionnaires, éviter tout audit contraignant, et rejeter la majeure partie des pertes sur les déposants. Le processus, loin de restaurer la confiance, confirme l’absence de volonté de réforme structurelle.
Une dette massive, un déficit abyssal
Depuis 2019, les banques libanaises sont techniquement insolvables. Leur exposition à la dette souveraine libanaise – sous forme de bons du Trésor ou de dépôts à la Banque centrale – représente plus de 70 % de leurs actifs. Or, cette dette n’est plus remboursable. La Banque centrale, qui détient à elle seule plus de 55 milliards de dollars de passif envers les banques, n’est pas en mesure d’honorer ces montants.
Ce trou financier, qualifié de “gap” dans les rapports officiels, est estimé à plus de 68 milliards de dollars selon les chiffres consolidés de la Banque du Liban et du ministère des Finances. Ce montant, qui varie selon les hypothèses de taux de change et de valorisation des actifs, correspond à plus de trois fois le PIB du pays. Il représente l’un des plus grands effondrements bancaires relatifs au monde depuis la crise argentine.
Suivez les principaux indicateurs économiques en temps réel.
Face à cette situation, la seule solution réaliste impliquerait une restructuration complète des bilans bancaires : annulation partielle des dettes souveraines détenues, recapitalisation massive des banques par les actionnaires, et mécanismes de compensation pour les déposants les plus touchés. Or, aucune de ces étapes n’a été engagée à ce jour.
Des projets de loi conçus pour protéger les banques
Plusieurs projets de loi sur la restructuration bancaire ont été rédigés puis retirés depuis 2021. Le dernier en date, débattu en décembre 2025, illustre les priorités du secteur : éviter à tout prix de faire porter la charge de la crise aux propriétaires des banques. Ce texte, qui se présente comme une réponse aux exigences du FMI, introduit une hiérarchie des pertes qui privilégie les actionnaires au détriment des clients.
Le mécanisme proposé prévoit que les pertes soient absorbées en premier lieu par les fonds propres des banques, mais selon une évaluation interne non vérifiée. Ensuite, les gros déposants (au-delà de 100 000 dollars) seraient “convertis” en actionnaires – une forme de “bail-in” partiel, sans garanties sur la liquidité ou la valeur future de leurs titres. Aucune clause n’impose aux banques de céder des actifs immobiliers, de réduire leurs frais de gestion, ou de rendre les bonus versés avant 2019.
Ce projet ne contient par ailleurs aucune disposition sur la responsabilité pénale ou civile des administrateurs. Aucun audit obligatoire des transferts effectués entre 2019 et 2020 n’est prévu. Aucune limite n’est posée à la réouverture de comptes à l’étranger par les établissements, ni à la distribution de dividendes futurs.
Le projet de loi sur la stabilisation financière et le remboursement des dépôts, transmis au Parlement à la fin décembre 2025, a mis à nu une ligne de fracture que le pays n’arrive plus à camoufler. D’un côté, l’État cherche à encadrer par la loi une crise bancaire devenue permanente. De l’autre, les banques s’emploient à transformer une restructuration inévitable en opération de sauvetage à sens unique, où l’on protège d’abord les bilans, puis l’on explique ensuite aux déposants qu’il n’y a plus d’argent.
Un texte qui force enfin les banques à sortir du déni
Le texte vise à organiser la répartition des pertes du système financier, ce fameux « écart » qui sépare la valeur affichée des bilans et la liquidité réellement disponible. La simple existence d’un projet de loi fait trembler le secteur, parce qu’il impose un cadre. Jusqu’ici, les banques ont prospéré dans un vide juridique. Elles ont imposé des restrictions de retraits, refusé des transferts et créé des taux de change maison, sans base légale claire, en invoquant l’urgence. Le passage au Parlement menace cette zone grise.
Le secteur bancaire présente cette étape comme un risque de chaos. En réalité, il redoute surtout une normalisation. Une loi, même imparfaite, réduit l’arbitraire. Elle oblige à définir des catégories de dépôts, des calendriers, des priorités, des responsabilités. Autrement dit, elle empêche de continuer à gérer la crise au guichet, au cas par cas, et souvent au profit des mieux informés.
Le plaidoyer des banques, ou l’art de renverser la culpabilité
Les établissements ont répliqué par un argumentaire rodé. Ils affirment qu’aucune étude crédible ne soutient le projet et que les chiffres nécessaires à son application ne sont pas établis. Ils soutiennent aussi que l’État refuse de reconnaître ses dettes envers la Banque centrale, et que cette omission gonfle artificiellement le déficit. Ils dénoncent enfin une attaque contre leurs fonds propres, comme si le but du texte était de « détruire » le secteur bancaire. Le message est clair : les banques se présentent en victimes.
Cette rhétorique omet l’essentiel. Le problème n’est pas que les banques soient soudainement visées par un texte sévère. Le problème est qu’elles ont fait de la crise un modèle de gestion. Depuis 2019, elles ont gelé des dépôts, dégradé leur valeur par des conversions défavorables, et maintenu des opérations sélectives. Elles ont prétendu protéger la « stabilité », tout en transférant le coût de l’effondrement sur les clients ordinaires.
Des bilans gonflés, une intermédiation morte
La situation comptable du secteur illustre la profondeur du mal. À la fin novembre 2025, les dépôts du secteur privé atteignaient 87,7 milliards de dollars, tandis que les actifs consolidés des banques avoisinaient 101,8 milliards de dollars. Sur le papier, ces montants donnent l’image d’un secteur encore massif. Mais dans les faits, l’intermédiation est atrophiée. Les prêts au secteur privé en devises ne représentaient plus qu’environ 5,3 milliards de dollars, en baisse par rapport à 2024. Autrement dit, la banque ne finance plus l’économie, elle administre des comptes prisonniers.
Cette contradiction n’est pas un accident. Elle est le produit d’un choix stratégique. Pendant des années, une large part de l’activité bancaire a consisté à recycler des dépôts vers des placements auprès de la Banque centrale et vers de la dette publique, attirés par des rendements élevés. Ce modèle a offert des profits faciles tant que la machine tournait. Quand elle s’est brisée, les banques ont découvert qu’elles étaient prisonnières de leur propre dépendance à l’État et à la Banque centrale. Elles demandent désormais que l’on oublie cette stratégie, comme si elle n’avait été qu’une fatalité.
Le refus de l’audit, la ligne rouge qui trahit tout
Une restructuration sérieuse commence par un diagnostic partagé. Or, le secteur bancaire conteste l’idée même d’un chiffrage contraignant. Il réclame des études, mais refuse la transparence sur ses propres positions, sur la qualité de ses actifs, et sur les mouvements opérés avant et après le début de la crise. C’est la contradiction centrale : les banques exigent une base chiffrée tout en combattant les instruments qui permettraient de l’établir.
Cette résistance n’a rien de théorique. Sans audit robuste, la hiérarchie des pertes devient un jeu d’écriture. Les banques peuvent surévaluer certains actifs, minimiser certaines expositions, et plaider l’impossibilité de rembourser les déposants. Elles peuvent aussi déplacer le débat vers la responsabilité exclusive de l’État, en oubliant qu’elles ont construit leur stratégie autour de ce même État.
La question des « anomalies », ou la bataille des mots
Le projet de loi évoque des catégories de dépôts ou d’opérations qui seraient reclassées, avec l’idée de distinguer ce qui relève d’un dépôt classique et ce qui ressemble à une opération de rendement atypique. Les banques rejettent ce principe. Elles dénoncent une tentative de charger leur capital d’« anomalies » au lieu de réduire d’abord le déficit global.
Le débat technique masque une réalité politique : la crise a créé des gagnants et des perdants. Les banques veulent figer la définition du dépôt de manière à limiter toute remise en cause de certaines opérations, y compris celles qui ont servi à attirer des fonds à des taux déraisonnables. Elles redoutent qu’un tri des dépôts révèle une asymétrie, où les petits comptes ont été enfermés tandis que des circuits mieux informés ont su se protéger.
La dette de l’État, l’argument vrai mais incomplet
Les banques insistent sur la dette de l’État envers la Banque centrale. L’argument est fondé : l’État a longtemps financé ses déficits en puisant dans le système financier, et une partie de la perte a été logée dans les bilans de la Banque centrale. Mais utiliser cette vérité pour effacer la responsabilité bancaire relève de la diversion.
Les banques ont choisi ce modèle. Elles ont accepté la concentration de leurs actifs sur l’État et sur la Banque centrale, parce que cela promettait des rendements. Elles ont entretenu la fiction de la stabilité en continuant à attirer des dépôts, tout en sachant que la soutenabilité du schéma se dégradait. Lorsque l’édifice s’est effondré, elles ont imposé un contrôle des capitaux de facto, sans loi, sans égalité et sans recours simple.
L’échelle de la crise, visible jusque sur les marchés
Le marché obligataire illustre, à sa manière, l’état du pays. Début janvier 2026, les prix de certaines obligations souveraines ont bondi, passant d’environ 23 cents à 27,5 cents pour un dollar de valeur faciale, leur plus haut niveau depuis le défaut de mars 2020. Ce mouvement ne dit pas que le Liban va mieux. Il dit que certains investisseurs spéculatifs parient sur une restructuration, sur un accord, ou sur un rapport de force favorable. Cette hausse a été alimentée par un effet de contagion sur les dettes en détresse, et par l’idée qu’un cadre législatif pourrait enfin émerger.
Dans le même temps, le marché actions local est resté fragile. L’indice a reculé d’environ 4,2 % sur la semaine, et les volumes échangés se sont tassés autour de 2,7 millions de dollars, contre 6,6 millions la semaine précédente. Le pays offre donc une image paradoxale : un frémissement spéculatif sur la dette, et une économie réelle toujours incapable d’attirer des capitaux productifs.
Les banques face au dilemme : accepter la perte ou prolonger la confiscation
La réalité est simple : une partie des dépôts ne peut pas être remboursée à la valeur nominale, parce que les actifs correspondants ont été consommés, dépréciés ou rendus illiquides. La question est de savoir qui porte la perte, et dans quel ordre. Les banques veulent convaincre que toute perte portée par elles détruirait le secteur. Elles proposent souvent de préserver au maximum leur capital, au nom d’une reprise future, et de compenser les déposants par des mécanismes longs, incertains, parfois indexés sur des recettes futures.
Ce raisonnement revient à demander aux déposants d’être la variable d’ajustement permanente. Il ignore une règle élémentaire : dans toute crise bancaire, les actionnaires supportent les pertes avant les créanciers non garantis. Or, au Liban, la logique a été inversée. Les déposants ont été frappés en premier, par des restrictions et des décotes. Les actionnaires, eux, n’ont pas été forcés à recapitaliser, ni à abandonner le contrôle.
Le mirage de la « protection des déposants » brandi par les banques
Les banques affirment vouloir protéger les déposants, tout en réclamant que l’on protège d’abord le secteur bancaire. La formule est habile, mais elle est creuse. Protéger les déposants signifie leur rendre une partie significative de leurs fonds, selon des règles transparentes, dans des délais connus, avec un traitement égal. Or, depuis 2019, le déposant libanais a surtout reçu des plafonds, des taux arbitraires et des promesses.
Le secteur bancaire cherche à transformer une crise de solvabilité en crise de liquidité. Il préfère parler de manque temporaire de dollars, comme si le temps et la croissance suffisaient à reconstituer les bilans. Mais les chiffres disponibles indiquent une contraction durable de l’activité bancaire. Les actifs reculent, les dépôts se rétractent, les prêts fondent. Ce n’est pas une panne passagère. C’est la conséquence d’un modèle qui a surexploité la confiance jusqu’à la rupture.
La Banque centrale, partenaire et alibi
La Banque centrale annonce des démarches judiciaires pour récupérer des fonds détournés et des sommes mal utilisées, en promettant que toute récupération constituerait une source de liquidité pour rembourser les déposants. L’initiative peut paraître salutaire. Mais elle ne résout pas le cœur du problème : l’ampleur des pertes dépasse de loin ce que des procédures, même ambitieuses, peuvent ramener à court terme.
De plus, la Banque centrale a révisé la présentation de son bilan, en modifiant certaines classifications pour ne retenir que des actifs étrangers liquides dans une rubrique dédiée. Cette clarification peut améliorer la lecture, mais elle ne crée pas de dollars supplémentaires. Les réserves de change liquides se situaient autour de 11,89 milliards de dollars à la fin décembre 2025, quand la valeur des réserves d’or dépassait 40,4 milliards de dollars. L’or rassure, mais il ne paie pas les factures, et il ne remplace pas une restructuration.
Le vrai enjeu du texte : réintroduire l’égalité là où les banques ont organisé l’exception
Le projet de loi, malgré ses lacunes, a une vertu : il tente de réintroduire un principe d’égalité, en définissant des catégories et des règles. C’est ce que le secteur bancaire redoute. Tant que l’exception règne, les banques gardent la main. Elles peuvent négocier au cas par cas, favoriser certains clients, éteindre certaines contestations, et repousser le règlement global.
C’est aussi pour cela que la bataille se joue sur les chiffres. En contestant la méthode, les banques gagnent du temps. Elles espèrent que le texte sera amendé, dilué, ou renvoyé à des commissions sans fin. Chaque mois gagné est un mois où la confiscation continue, où les déposants s’usent, où l’opinion se fatigue.
Une restructuration crédible implique de toucher aux actionnaires et à la gouvernance
Une issue crédible suppose trois étapes. D’abord, un audit consolidé, imposé et publié, sur les bilans, les expositions et les mouvements clés de la période de crise. Ensuite, une reconnaissance de pertes, avec une recapitalisation réelle ou une résolution ordonnée des banques insolubles, incluant des fusions, des liquidations et des changements d’actionnariat. Enfin, un mécanisme de restitution des dépôts qui protège en priorité les petits et moyens déposants, sans transformer les comptes en loterie.
Les banques s’opposent à cette logique, parce qu’elle touche au cœur de leur pouvoir. Elles préfèrent un compromis où la perte est étalée, invisibilisée et, autant que possible, transférée vers les déposants, sous forme de décotes et de délais. C’est une stratégie de survie institutionnelle, pas une stratégie de relance économique.
Dans ce dossier l’argument de la “préservation du secteur” sert à éviter la question des responsabilités. Qui a validé les placements à risque ? Qui a fermé les yeux sur les sorties ? Sans réponses la réforme restera une mise en scène.
Au Parlement, l’examen du texte ouvre une bataille d’amendements. Des élus, liés à des intérêts bancaires, pourraient affaiblir les articles les plus contraignants, ou renvoyer l’essentiel à des décrets. Le calendrier des commissions, et la pression des créanciers, pèseront sur l’issue et sur le sort concret des dépôts familiaux.