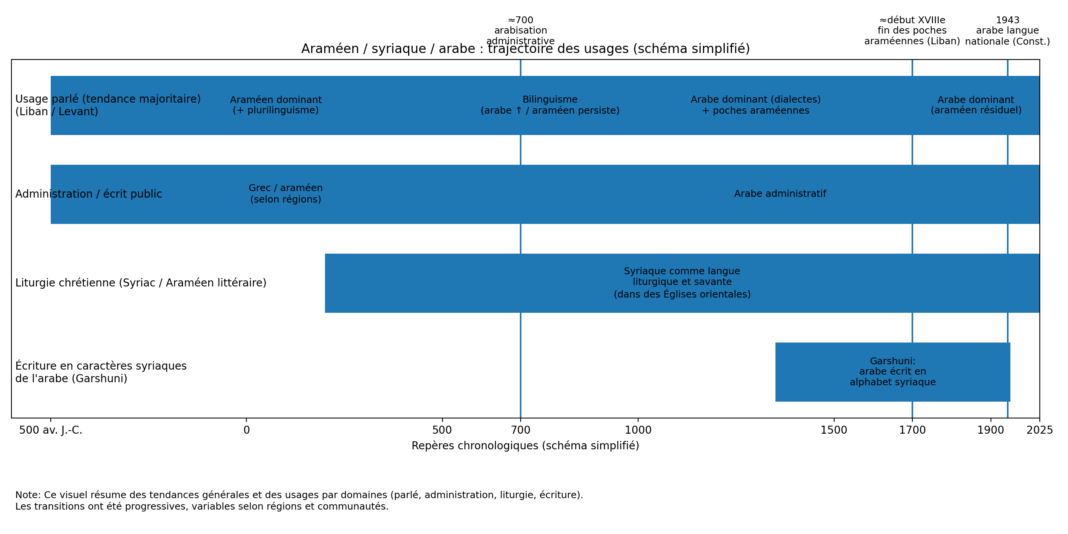La fracture la plus durable: deux Libans bancaires, deux droits
La crise bancaire a créé une inégalité plus profonde que la perte de valeur. Elle a fabriqué deux catégories de citoyens. D’un côté, ceux qui ont réussi à faire sortir une partie de leurs fonds, à convertir au bon moment, ou à obtenir des arrangements. De l’autre, ceux qui sont restés prisonniers d’un compte devenu une promesse.
Ce clivage n’est pas tombé du ciel. Il est né d’un fait simple. Les banques ont imposé des restrictions de fait, sans cadre légal clair, et elles ont appliqué ces restrictions de manière inégale. Cette inégalité n’a pas besoin d’être écrite pour être réelle. Elle s’observe dans les parcours. Elle s’observe dans les autorisations. Elle s’observe dans les “exceptions”. Elle s’observe aussi dans l’épuisement de ceux qui n’avaient ni relations ni levier.
Le plus grave est que cette inégalité s’est normalisée. Elle s’est transformée en habitudes. Elle a pris la forme de procédures internes. Elle a aussi pris la forme d’un langage qui cache ce qu’il fait. On parle de “priorité”, de “cas humanitaire”, de “besoin urgent”. On parle de “règle générale”. Puis, à l’intérieur, on décide autrement.
Le déposant moyen n’a pas seulement perdu de l’argent. Il a perdu l’idée que la banque applique la même règle à tous. Quand cette idée meurt, le contrat social se fissure. Ensuite, l’économie se replie. Enfin, l’État devient encore plus fragile, car la confiance minimale disparaît.
L’absence de contrôle des capitaux: le vide qui a permis toutes les inégalités
Dans une crise bancaire, un État sérieux agit vite. Il impose un contrôle des capitaux légal, limité dans le temps, transparent, et contrôlable. Il fixe des plafonds, des priorités, des recours, et des sanctions. Il protège la majorité, et il empêche la sélection arbitraire.
Au Liban, ce cadre n’a pas existé au moment où il fallait. Les restrictions ont été appliquées en pratique, sans loi claire. Cela a offert aux banques un pouvoir discret, mais gigantesque. Elles ont pu choisir. Elles ont pu ralentir. Elles ont pu accélérer. Elles ont pu autoriser des transferts. Elles ont pu les refuser. Elles ont pu invoquer la “politique interne”, puis se cacher derrière le “système”.
Cette situation a créé une zone grise. Et dans une zone grise, le plus fort gagne. Le plus fort, ici, n’est pas le déposant. Ce n’est pas la petite entreprise. Ce n’est pas le salarié. Le plus fort, c’est celui qui a un accès direct à un décideur, celui qui menace de procès, celui qui a un compte à l’étranger, celui qui a des relations politiques, celui qui peut “négocier” un chemin.
La zone grise a aussi permis une chose très importante. Elle a rendu l’injustice difficile à prouver. Sans loi, il est plus difficile de démontrer une violation précise. Sans règle publiée, il est plus difficile de montrer une discrimination formelle. Et quand il est difficile de prouver, il est facile de nier.
Les banques ont donc bénéficié d’un vide juridique. Ce vide a servi de bouclier. Il a aussi servi de moteur à la sélection.
La mécanique de la sélection: comment on ouvre la porte sans dire qu’on l’ouvre
La sélection ne se fait pas toujours par un “oui” officiel. Elle se fait souvent par un “oui” discret, puis par un “non” silencieux aux autres.
La méthode la plus simple consiste à créer des catégories de transferts. Certains transferts sont autorisés rapidement, parce qu’ils sont présentés comme essentiels. D’autres sont renvoyés à des listes d’attente. D’autres sont bloqués sans explication claire. Dans cette architecture, il suffit qu’une banque accepte de qualifier un dossier comme “urgent” pour qu’il passe, et qu’elle refuse cette qualification pour qu’il meure.
Une deuxième méthode consiste à jouer sur la documentation. On exige des pièces supplémentaires. On ajoute des étapes. On renvoie le client. On demande une signature. On demande une approbation. Chaque étape peut être appliquée strictement à certains et souplement à d’autres. L’arbitraire se cache dans le rythme.
Une troisième méthode consiste à proposer un arrangement individuel. Le client reçoit une option. Elle semble généreuse, mais elle est souvent coûteuse. Il accepte de récupérer une fraction, à condition de renoncer à des droits, ou à condition d’accepter une décote. Le client est épuisé, il accepte. À côté, un client influent obtient une option différente. Et comme tout est individuel, il n’y a pas de comparaison visible.
Une quatrième méthode, plus subtile, est le marché interne. Certains instruments deviennent échangeables. Des chèques deviennent vendables avec une décote. Des conversions deviennent possibles. La banque peut prétendre qu’elle ne discrimine pas, car elle “offre un mécanisme”. En réalité, ce mécanisme favorise celui qui a des marges et pénalise celui qui n’en a pas.
Au final, la banque ne dit jamais “vous n’avez pas les mêmes droits”. Elle crée simplement un environnement où le droit dépend de la capacité à supporter la perte.
Les chiffres qui expliquent la violence sociale: majorité en nombre, minorité en valeur
La structure des dépôts rend la sélection encore plus explosive. Une large majorité de comptes correspond à des montants modestes. Une minorité de comptes concentre une grande partie de la masse financière. Cette réalité nourrit deux discours opposés, et les banques jouent avec les deux.
On peut retenir des ordres de grandeur discutés dans le pays en 2025. Environ 782.000 comptes seraient sous 100.000 dollars, pour environ 14,8 milliards de dollars. Au-dessus de 100.000 dollars, environ 145.000 comptes totaliseraient environ 67,4 milliards. La répartition est claire. La majorité sociale se trouve dans la première tranche. La majorité financière se trouve dans la seconde.
Cette configuration permet un piège. On calme la majorité en nombre avec une promesse de protection jusqu’à un seuil. Ensuite, on traite la masse principale avec des mécanismes longs, des instruments, des décotes déguisées, ou des arrangements. Le public retient la promesse. Le coût réel se joue ailleurs.
La sélection s’insère ici. Dans la tranche supérieure, les montants sont tels que la banque a intérêt à négocier au cas par cas. Un seul dossier représente parfois une somme équivalente à des milliers de petits comptes. Cela attire la pression, et cela attire aussi les privilèges.
Le pays se retrouve ainsi avec une impression collective de trahison. Beaucoup voient des “sorties” dont ils n’ont pas bénéficié. Ils voient aussi des refus pour des besoins essentiels. Ils concluent donc que la banque n’est plus une institution, mais un filtre social.
La promesse “100.000 dollars”: une mesure populaire qui peut masquer une injustice persistante
La promesse la plus répétée est simple. Protéger les dépôts jusqu’à 100.000 dollars. Présentée ainsi, elle semble juste. Elle parle à beaucoup de gens. Elle est aussi facile à utiliser politiquement.
Mais une promesse n’est pas un droit. Elle ne vaut que par trois éléments. Le calendrier. La source de financement. Les sanctions en cas de non-exécution.
Si l’on retient la masse de 14,8 milliards sous le seuil, une restitution en quatre ans exige environ 3,7 milliards de dollars par an. Cela représente un peu plus de 300 millions par mois. Ce chiffre n’est pas une opinion. C’est une contrainte. Si la loi ne verrouille pas qui paie et comment, la promesse devient une anesthésie.
Les banques aiment l’anesthésie. Elle réduit la colère. Elle prépare l’acceptation d’une autre réalité, plus dure, sur la tranche supérieure. Elle permet aussi de faire passer des amendements en silence, car l’opinion croit que l’essentiel est acquis.
La sélection réapparaît ici. Une promesse sans automatisme laisse de l’espace. Et dans cet espace, on choisit. On paie certains avant d’autres. On accélère certains dossiers. On ralentit d’autres. On crée des “priorités”. On recrée, sous un vocabulaire de protection, une hiérarchie arbitraire.
Le danger est donc paradoxal. Une mesure conçue pour rassurer peut devenir un outil pour prolonger l’injustice, si elle n’est pas écrite comme un droit strict, appliqué de manière mécanique.
La tranche au-dessus de 100.000 dollars: la zone où la décote se cache dans le temps
Le cœur de la crise ne se joue pas seulement dans la tranche inférieure. Il se joue dans la tranche supérieure, parce qu’elle porte l’essentiel de la masse. C’est là que les banques tentent d’imposer des instruments longs, des certificats, ou des mécanismes qui transforment un dépôt en papier.
Le principe est simple. Un dépôt est un droit de retrait. Un instrument est un droit conditionnel. Il dépend de la liquidité, de la confiance, et de la valeur de marché. Le déposant n’a pas choisi ce risque. Il l’absorbe malgré lui.
Sur une base de 67,4 milliards au-dessus du seuil, une décote implicite est un séisme social. Si un instrument se négocie à 70% de sa valeur nominale, la perte implicite dépasse 20 milliards. À 50%, elle approche 34 milliards. Dans la vie réelle, cette perte se traduit par des entreprises qui réduisent, des investissements annulés, des importations bloquées, et des ménages qui se retrouvent sans filet.
Les banques préfèrent ce mécanisme pour une raison simple. Il évite une décision claire. Il évite un haircut assumé. Il évite aussi une responsabilité juridique directe. Elles peuvent dire qu’elles ont “rendu” quelque chose. Elles ont rendu du papier. Le déposant, lui, perd en valeur.
La sélection se greffe sur cette zone. Ceux qui ont besoin de liquidité immédiate acceptent souvent une décote plus forte. Ceux qui peuvent attendre gardent l’instrument. Ceux qui ont des relations obtiennent des options plus favorables. Le résultat est une hiérarchie cachée, mais réelle.
L’argument de la stabilité: le chantage qui protège le cartel bancaire
Chaque fois qu’on demande une règle claire, les banques répliquent par la même peur. Si vous imposez trop, vous cassez le système. Si vous obligez les banques à payer, vous cassez la confiance. Si vous punissez les banques, vous cassez l’économie.
Ce raisonnement est inversé. Le système est déjà cassé. La confiance est déjà détruite. L’économie fonctionne déjà en cash, avec un crédit réduit et une méfiance généralisée. Ce que les banques appellent stabilité, c’est souvent la conservation de leurs structures et de leurs licences, même quand elles ne remplissent plus leur fonction.
Le chantage sert à éviter la seule solution durable. La restructuration réelle. Elle implique un tri des banques, des fermetures ordonnées, des recapitalisations avec capital frais, et parfois des changements de contrôle. Elle implique aussi que les actionnaires absorbent avant les déposants. C’est la logique du risque. C’est aussi ce que le cartel bancaire veut empêcher.
La sélection des sorties est liée à ce chantage. Tant que les banques évitent une restructuration, elles gardent un pouvoir. Elles peuvent faire des exceptions. Elles peuvent négocier. Elles peuvent choisir. Elles peuvent aussi prolonger le temps, et le temps fait payer.
La stabilité invoquée est donc une stabilité de domination. Elle protège l’arbitraire. Elle protège la sélection. Elle ne protège pas le déposant.
La guerre des pourcentages: comment un amendement peut transformer une injustice en loi
Dans le débat législatif, tout se joue dans des paramètres. Un pourcentage de contribution bancaire. Une durée d’étalement. Une définition. Une date de référence. Une sanction. Ces détails peuvent déplacer des milliards.
Sur une masse de 67,4 milliards, une contribution bancaire de 10% représente environ 6,7 milliards. À 20%, environ 13,5 milliards. À 40%, environ 27 milliards. La différence entre 10% et 20% dépasse 6 milliards. Ce sont des montants qui peuvent changer la vie économique.
Les banques cherchent à réduire ces contributions, puis à étaler sur des périodes longues. Elles transforment ainsi une obligation en flux annuel “supportable”. Pourtant, étaler ne crée pas de solvabilité. Une banque insolvable aujourd’hui reste insolvable. Étaler évite le choc. Il évite aussi le tri. Et sans tri, la sélection continue.
La loi peut donc normaliser la sélection. Si elle impose des obligations faibles, les banques continueront à négocier au cas par cas. Elles continueront à choisir. Elles continueront à préserver les plus connectés. Elles continueront à abandonner les autres au temps.
C’est ici que le Parlement est responsable. Une loi qui laisse des portes de sortie ne réforme pas. Elle légalise l’arbitraire en lui donnant une façade.
La Banque du Liban comme tampon: l’option confortable qui fait payer le public
Quand les banques veulent réduire leur contribution, elles cherchent un tampon. Ce tampon est souvent la Banque du Liban. L’idée est simple. Les pertes seraient “dans” la banque centrale. Donc la banque centrale doit “absorber”. Ensuite, l’État peut “aider”. Au final, la société paie par la monnaie, par l’inflation, ou par des années de stagnation.
Sous Karim Souaid, la Banque du Liban est au centre de cette tension. Si elle accepte d’être le sac où l’on jette tout, elle protège le cartel bancaire. Elle peut stabiliser un instant, mais elle fragilise la monnaie et l’État. Si elle refuse, elle force une confrontation, mais elle peut reconstruire une discipline.
La sélection des sorties se nourrit de ce rôle de tampon. Tant que le tampon existe, les banques peuvent retarder. Elles peuvent dire que la solution dépend d’une architecture globale. Elles peuvent continuer à gérer au cas par cas. Elles peuvent maintenir des banques zombies, qui survivent sans capital frais, tout en continuant à contrôler la vie des déposants.
L’option du tampon est donc un piège politique. Elle donne l’illusion d’un plan. Elle évite la justice économique. Elle maintient l’inégalité. Et elle fait payer ceux qui n’avaient déjà plus de marge.
L’économie du cash: la conséquence directe de la sélection et de l’arbitraire
Quand un déposant comprend qu’il n’a pas un droit mais une faveur, il change de comportement. Il retire dès qu’il peut. Il refuse de déposer. Il garde du cash. Il utilise des circuits parallèles. Il traite la banque comme un risque, pas comme une protection.
C’est ce que le pays a vécu. Le cash a pris une place centrale. Ce basculement a un coût précis, même si on ne le chiffre pas ligne par ligne. Le cash augmente les coûts de transaction. Il augmente les risques de vol. Il facilite l’informel. Il réduit la base fiscale. Il favorise des pratiques de corruption. Il rend aussi plus difficile le financement des entreprises.
L’économie du cash accentue l’inégalité. Ceux qui ont accès à l’extérieur peuvent se protéger. Ceux qui n’ont que le système local deviennent vulnérables. Ils paient plus cher. Ils perdent du temps. Ils vivent dans une économie plus risquée.
Les banques, paradoxalement, restent centrales malgré tout. Elles sont encore une porte d’accès à des services, à des paiements, à des formalités. Elles gardent donc un pouvoir. Et ce pouvoir, elles l’utilisent pour prolonger une sélection qu’elles ont installée au début de la crise.
Les “solutions” individuelles: le laboratoire de la discrimination moderne
Une réforme devrait créer une règle collective. Elle devrait réduire la place des arrangements individuels. Pourtant, le système libanais a fait l’inverse. Il a multiplié les solutions individuelles. Et ces solutions ont amplifié la discrimination.
Un arrangement individuel peut sembler utile. Il permet à un déposant de récupérer une partie. Il peut aider une famille. Il peut sauver une entreprise. Mais, à l’échelle d’un pays, il détruit l’idée de justice. Il remplace un droit par une négociation. Et dans une négociation, le plus fort gagne.
Les banques ont utilisé cette logique. Elles ont offert des options, parfois sous forme de décote, parfois sous forme de chèque, parfois sous forme de conversion. Elles ont aussi utilisé l’épuisement comme levier. Un client fatigué accepte. Un client influent obtient mieux. Un client sans levier abandonne.
La sélection n’est donc pas seulement un acte ponctuel. C’est une architecture. Elle transforme la banque en distributeur d’avantages, pas en institution de confiance.
La réforme doit casser cette architecture. Elle doit imposer des règles automatiques. Elle doit réduire les exceptions. Elle doit imposer des sanctions si la banque discrimine. Sans cela, l’inégalité devient permanente.
Le point que les banques veulent effacer: l’ordre normal des pertes
La crise a été un test de capitalisme. Dans un système normal, le capital absorbe avant le déposant. Les actionnaires prennent le risque. Ils encaissent quand ça va bien. Ils paient quand ça va mal.
Au Liban, l’inversion a dominé. Les déposants ont payé d’abord. Ils ont payé par la restriction. Ils ont payé par la dévaluation. Ils ont payé par le temps. Les actionnaires ont souvent gardé le contrôle. Le secteur a évité le tri. Il a évité la fermeture. Il a évité une restructuration qui change réellement les propriétaires.
La sélection des sorties est un produit direct de cette inversion. Si le capital avait été frappé tôt, la banque aurait été obligée de se recapitaliser ou de disparaître. Elle n’aurait pas eu le temps d’organiser des sorties sélectives. Elle n’aurait pas eu le pouvoir de filtrer.
La réforme doit donc revenir à cette hiérarchie. Sinon, elle ne répare rien. Elle légalise une injustice et elle prépare la prochaine crise.
Ce que la loi devrait verrouiller pour empêcher la sélection, sans ajouter un nouveau labyrinthe
Une réforme qui protège réellement doit être simple dans ses principes et ferme dans ses mécanismes.
Elle doit définir clairement ce qui est protégé, et elle doit l’appliquer automatiquement. Elle doit fixer un calendrier ferme, avec des versements réguliers, sans négociation. Elle doit dire qui paie et dans quelle proportion, et elle doit rendre cette contribution obligatoire, pas conditionnelle.
Elle doit aussi imposer une transparence comptable. Sans photographie claire des bilans, la sélection continuera. Elle doit classer les banques, imposer des recapitalisations avec capital frais, et fermer les banques mortes de manière ordonnée. Tant que les banques zombies survivent, elles continuent à choisir qui respire.
Elle doit enfin rendre illégales les sorties sélectives, et elle doit prévoir des sanctions réelles. Une banque qui autorise un transfert pour un client influent, tout en bloquant les autres, doit être sanctionnée. Sans sanction, la règle reste un décor.
Le plus dangereux serait de répondre à la sélection par un labyrinthe administratif. Une procédure trop lourde crée une nouvelle sélection. Ceux qui ont les moyens naviguent. Les autres se perdent. La loi doit donc être lisible. Elle doit réduire le pouvoir discrétionnaire. Elle doit rendre l’exécution mécanique.
La fracture restera tant que le pays acceptera le “cas par cas” comme politique
La crise bancaire a laissé une cicatrice plus profonde que l’effondrement monétaire. Elle a installé l’idée que la justice dépend du contact, de la relation, du dossier, du réseau. Cette idée détruit la cohésion.
Les banques ont construit leur survie sur cette idée. Elles ont remplacé le droit par le cas par cas. Elles ont remplacé la règle par l’exception. Elles ont remplacé la responsabilité par le flou. Elles ont ensuite présenté ce flou comme de la prudence.
Le pays ne sortira pas de la crise tant que cette logique restera dominante. Une économie ne peut pas redémarrer avec des banques qui ne fonctionnent que comme guichets de sélection. Une société ne peut pas tenir avec des déposants traités comme des otages pendant que d’autres sortent par la porte arrière.
La réforme n’est donc pas seulement un texte financier. C’est une décision de justice. Elle dira si la sélection devient une parenthèse honteuse, ou si elle devient une norme libanaise.