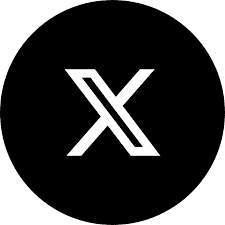« Interdit de les reporter »: une ligne rouge posée au sommet de l’État
Le signal a été envoyé sans détour. Joseph Aoun a tranché la question avant même qu’elle ne revienne, en la formulant comme un interdit politique et constitutionnel: « Il est interdit de les reporter, et il est interdit de ne pas les organiser. C’est une échéance constitutionnelle, sans discussion. Le rôle du président est de garantir sa date, sa transparence et sa sécurité, rien de plus. »
Ce choix de mots n’est pas anodin. Il ferme la porte aux demi-mesures. Il s’adresse au public, bien sûr. Mais il vise aussi les institutions. Il vise surtout ceux qui savent, au Liban, transformer une contrainte en querelle de procédure.
Le président lie d’ailleurs cette fermeté à une lecture très pratique. Il rappelle que l’appareil d’État a déjà résisté à une tentative de « faire tomber » un scrutin. Il évoque le précédent des municipales, en expliquant qu’il y a eu une tentative d’empêcher l’échéance, mais que la décision a été tenue, « avec le ministre de l’Intérieur et le Premier ministre », jusqu’à l’organisation effective du vote.
Comparez rapidement les prix des vols avec Fly2Leb.
La tentation du « technique »: le mot qui peut tout déplacer
L’argument le plus dangereux n’est pas le sabotage frontal. C’est le glissement “raisonnable”. Il porte un nom commode: le report technique. Ce terme se présente comme neutre. Il prétend protéger l’élection. Il peut, en réalité, la déplacer.
À ce stade, il suffit d’une polémique sur une formalité. Une contestation de délai. Un débat sur des décrets d’application. Ou une controverse sur le vote à l’étranger. Le pays n’a même pas besoin de dire « je reporte ». Il lui suffit de dire « je ne peux pas ». Et, dans cette logique, le “technique” devient politique par excellence.
Joseph Aoun tente précisément de désamorcer cette mécanique. Il insiste sur l’idée qu’il existe déjà « une loi électorale en vigueur ». Il ajoute que le gouvernement a fait sa part. Et il renvoie, presque sèchement, au Parlement la responsabilité de finir le travail: « Le gouvernement a accompli ses devoirs. Il a présenté un projet de loi. C’est au Parlement de faire ce qu’il doit faire. »
Ce passage est révélateur. Il ne s’agit pas d’un commentaire. C’est une mise en cause préventive. L’exécutif annonce qu’il ne portera pas seul la charge d’un éventuel blocage.
Le Parlement, juge de paix… et suspect habituel
Au Liban, les élections ne sont pas seulement un rendez-vous démocratique. Elles sont une épreuve de discipline institutionnelle. Le gouvernement organise. L’administration exécute. Les forces de sécurité protègent. Mais la chambre peut, par inertie ou calcul, ralentir la machine.
La phrase présidentielle sur le rôle du Parlement est donc centrale. Elle déplace le projecteur. Et elle pose une question simple: qui assume le calendrier? Car le risque le plus classique n’est pas la crise ouverte. C’est l’usure, la lenteur, l’enlisement.
Ce risque est d’autant plus aigu que la scène politique est déjà chauffée. Des responsables parlementaires multiplient les messages de mobilisation et d’alignement. Ainsi, le député Ali Khreiss appelle « l’État et les partis » à « faire front face aux dangers », en insistant sur l’unité et la fermeté face aux menaces israéliennes.
Ce type de discours rappelle que l’agenda électoral se déroule dans un climat de tension nationale. Or, quand la tension monte, la moindre querelle de procédure se transforme en combat de récit. Et le combat de récit, au Liban, finit souvent par retarder l’action.
Le vote des expatriés: un symbole politique devenu point de friction
Le dossier des expatriés est un révélateur. Sur le fond, il n’est pas présenté comme une option. Il est posé comme un droit. Joseph Aoun appelle explicitement les Libanais de l’étranger à « participer à la décision politique ».
Cette phrase semble consensuelle. Pourtant, elle ouvre un champ de dispute. Car le vote des expatriés n’est jamais seulement technique. Il touche au rapport de force. Il touche aux campagnes. Il touche aussi à la légitimité, car chacun revendique “son” Liban de l’étranger.
Dès lors, un dossier administratif peut devenir une arme politique. Il suffit d’affirmer qu’il manque une base réglementaire. Ou qu’une procédure n’est pas prête. Ou que la logistique ne suit pas. Et l’argument du report réapparaît sous une forme “responsable”.
Le président répond à cela par une ligne de continuité: l’élection se tient, et le rôle de la présidence se limite à garantir le cadre. Il refuse, dans le même mouvement, d’être soupçonné de manipuler l’issue. Son message est net: « Je n’ai pas de parti politique. Je ne vise pas à poursuivre une carrière politique après cinq ans. Mon rôle est de garantir l’élection à sa date constitutionnelle, sa sûreté, sa sécurité et sa transparence. »
Cette posture vise à couper court à un soupçon classique: celui d’un président qui fabrique une majorité. Elle vise aussi à rassurer l’extérieur, alors que la question du calendrier électoral revient dans les échanges avec des partenaires internationaux.
« Arbitre, pas partie »: la neutralité comme stratégie, et comme contrainte
La scène libanaise adore les paradoxes. Quand un président affirme ne pas être “partie”, on lui demande aussitôt de trancher. Joseph Aoun résume lui-même cette tension, en rappelant une définition institutionnelle: « Le président de la République est un arbitre, et il ne doit pas être partie. »
Cette formule est élégante. Elle est aussi risquée. Car une élection, surtout législative, transforme chaque décision en signal. Garantir la sécurité, c’est décider où l’État met ses moyens. Garantir la transparence, c’est décider comment l’administration encadre. Garantir la date, c’est décider comment on résiste aux demandes de “décalage”.
Autrement dit, la neutralité proclamée n’efface pas l’impact réel. Elle impose seulement une discipline. Elle exige un langage sobre. Elle exige une procédure lisible. Et elle exige un refus de toute ambiguïté, au moment où la tentation du report peut revenir.
Le précédent des municipales: la preuve par l’exécution
L’argument le plus solide du moment n’est pas une déclaration. C’est un précédent. Joseph Aoun rappelle le scrutin municipal et le climat qui l’entourait. Il raconte qu’il y a eu une tentative d’empêcher le vote, mais qu’il a été maintenu, par une décision politique assumée et exécutée.
Ce rappel sert à deux choses. D’abord, à dire que la machine administrative peut fonctionner. Ensuite, à montrer que l’exécutif sait tenir une ligne quand la pression monte.
Dans la même logique, le président insiste sur la nécessité de produire les textes d’application “maintenant”, afin de ne pas laisser un vide exploitable. Il parle de “décrets d’application conformément à la loi existante”.
Cette urgence est un signal envoyé au Parlement. Le sous-texte est clair: ne venez pas expliquer, à la dernière minute, que le temps manque.
Une campagne sous tension: quand la sécurité devient un argument électoral
Même si le scrutin n’a pas encore commencé sur le terrain, le contexte sécuritaire le précède. Des discours parlementaires insistent déjà sur l’unité et sur les menaces. D’autres voix rappellent le rôle central de l’armée et la question du déploiement au Sud.
Cette atmosphère a deux effets. Elle peut mobiliser. Elle peut aussi justifier des demandes de “précaution”, donc de report. C’est ici que la phrase « interdit de les reporter » prend toute sa valeur. Elle vise précisément à empêcher que l’urgence sécuritaire devienne un alibi institutionnel.
Pour tenir cette ligne, l’État doit éviter deux pièges. Le premier est l’improvisation. Le second est le flou. Or, le flou est souvent le carburant des crises libanaises. Une date non verrouillée devient une rumeur. Une rumeur devient une pression. Une pression devient un compromis. Et le compromis finit par déplacer l’échéance.
Le vrai risque: l’enlisement plutôt que la rupture
À écouter les déclarations, le pays semble aligné. Le président dit non au report. Il renvoie au Parlement. Il revendique une posture d’arbitre. Il appelle les expatriés à voter.
Pourtant, le danger n’est pas dans les grandes phrases. Il est dans la mécanique. Un Parlement qui tarde. Une administration qui attend un texte. Une controverse sur la logistique du vote à l’étranger. Une demande de “délai raisonnable”. Et le “technique” revient.
Ce qui se joue, au fond, n’est donc pas seulement une élection. C’est la capacité de l’État à imposer une évidence. Et à la faire respecter par tous, y compris ceux qui, par habitude ou intérêt, préfèrent toujours une marge de manœuvre au bord du calendrier.