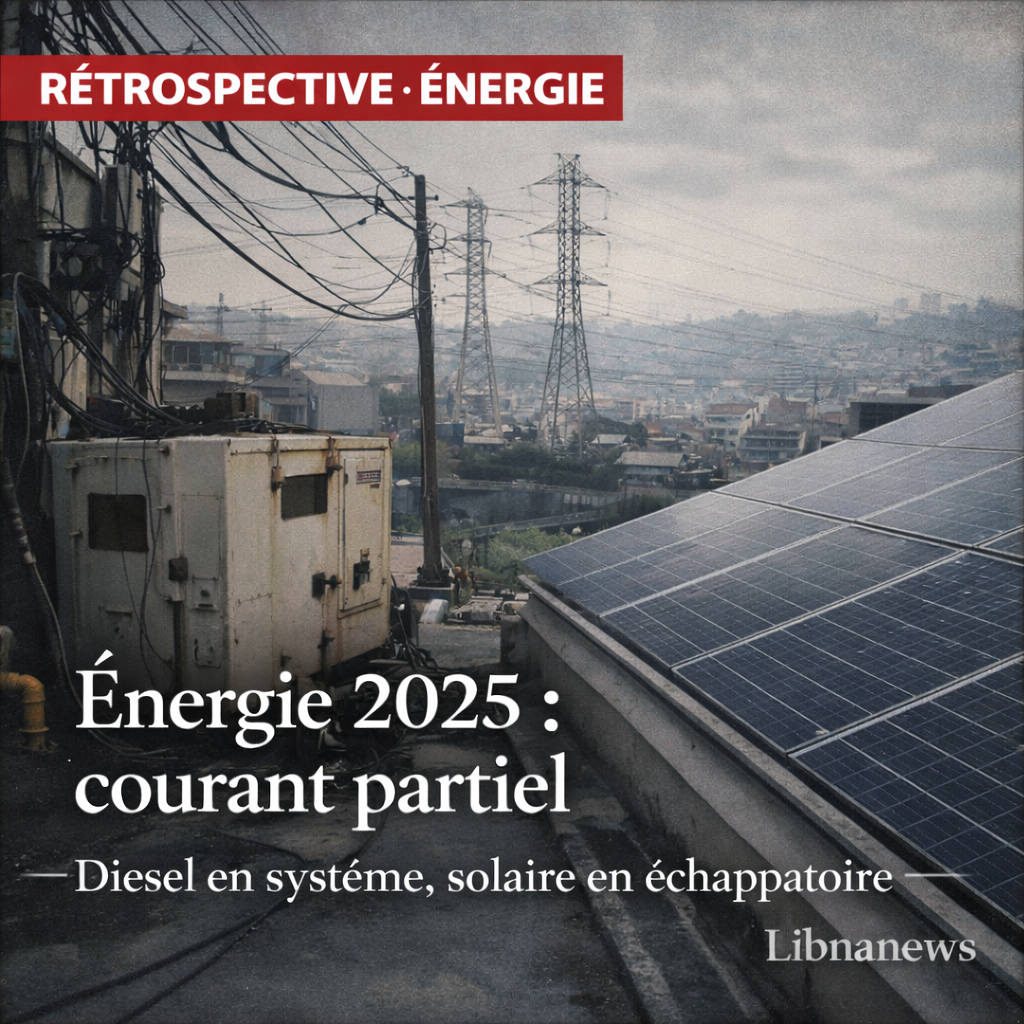Une règle de base piétinée: une banque sans fonds propres n’est pas une banque
Une banque n’est pas un bâtiment. Ce n’est pas une marque. Ce n’est pas un réseau d’agences. C’est une promesse garantie par du capital. Quand une banque encaisse des pertes massives, elle doit être recapitalisée. Sinon, elle devient une coquille. Elle garde le décor, mais elle n’a plus la capacité d’honorer ses engagements.
Au Liban, cette évidence a été contournée. Le secteur bancaire a évité le moment où il devait reconnaître sa propre insolvabilité. Il a évité le tri. Il a évité la purge. Il a surtout évité la recapitalisation réelle. À la place, il a imposé une gestion par l’attente. L’attente, ici, n’est pas un délai neutre. C’est un mécanisme de transfert de pertes.
La logique est simple. Plus la recapitalisation est repoussée, plus les déposants absorbent. Ils absorbent par la dévaluation. Ils absorbent par l’inflation. Ils absorbent par des plafonds. Ils absorbent aussi par l’humiliation quotidienne. Ce transfert est discret, mais continu. Il remplace une décision claire par une érosion lente.
Le plus choquant est que ce choix n’a jamais été assumé comme tel. Les banques parlent de “stabilité”. Elles parlent de “retour de confiance”. Elles parlent de “restructuration progressive”. Ce vocabulaire sert à masquer une réalité brutale: sans capital frais, le système ne se reconstruit pas. Il se prolonge, sous perfusion sociale.
Le mot qui trompe: “restructuration” ne veut rien dire sans fermeture et changement de contrôle
Le secteur bancaire utilise un mot magique. Restructuration. Il le répète pour donner l’impression d’un mouvement. Or une restructuration bancaire réelle a des marqueurs précis. Elle classe les banques. Elle ferme celles qui ne sont pas viables. Elle fusionne certaines entités. Elle change des actionnaires. Elle impose des apports de capital, mesurables et datés.
Au Liban, la restructuration est souvent présentée comme une trajectoire administrative. Des audits annoncés. Des plans discutés. Des comités évoqués. Puis des années passent. Les banques restent. Les mêmes propriétaires restent. Les déposants, eux, continuent de porter l’essentiel de la douleur.
C’est là que naît la “recapitalisation fantôme”. Elle ressemble à une recapitalisation, parce qu’on en parle. Elle n’en est pas une, parce qu’elle ne change pas les bilans de manière crédible. Elle ne remplace pas les pertes par du capital. Elle remplace les pertes par du temps.
Le temps est l’allié du cartel bancaire. Il transforme une obligation de payer en une capacité à négocier. Une banque qui devrait disparaître peut ainsi survivre, car personne ne veut assumer la fermeture. Une banque qui devrait perdre ses actionnaires peut les garder, car le processus n’est jamais tranché.
L’effet sur l’économie est massif. Sans banques viables, pas de crédit normal. Sans crédit, pas d’investissement. Sans investissement, pas de croissance. Le pays se verrouille. Il devient un marché de cash, de transferts familiaux, et de survie.
Les chiffres qui expliquent la manœuvre: protéger la majorité en nombre, déplacer la charge en valeur
La bataille se joue dans une structure de dépôts à deux vitesses. D’un côté, une masse énorme de comptes modestes. De l’autre, une masse financière concentrée sur une minorité. Cette structure permet une stratégie politique très efficace.
Les ordres de grandeur qui circulent dans le débat libanais en 2025 donnent une image claire. Environ 782.000 comptes sous 100.000 dollars, pour environ 14,8 milliards de dollars. Au-dessus de 100.000 dollars, environ 145.000 comptes, pour environ 67,4 milliards. Cette répartition n’est pas un détail. Elle dicte la propagande bancaire.
Les banques savent calmer la majorité en nombre. Elles promettent de protéger les dépôts modestes. Elles le font avec un seuil, parce qu’un seuil rassure. Ensuite, elles déplacent le débat vers les dépôts plus élevés, car c’est là que se trouve la masse.
Le piège est dans la seconde partie. Les dépôts plus élevés ne sont pas uniquement des fortunes. Ils incluent des trésoreries d’entreprises. Ils incluent des fonds de fonctionnement. Ils incluent parfois des caisses collectives. Les frapper sans discernement casse l’économie réelle. Puis, quand l’économie réelle casse, les banques disent que la stabilité exige de les protéger davantage.
On obtient un cercle pervers. La promesse protège l’image. Le mécanisme détruit l’activité. La destruction de l’activité justifie un nouveau report. Et le report devient une nouvelle ponction invisible sur le déposant.
La fausse solution la plus populaire: “on rendra jusqu’à 100.000 dollars en quatre ans”
La promesse est séduisante parce qu’elle est simple. Elle donne un calendrier. Elle donne une limite. Elle fait croire que l’État reprend la main. Pourtant, cette promesse est un test d’honnêteté. Elle oblige à répondre à une question brutale: d’où vient l’argent.
Si l’on prend 14,8 milliards à restituer sur quatre ans, l’effort moyen est d’environ 3,7 milliards par an. Cela signifie un peu plus de 300 millions par mois. Ce chiffre n’est pas un argument. C’est une contrainte. Il oblige à une architecture de financement.
Si les banques contribuent réellement, il faut le dire et le rendre obligatoire. Si la Banque du Liban finance l’essentiel, il faut dire comment, et à quel coût sur la monnaie. Si l’État est mis à contribution, il faut dire où il prend, et quel service public il sacrifie.
Le secteur bancaire adore les promesses non verrouillées. Il adore les horizons. Il déteste les obligations datées. Une promesse de quatre ans peut devenir huit ans. Elle peut devenir dix ans. Elle peut aussi devenir une suite de “mécanismes”. Le déposant récupère par morceaux. Entre-temps, la vie continue, mais plus chère.
Une promesse non garantie est une anesthésie. Elle réduit la colère. Elle rend le Parlement plus confortable. Elle permet aux banques de gagner du temps. Et le temps, au Liban, n’est jamais neutre.
Le cœur de la recapitalisation fantôme: faire de l’épargne un capital de secours
Dans une économie saine, un déposant n’est pas un investisseur. Il confie son argent à une banque pour le garder disponible. Il accepte un risque faible, encadré. Il ne cherche pas un rendement d’actionnaire. Il cherche une sécurité.
La recapitalisation fantôme consiste à inverser cette logique. Elle transforme, de manière directe ou indirecte, l’épargne en capital de secours. Elle le fait par conversion forcée. Elle le fait par titres à long terme. Elle le fait aussi par des décotes déguisées. L’objectif est le même. Reconstruire un bilan bancaire sans apport de capital frais.
Cette stratégie est confortable pour les actionnaires. Elle protège leur contrôle. Elle protège leur position. Elle évite l’entrée de nouveaux investisseurs. Elle évite aussi la honte d’une faillite officielle.
Pour le déposant, c’est une trahison. On lui explique qu’il doit participer. On lui dit que c’est national. On lui dit que c’est inévitable. En réalité, on lui demande d’absorber une perte que le capital bancaire devrait absorber avant lui.
Le scandale n’est pas l’existence d’une perte. La perte existe déjà. Le scandale est l’ordre dans lequel on la fait porter. La recapitalisation fantôme est une manière de faire porter sans assumer.
Les instruments longs: le remboursement en papier, et la décote qui ne dit pas son nom
Quand une banque ne peut pas payer, elle propose un instrument. C’est une technique mondiale. Mais elle devient toxique si elle est utilisée pour masquer une décote.
Un déposant reçoit un titre. Il voit un montant nominal. Il croit que son droit est préservé. Puis il découvre que ce titre se vend avec une décote. Il perd en valeur. Il perd aussi en temps, car il doit attendre. Il subit une double peine: la valeur et le délai.
Sur une masse au-dessus de 100.000 dollars, estimée autour de 67,4 milliards dans l’ordre de grandeur, une décote implicite devient un séisme. Si les titres se négocient à 70% de leur valeur nominale, la perte implicite dépasse 20 milliards. À 50%, elle se rapproche de 34 milliards. Ces chiffres illustrent l’ampleur du piège.
Les banques préfèrent cette méthode parce qu’elle déplace la responsabilité. Elles disent qu’elles ont “remboursé”. Elles ont remis un papier. Elles peuvent ensuite accuser le marché, la liquidité, ou la confiance. Elles se lavent les mains de la valeur réelle.
Une réforme honnête peut utiliser des instruments, mais elle doit fixer des garanties. Elle doit fixer des échéances fermes. Elle doit surtout imposer une contribution ferme des banques. Sinon, l’instrument devient une façon légale de faire payer le déposant.
Les pourcentages qui font la vérité: 10%, 20%, 40% changent une vie nationale
La loi peut imposer une contribution bancaire sur les mécanismes de remboursement. C’est là que la guerre est la plus sale. Parce qu’un chiffre suffit à déplacer des milliards.
Si l’on prend 67,4 milliards comme base d’illustration, 10% représentent environ 6,7 milliards. 20% représentent environ 13,5 milliards. 40% représentent environ 27 milliards. La différence entre 10% et 20% est énorme. Elle dépasse 6 milliards. Ce n’est pas un détail technique. C’est une redistribution de douleur.
Les banques cherchent toujours à réduire ces chiffres. Elles invoquent la “capacité”. Elles invoquent la “stabilité”. Elles invoquent la peur de la faillite. Mais si une banque ne peut pas contribuer, elle est déjà en faillite de fait. La question n’est donc pas de la protéger. La question est de la restructurer, ou de la fermer.
Le système libanais préfère éviter la fermeture. Parce que fermer, c’est admettre. C’est assumer. C’est nommer des responsables. C’est toucher à des réseaux. La recapitalisation fantôme est donc une stratégie politique avant d’être une stratégie financière.
La durée comme escroquerie douce: étaler pour ne jamais payer
Une autre arme est le calendrier. Étaler une obligation la rend “supportable” sur le papier. Elle devient “réaliste”. Elle devient “progressive”. C’est un langage séduisant pour les décideurs, car il évite le choc.
Pourtant, étaler ne crée pas de capital. Étaler ne rend pas une banque solvable. Étaler permet surtout de prolonger la vie d’un secteur zombie, tout en maintenant les restrictions.
Si l’on prend une contribution totale de 13,5 milliards en illustration, sur dix ans cela fait environ 1,35 milliard par an. Sur quinze ans, environ 900 millions. Sur vingt ans, environ 675 millions. La charge annuelle paraît moins brutale. Mais la société, elle, ne vit pas sur une feuille. Elle vit dans une économie qui a besoin de crédit et de confiance maintenant.
Le retard a un coût. Il entretient l’économie du cash. Il augmente l’informel. Il maintient la fuite de l’épargne. Il empêche les entreprises de planifier. Et il pousse une génération entière à chercher sa sécurité hors du pays.
La durée est donc une escroquerie douce si elle n’est pas accompagnée d’une purge. Une purge est ce que les banques veulent éviter. Elles préfèrent une société qui s’adapte à l’injustice, plutôt qu’un secteur qui perd son pouvoir.
Le tri bancaire: l’étape que les banques veulent effacer
La recapitalisation réelle impose une question simple. Quelles banques sont viables. Quelles banques ne le sont pas. Cette question tue un cartel, parce qu’elle oblige à distinguer.
Un cartel préfère la confusion. Tant que tout le secteur est présenté comme un bloc, il peut négocier comme un bloc. Il peut menacer comme un bloc. Il peut demander de l’aide comme un bloc. Mais dès qu’on classe, on isole. On peut fermer une partie. On peut forcer des fusions. On peut changer des actionnaires. On peut même confier certaines activités à des entités nouvelles.
Le Liban a besoin de ce tri. Une économie ne peut pas fonctionner avec une majorité de banques zombies. Ces banques ne prêtent pas. Elles ne prennent pas de risque productif. Elles se contentent de survivre sur les dépôts piégés, et sur des commissions.
Les banques redoutent surtout un effet: la perte de contrôle. Une recapitalisation vraie implique souvent l’entrée de capital frais. Et capital frais signifie nouveaux propriétaires. Les anciens propriétaires perdent leur pouvoir. Ils perdent leur capacité à influencer le politique. Ils perdent leur rente. Ils feront donc tout pour éviter cette étape.
Ils préfèrent transformer les déposants en capital de secours, car cela permet de garder le contrôle. C’est l’essence de la recapitalisation fantôme.
La Banque du Liban comme tampon: la solution facile, le désastre durable
Une autre méthode consiste à faire de la Banque du Liban le tampon principal. On explique que les pertes sont “là”. On propose des montages. On évoque des revenus futurs. On parle de régularisation. Et on avance vers une conclusion implicite: la Banque du Liban paiera.
Ce déplacement arrange les banques. Il leur évite d’assumer une contribution lourde. Il leur évite aussi d’expliquer pourquoi leurs bilans ne tiennent pas. Il transforme une crise bancaire en crise institutionnelle, puis en crise monétaire.
Le danger est clair. Si la Banque du Liban finance sans réforme bancaire, elle finance une continuation. Elle finance une économie du cash. Elle finance une absence de crédit. Et elle finance un pays plus fragile.
Dans un tel scénario, les déposants payent deux fois. Ils payent par la perte de leurs droits. Ils payent ensuite par l’instabilité monétaire, ou par la dégradation de l’État, ou par une fiscalité future.
Le secteur bancaire vend cette option comme “réaliste”. Elle est surtout confortable. Elle permet de préserver le cartel, même si elle détruit l’avenir.
La justice économique absente: comment le système évite la responsabilité sans jamais la nier
Les banques ne disent pas frontalement qu’elles ne paieront pas. Elles évitent la phrase. Elles préfèrent des formulations. Elles parlent de “partage des pertes”. Elles parlent de “capacité”. Elles parlent de “stabilité”. Elles parlent de “nécessité d’un plan global”.
Ce langage est un écran. Il sert à éviter une question pourtant simple. Que perdent les actionnaires. Que perdent les dirigeants. Que perdent les propriétaires. Que perd le secteur, en capital et en contrôle. Et que gagne la société en retour.
Une réforme honnête doit rendre ces pertes visibles. Elle doit les écrire. Elle doit imposer un ordre. Sans cela, le système conserve son impunité. Il transforme une faillite en malédiction nationale. Il fait croire que le pays est coupable, et que les banques sont un dommage collatéral.
Or les banques ont été un moteur du modèle. Elles ont vendu la sécurité. Elles ont profité des rendements. Elles ont participé au recyclage. Elles ne peuvent pas ensuite se présenter comme des victimes obligées de limiter les retraits.
L’économie réelle étranglée: sans crédit, la reprise est un mot vide
La recapitalisation fantôme n’est pas un débat d’experts. Elle touche le commerce, l’industrie, les services, la santé, l’éducation. Sans banques viables, le crédit reste rare et cher. Les entreprises n’investissent plus. Elles se replient. Elles gèlent l’embauche. Elles réduisent les salaires. Elles évitent les projets.
Les ménages, eux, vivent sans filet. Ils doivent financer des chocs par des circuits familiaux, ou par la vente de biens. Ils apprennent à vivre sans confiance. Ils gardent du cash. Ils évitent les comptes. Ils se protègent comme ils peuvent.
Cette société de méfiance a un coût invisible. Elle augmente les inégalités. Elle favorise ceux qui ont des réseaux. Elle punit ceux qui vivent de revenus fixes. Elle accélère l’émigration. Elle réduit l’impôt collectable. Et elle rend l’État encore plus fragile.
Les banques utilisent ensuite cette fragilité pour demander protection. C’est un cercle. Elles créent un problème. Elles se présentent comme la solution. Elles exigent une loi qui les protège. Et la société paie pour que le cercle continue.
Le Parlement face à un choix simple, même si les textes sont longs
Les textes seront techniques. Les débats seront compliqués. Pourtant, le choix final est simple.
Soit la loi impose une recapitalisation réelle, avec tri, fermeture de banques mortes, et changement de contrôle quand il le faut. Soit la loi organise une recapitalisation fantôme, où l’épargne devient un capital de secours, et où la Banque du Liban et l’État servent de tampons.
La différence se verra dans des éléments concrets. Des obligations fermes de capital. Des délais courts. Des sanctions automatiques. Des audits imposés. Une hiérarchie des pertes claire, qui commence par les actionnaires. Et une protection des dépôts modestes écrite comme droit, pas comme promesse.
Les banques chercheront l’inverse. Elles chercheront des délais. Elles chercheront des comités. Elles chercheront des définitions floues. Elles chercheront des instruments longs. Elles chercheront des contributions faibles. Elles chercheront surtout une exécution négociable.
Ce n’est pas un débat abstrait. C’est un choix de société. Un pays peut survivre à un choc de vérité. Il ne survit pas à une normalisation permanente de l’injustice.