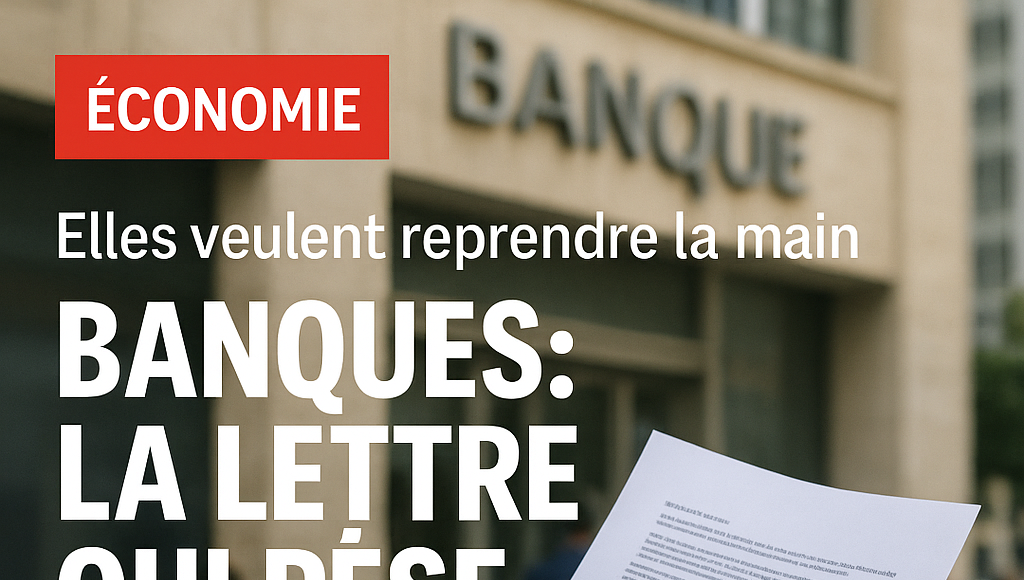Une prise de parole calculée qui cherche à reprendre la main
La lettre ouverte des banques est présentée comme un appel à la raison et à la protection des déposants. Pourtant, elle doit aussi être lue comme une opération de repositionnement, menée par un secteur dont la légitimité reste profondément abîmée. Les banques interviennent au moment où les textes sur l’organisation financière et la restitution des dépôts entrent dans une phase décisive. Ce choix de calendrier n’est pas neutre. Il vise à peser sur l’arbitrage politique avant que les lignes ne se figent. La lettre s’adresse aux trois pôles du pouvoir, ce qui lui donne un statut institutionnel. Elle cherche à apparaître au-dessus des camps, comme si le secteur bancaire représentait l’intérêt général. Or, cette posture se heurte à une réalité qui demeure dans l’esprit d’une grande partie de la population: les restrictions imposées aux déposants ont été appliquées de façon inégale, avec des règles changeantes, des plafonds fluctuants, et une opacité qui a nourri la suspicion. Dans ce contexte, la lettre fonctionne aussi comme un bouclier. Elle prépare une défense future: si la loi adoptée provoque des pertes visibles ou une crise supplémentaire, les banques veulent pouvoir dire qu’elles avaient averti. Cette stratégie consiste à se présenter comme “responsables” au moment même où elles continuent de protéger leurs marges de manœuvre. La lettre insiste sur les risques de récession prolongée et de paralysie du financement de l’économie. Mais elle évite de répondre frontalement à la question la plus douloureuse: pourquoi, depuis le début de la crise, les déposants ont-ils été traités comme la variable d’ajustement, tandis que la traçabilité des flux, la hiérarchie des retraits et la transparence des décisions internes sont restées floues pour le grand public. Cette absence pèse, car elle révèle la logique centrale de la communication bancaire: élargir le débat vers des principes macroéconomiques, afin de réduire l’attention portée aux pratiques concrètes qui ont détruit la confiance.
Il faut aussi regarder ce que la lettre ne dit pas, ou dit à demi-mot. Elle se présente comme défenseure de la restitution des dépôts, mais son argumentation vise surtout à limiter ce que les banques devraient supporter dans une répartition des pertes. Lorsqu’elle affirme que certaines versions de loi mettraient en danger les déposants, elle peut aussi chercher à empêcher l’adoption d’un cadre qui imposerait des obligations strictes aux établissements: divulgation, hiérarchisation, et mécanismes de contrôle. Autrement dit, la défense du déposant sert aussi de levier politique pour éviter une restructuration trop contraignante. La lettre tente d’imposer une équivalence: “protéger les banques” reviendrait à “protéger les déposants”. Or, cette équivalence est contestable, car la protection du déposant dépend d’abord de règles claires, applicables à tous, et d’une capacité à établir les responsabilités. Dans la crise libanaise, le sentiment d’injustice vient précisément de l’impression que certains ont pu se protéger mieux que d’autres, que certaines décisions se sont prises loin du regard public, et que les mécanismes de contrôle n’ont pas joué leur rôle au bon moment. La lettre insiste sur la nécessité de restaurer la confiance, mais elle ne propose pas d’engagements concrets et vérifiables sur la transparence des bilans, sur la publication d’informations comparables entre banques, ou sur une gouvernance qui rendrait des comptes. Sans ces éléments, l’appel au compromis ressemble à une demande de délai et de flexibilité, plus qu’à une contribution à une refondation.
Le déplacement de la responsabilité: un récit utile, mais incomplet
Le cœur de la lettre repose sur une idée: la crise serait essentiellement le produit de décisions de l’État et de la Banque du Liban, et les banques commerciales seraient surtout des victimes collatérales d’un système. Ce récit peut contenir une part de vérité, mais il est aussi politiquement commode. Il permet de déplacer la charge morale et financière. En insistant sur le caractère “systémique” de la crise, la lettre cherche à diluer la responsabilité bancaire dans un ensemble plus large, jusqu’à rendre presque impossible l’identification des fautes propres au secteur. Pourtant, la société libanaise ne reproche pas seulement aux banques d’avoir été prises dans un mécanisme. Elle leur reproche d’avoir administré la crise au jour le jour sans règles publiques, d’avoir instauré des restrictions de fait sans cadre légal robuste, et d’avoir laissé prospérer une impression d’arbitraire. La lettre insiste sur des normes comptables et sur la supervision défaillante. Mais elle ne répond pas à la question suivante: pourquoi le secteur n’a-t-il pas, plus tôt, exigé une clarification légale, une égalité de traitement et un cadre transparent, au lieu de gérer par circulaires, exceptions, et arrangements. Cette zone grise a nourri la colère. Elle a aussi nourri l’idée que, même si l’État a sa part, le secteur bancaire a choisi des comportements de protection, parfois au détriment d’une justice minimale envers les déposants ordinaires.
La critique devient plus forte lorsqu’on observe les fronts parallèles. D’un côté, les banques affirment vouloir une solution “juste”. De l’autre, elles contestent vigoureusement les demandes de transparence qui émergent de la justice et des obligations de conformité, notamment lorsqu’il s’agit d’accéder à des informations étendues sur des opérations et des transferts sur une période critique. Cette contradiction est lourde: réclamer la protection de la propriété des déposants tout en résistant à des démarches visant à établir les faits alimente l’idée d’une défense de corporation. Le secteur bancaire met en avant la peur d’une destruction du système, mais cette peur peut aussi servir à disqualifier toute investigation large. Or, dans une crise de confiance, l’enjeu n’est pas seulement de sauver un “système”. L’enjeu est de reconstruire une règle du jeu crédible. Une règle du jeu crédible suppose que l’on puisse vérifier, comprendre, et comparer. Quand les banques demandent à limiter l’accès aux informations, elles apparaissent comme cherchant à éviter une relecture complète de la période d’effondrement. Elles peuvent affirmer qu’il s’agit de protéger la stabilité. Mais, du point de vue du déposant, cela ressemble à une volonté de réduire la lumière sur des pratiques qui restent controversées. Dans ce contexte, le récit qui concentre la faute sur l’État et la banque centrale peut être perçu comme un moyen de sortir du champ de la responsabilité directe, plutôt que comme une contribution honnête à une répartition équitable des pertes.
L’argument de souveraineté: quand les banques réclament l’État, après l’avoir contourné
La lettre utilise un vocabulaire juridique et institutionnel pour affirmer que l’État doit couvrir des déficits, mobiliser des actifs, et assumer des obligations. Cette insistance sur l’État est frappante, car elle contraste avec une réalité vécue: pendant des années, la relation entre banques, banque centrale et pouvoir politique a été marquée par une proximité, des arrangements et une dépendance réciproque. Aujourd’hui, les banques demandent un État fort quand il s’agit de couvrir des pertes, mais elles ont contribué à un modèle où l’État s’est financé à crédit, où la banque centrale a multiplié des mécanismes, et où la surveillance a été jugée insuffisante. Dans ce sens, invoquer la souveraineté et l’obligation de l’État peut sembler paradoxal. Cela revient à dire: l’État doit être souverain pour payer, mais la souveraineté de l’État sur le secteur bancaire, sur les règles de transparence et sur les responsabilités, doit rester limitée. Cette asymétrie alimente une critique légitime. Une souveraineté cohérente implique un État capable d’imposer des règles aux banques, d’exiger des données, d’encadrer les pratiques et de sanctionner. Or, le secteur bancaire, tout en réclamant l’intervention de l’État comme garant financier, se montre souvent plus réticent dès que l’État se présente comme autorité de contrôle ou de contrainte.
Le recours aux actifs publics, aux entreprises stratégiques et aux réserves d’or comme pistes de compensation doit aussi être regardé avec prudence. Présenter ces actifs comme solution peut servir à éviter une reconnaissance plus frontale des pertes et une restructuration bancaire profonde. Cela peut également déplacer le coût vers le patrimoine commun, donc vers l’ensemble de la population, y compris ceux qui n’ont déjà plus d’épargne ou qui n’avaient pas de dépôts significatifs. Autrement dit, la lettre peut suggérer une socialisation du coût, tout en refusant une charge trop lourde pour le secteur. C’est ici que la critique de souveraineté devient concrète. Une souveraineté économique ne consiste pas seulement à “mobiliser des actifs”. Elle consiste à décider qui paie, selon quels principes, et avec quelles garanties. Or, lorsque les banques mettent sur la table des actifs publics, elles doivent aussi être interrogées sur leur propre contribution: recapitalisation, restructuration, responsabilité des actionnaires, et transparence sur les années de crise. Sans cette symétrie, l’argument des actifs publics ressemble à une issue qui protège les établissements en transférant la facture ailleurs. Dans une société marquée par l’injustice perçue, cette proposition a un coût politique énorme, car elle peut être lue comme une nouvelle étape de transfert de pertes vers le collectif, après le gel de fait de l’épargne privée.
La lettre comme stratégie de pression: influence, peur et absence d’engagements vérifiables
La lettre n’est pas seulement un texte d’argumentation. Elle est une stratégie de pression. Elle cherche à créer une crainte: celle d’un effondrement plus grave si la loi n’est pas modifiée. Cette peur agit comme un instrument, car elle pousse les décideurs à éviter toute mesure qui pourrait être interprétée comme “anti-bancaire”, même si cette mesure est destinée à clarifier les responsabilités. Le secteur bancaire sait que le pays redoute un choc supplémentaire. Il sait aussi que les responsables politiques craignent d’être accusés d’avoir “cassé” ce qui reste. La lettre exploite cette fragilité. Elle dramatise les conséquences possibles, tout en restant dans une formulation prudente. Cela permet d’apparaître raisonnable, mais d’installer une menace indirecte: si vous légiférez mal, vous serez responsables du désastre. Cette rhétorique est efficace, mais elle appelle une critique: depuis le début de la crise, la population a vécu une succession de “désastres” sans cadre clair, et les banques ont continué à fonctionner selon des règles internes et variables. La peur de demain ne peut pas effacer l’injustice d’hier. Pour rétablir la confiance, il faut plus qu’un avertissement. Il faut des engagements concrets, mesurables, et contrôlables.
Or, la lettre reste faible sur ce point. Elle ne détaille pas une feuille de route d’engagements bancaires: publication standardisée d’informations essentielles, mécanismes d’égalité de traitement, procédures de recours pour les déposants, et participation explicite des actionnaires à la réparation. Elle insiste sur la croissance et sur le retour du financement de l’économie, mais elle ne répond pas à la question centrale: comment convaincre qu’un secteur qui a perdu la confiance peut redevenir l’outil de la reprise sans transformation profonde. De plus, la stratégie de communication bancaire se heurte à une contradiction structurelle: elle demande du temps et de la flexibilité, mais la société demande des réponses et une justice visible. Quand les banques s’opposent à des demandes larges de transparence ou de coopération avec des démarches judiciaires, elles affaiblissent leur propre discours de responsabilité. Dans cette configuration, la critique du rôle des banques n’est pas seulement morale. Elle est fonctionnelle. Un pays ne peut pas reconstruire sa monnaie, son crédit et son investissement sans confiance. Et la confiance ne revient pas avec une lettre, même bien écrite. Elle revient avec des règles appliquées à tous, avec des responsabilités établies, et avec des sacrifices partagés. Tant que la communication bancaire vise surtout à limiter la charge pour le secteur, tout en transférant l’essentiel de la responsabilité vers l’État, elle risque de renforcer le soupçon qu’elle cherche d’abord à préserver ses intérêts, et seulement ensuite à réparer un contrat social déjà brisé.