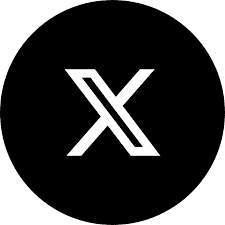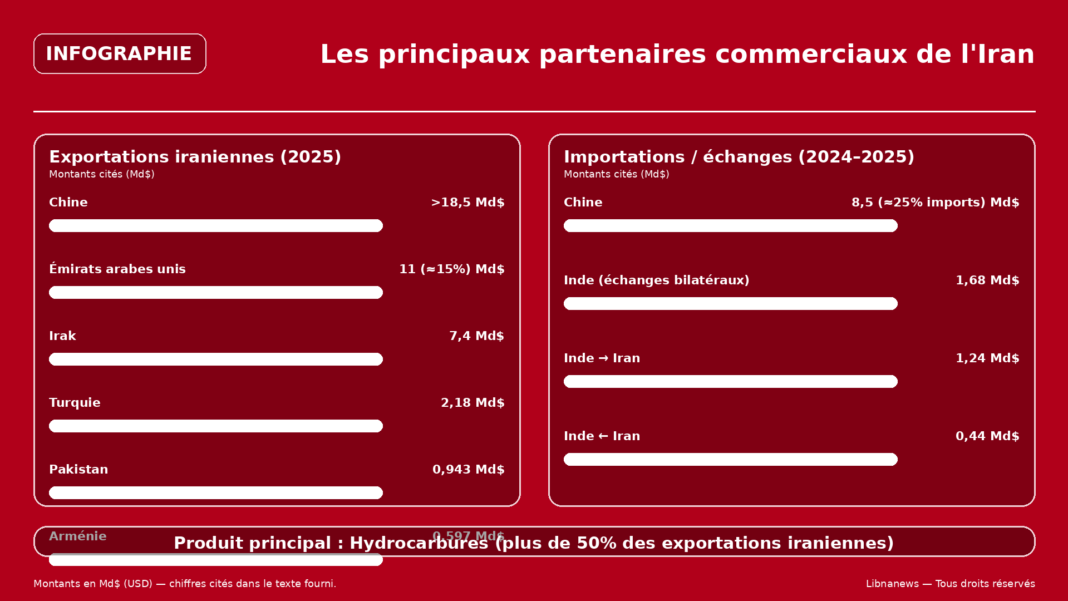Le nœud du jour: une dette contestée malgré un mémorandum
Le 12 janvier 2026, Nawaf Salam répond à une question qui résume la crise. La Banque du Liban réclame une clarification. Elle veut une position officielle. Elle vise la dette de l’État envers la banque centrale. Or, selon la réponse rapportée, le gouvernement conteste encore cette dette. Cela vaut même après la signature d’un mémorandum d’entente entre le ministère des Finances et la Banque du Liban. Le montant cité est de 16,5 milliards de dollars.
Le point est politique. Il l’est autant que comptable. Un État qui conteste un engagement signé fragilise sa parole. Il fragilise aussi tout texte à venir. Et il ouvre la voie au soupçon. Qui reconnaît quoi, et quand. Qui gagne du temps, et pourquoi.
Dans le même récit, une idée revient comme une alarme. Si l’État ne reconnaît pas ce volet, la crise repart “au point de départ”. Le message est clair. Il vise le calendrier. Il vise aussi le vote de la loi sur l’écart financier.
Suivez les principaux indicateurs économiques en temps réel.
Karim Souaid et la bataille des chiffres
Dans cette séquence, Karim Souaid tente de verrouiller un fait. Il insiste sur une reconnaissance formelle du mémorandum par le ministère des Finances. Puis il élargit le cadre. Il explique que les 16,5 milliards ne seraient qu’une partie du total. Il présente cette part comme un tiers. Il avance un ordre de grandeur qui grimpe vers 50 milliards de dollars.
Ce déplacement n’est pas neutre. Il change la lecture des pertes. Il change aussi la lecture du partage. Car si le chiffre monte, la question devient plus brutale. Qui porte le reste. L’État, la Banque du Liban, les banques, ou les déposants.
Un autre élément complète le tableau. Karim Souaid évoque aussi des “demandes non régulières” évaluées à environ 35 milliards de dollars. Là encore, le message est double. D’un côté, il explique l’ampleur d’une partie de la fuite. De l’autre, il prépare la discussion sur ce qui doit être exclu, ou requalifié, dans le calcul final.
Un texte au Parlement, mais une responsabilité qui circule
La loi liée à l’écart financier est déjà un objet de tension. Elle l’est avant même le vote. Un constat ressort des informations rapportées. Le projet est désormais “chez” les députés. Le gouvernement peut dire qu’il a transmis. Il peut aussi renvoyer la pression.
C’est un réflexe connu. L’exécutif cherche à éviter d’endosser seul le choc. Le Parlement, lui, hésite. Il hésite parce que le sujet touche les pertes. Il hésite aussi parce qu’une année électorale rend chaque vote explosif.
Entre les deux, la Banque du Liban pousse. Elle pousse parce qu’un vide légal laisse la crise ouverte. Elle pousse aussi parce qu’un vide protège les zones grises. Et, dans une crise longue, les zones grises deviennent des forteresses.
Hagop Terzian: “pas de chiffres, pas de vérité”
Le débat sort aussi des cercles techniques. Hagop Terzian, député, formule une critique frontale. Il affirme que le projet de loi de l’écart financier “manque de chiffres clairs” sur l’ampleur des pertes et sur le système financier.
Il pousse plus loin. Il réclame un audit judiciaire. Il cite explicitement la Banque du Liban. Il cite aussi des organismes et des structures liées au secteur public. Il demande que les bénéficiaires soient identifiés. L’objectif qu’il annonce est la reddition de comptes.
Terzian met aussi le doigt sur un point sensible. Il estime que le projet “vise le secteur bancaire” sans traiter la responsabilité de l’État. Il appelle à “restructurer la dette publique”. Il demande de clarifier comment l’État remboursera. Il présente cela comme une étape préalable, avant de voter le projet de l’écart financier.
Sur le calendrier, il se veut catégorique. Il dit s’attendre à ce que l’échéance législative soit tenue “dans son délai constitutionnel”, sans report, et “selon la loi actuelle”.
Les banques ripostent: Fadi Khalaf dénonce une logique “à sens unique”
Le secteur bancaire, lui aussi, durcit le ton. Fadi Khalaf, secrétaire général de l’Association des banques, critique la philosophie du texte transmis. Il dit qu’elle repose sur un principe qu’il juge constant. Selon lui, banques et déposants seraient utilisés “presque exclusivement” pour combler l’écart.
Il insiste sur un point technique, mais très politique. Il affirme que la “liquidité” attribuée à la Banque du Liban ne serait, en réalité, que l’argent des banques déposé en réserves obligatoires. Donc, selon son argument, l’argent des déposants.
Khalaf attaque aussi l’État. Il dit que l’État, qu’il présente comme “principal responsable” de la formation de l’écart, ne fournirait pas de contribution matérielle directe. Il ajoute qu’aucune action “sérieuse” ne viserait la récupération des fonds publics détournés.
Ces phrases éclairent le rapport de force. Les banques ne nient pas la crise. Elles déplacent la responsabilité. Elles cherchent aussi à éviter d’être la caisse unique du règlement.
Joseph Aoun: le choix du cadre, même imparfait
Au-dessus de cette mêlée, Joseph Aoun fixe une ligne de méthode. Il parle de “réalisme”. Il dit, en substance, qu’“adopter une loi incomplète est préférable à l’absence totale de cadre légal”.
Cette position a une cible. Elle vise le blocage par perfection. Elle vise aussi la tentation d’attendre le texte idéal. Joseph Aoun renverse l’argument. Il accepte les remarques. Il accepte les défauts. Mais il refuse le vide.
Dans le même mouvement, il rappelle que le pays vit déjà avec des réformes partielles. Il cite l’idée d’une restructuration bancaire amorcée sans texte complet sur l’écart financier. Et il pointe, derrière cela, une crise de confiance qui ne se reconstruit pas avec des demi-mesures.
Ce que la dispute cache: une guerre sur le partage des pertes
Le bras de fer actuel n’est pas une querelle d’ego. Il porte sur le partage. Il porte sur la part de l’État. Il porte sur la part de la Banque du Liban. Il porte sur la part des banques. Et, au bout, il porte sur les déposants.
C’est aussi pour cela que la bataille des chiffres est si dure. Quand le montant est 16,5 milliards, le partage semble encore “négociable”. Quand le montant monte vers 50 milliards, le partage devient un choc.
Dans cette atmosphère, chacun cherche une assurance. Le gouvernement veut éviter d’endosser seul la facture. Le Parlement veut éviter un vote qui fâche. La Banque du Liban veut figer la dette de l’État. Les banques veulent prouver que l’État doit payer davantage.
Au centre, un seul fait demeure. Sans cadre légal, le pays reste dans l’arbitraire. Et, sans accord sur les chiffres, aucun cadre légal ne tient longtemps.