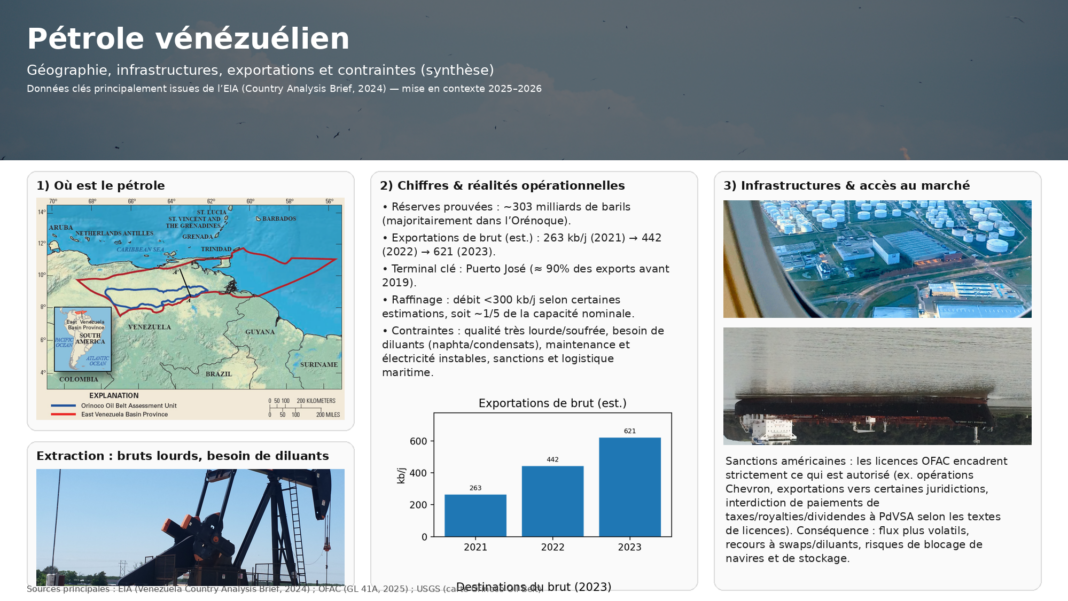Dans la nuit du 3 janvier 2026, Donald Trump a revendiqué une opération militaire américaine au Venezuela, affirmant que Nicolás Maduro et son épouse avaient été capturés puis exfiltrés par avion. À Caracas, des explosions ont été rapportées et les autorités vénézuéliennes ont dénoncé une agression, tout en exigeant des preuves de vie et des précisions sur le lieu de détention. Les informations disponibles dans les premières heures restent fragmentaires sur le déroulé exact, l’ampleur des dommages et la chaîne précise des décisions, mais un point s’est imposé immédiatement dans les réactions : la question de la légalité, au regard du droit international comme du droit américain.
L’épisode a aussi déclenché, à Washington, un débat institutionnel classique mais rarement aussi brutal dans sa forme : l’exécutif peut-il frapper un État étranger, viser son chef, et conduire une extraction sans autorisation préalable du Congrès, tout en présentant l’opération comme une action relevant de l’ordre judiciaire ? Cette ligne argumentative, déjà utilisée dans d’autres contextes, se heurte ici à une réalité difficile à contourner : il s’agit d’une action armée sur le territoire d’un État souverain, et donc d’un acte qui, en droit international, tombe par défaut sous l’interdiction du recours à la force, et qui, en droit américain, active le cadre de contrôle parlementaire prévu pour l’engagement des forces.
Charte des Nations unies : l’interdiction du recours à la force, sauf exceptions étroites
Le droit international part d’un principe simple : l’usage de la force contre un autre État est interdit. Les exceptions existent, mais elles sont limitées et encadrées. La première est une autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies. À ce stade, aucune indication publique crédible ne permet d’affirmer qu’un mandat explicite aurait été donné avant l’opération. La deuxième est la légitime défense (article 51 de la Charte), qui suppose une attaque armée et impose des critères stricts de nécessité et de proportionnalité. La troisième, plus rare, est le consentement de l’État territorial, ou d’une autorité reconnue comme gouvernement légitime ; or, Caracas conteste précisément la légitimité de l’intervention.
C’est sur ce terrain que l’opération apparaît juridiquement la plus vulnérable : une capture et une exfiltration d’un chef d’État par une puissance étrangère ressemblent, par nature, à une atteinte directe à la souveraineté et à l’indépendance politique. Même si Washington invoque des poursuites pénales (l’existence d’une inculpation américaine contre Maduro est régulièrement rappelée), une incrimination nationale ne constitue pas, en elle-même, un “permis” d’employer la force sur le territoire d’un autre État.
Dans une réaction publiée le 3 janvier, Dominique de Villepin a formulé l’accusation la plus frontale : selon lui, les États-Unis se placent « volontairement et indiscutablement hors du droit international », violant « la charte et l’esprit des Nations unies », et ouvrent une séquence lourde pour l’ordre issu de 1945. Son texte insiste sur un point politiquement explosif : la normalisation du changement de régime par la force, dont les précédents — Irak, Libye — ont, dit-il, davantage produit chaos, guerre civile et durcissements autoritaires que démocratie et paix.
“Doctrine Monroe” et effet domino : la crainte d’un précédent revendiqué
Le propos de Dominique de Villepin s’inscrit dans une évolution doctrinale américaine récente. La stratégie de sécurité nationale publiée en décembre 2025 par la Maison-Blanche réactive explicitement une logique d’influence dans l’hémisphère occidental, en évoquant un “corollaire Trump” à la doctrine Monroe. L’idée n’est pas seulement symbolique : elle présente l’espace latino-américain comme une zone d’intérêt prioritaire, où la puissance américaine entend “faire respecter” ses objectifs sécuritaires, migratoires et énergétiques.
Dans cette perspective, l’opération contre Caracas ne serait pas un accident tactique, mais un signal stratégique : l’acceptation, par Washington, d’une action coercitive directe pour remodeler un environnement régional. C’est précisément ce que de Villepin pointe quand il évoque la “politique de la canonnière” et l’imposition d’un ordre idéologique conforme à la vision trumpienne sur le continent.
Le risque, dans cette grille de lecture, est celui d’un précédent utilisable par d’autres puissances. Si les États-Unis s’affranchissent du cadre onusien au nom d’une nécessité politique ou morale — renverser un régime jugé illégitime, criminel ou hostile —, avec quels arguments contester ensuite une action chinoise contre un régime qui lui déplaît en Asie, ou une action russe contre un voisin au nom de sa sécurité ? Ce n’est pas un débat abstrait : c’est la mécanique même de la sécurité collective, fondée sur des règles communes et sur la limitation de la violence interétatique, qui est touchée.
Droit américain : War Powers, notification au Congrès, et fracture constitutionnelle
Sur le plan interne, l’architecture juridique est, elle aussi, balisée. Le Congrès détient le pouvoir de déclarer la guerre et, plus largement, d’autoriser l’usage de la force. Le président est commandant en chef, mais l’engagement des forces dans des hostilités est encadré depuis 1973 par la War Powers Resolution. Cette loi impose une consultation “dans toute la mesure du possible” et, surtout, un rapport formel au Congrès dans les 48 heures suivant l’introduction des forces dans des hostilités (ou une situation où des hostilités sont imminentes). Sans autorisation législative, un compte à rebours s’enclenche ensuite, avec une obligation de retrait à défaut de validation parlementaire.
Or, dans les premières heures, plusieurs éléments publics ont alimenté le soupçon d’un passage en force institutionnel : des élus ont dit ne pas avoir connaissance d’une autorisation, et des informations de presse ont indiqué que les commissions compétentes n’avaient pas été notifiées au moment où l’opération était annoncée. Un point mérite toutefois d’être posé froidement : une notification peut être transmise de manière classifiée, et l’absence d’information publique immédiate ne prouve pas à elle seule une violation. Mais, politiquement et juridiquement, l’exécutif est attendu sur une question précise : y a-t-il eu un rapport War Powers, transmis dans les délais, exposant la base légale et la portée de l’opération ?
La défense la plus probable de la Maison-Blanche consisterait à invoquer les pouvoirs de l’Article II et à présenter l’opération comme limitée, nécessaire et conforme à un intérêt national majeur, possiblement articulée à une logique d’arrestation et de poursuite pénale. Mais cette ligne se heurte au fait brut : une frappe annoncée comme “à grande échelle” et la capture d’un chef d’État sur son territoire ressemblent moins à une opération ponctuelle qu’à une action de contrainte stratégique, ce qui accroît le risque de conflit avec le Congrès — sur l’autorisation, sur l’information, et sur le financement.
Une bataille de légitimité qui commence autant à New York qu’à l’ONU
Si Maduro et son épouse sont effectivement détenus pour être jugés aux États-Unis, le dossier basculera aussi sur un terrain procédural : juridiction, conditions de transfert, accès aux avocats, statut exact des détenus, et narration officielle de l’opération. La tentation américaine sera de “judiciariser” l’événement pour le faire sortir du registre de la guerre. La tentation vénézuélienne sera de “souverainiser” l’événement pour le porter devant les enceintes internationales comme une violation caractérisée de la Charte.
Dans son texte, Dominique de Villepin appelle la France et l’Europe à réaffirmer, avec les pays du “Sud global”, l’attachement à la souveraineté des États et à la sécurité collective, et à défendre l’ordre juridique des États-nations face à la collision des empires. À ce stade, l’issue dépendra moins des déclarations que de trois faits vérifiables dans les prochaines heures : la base juridique formellement avancée par Washington, la saisine ou non du Conseil de sécurité, et la manière dont le Congrès américain choisira de reprendre — ou non — la main sur l’exécutif.