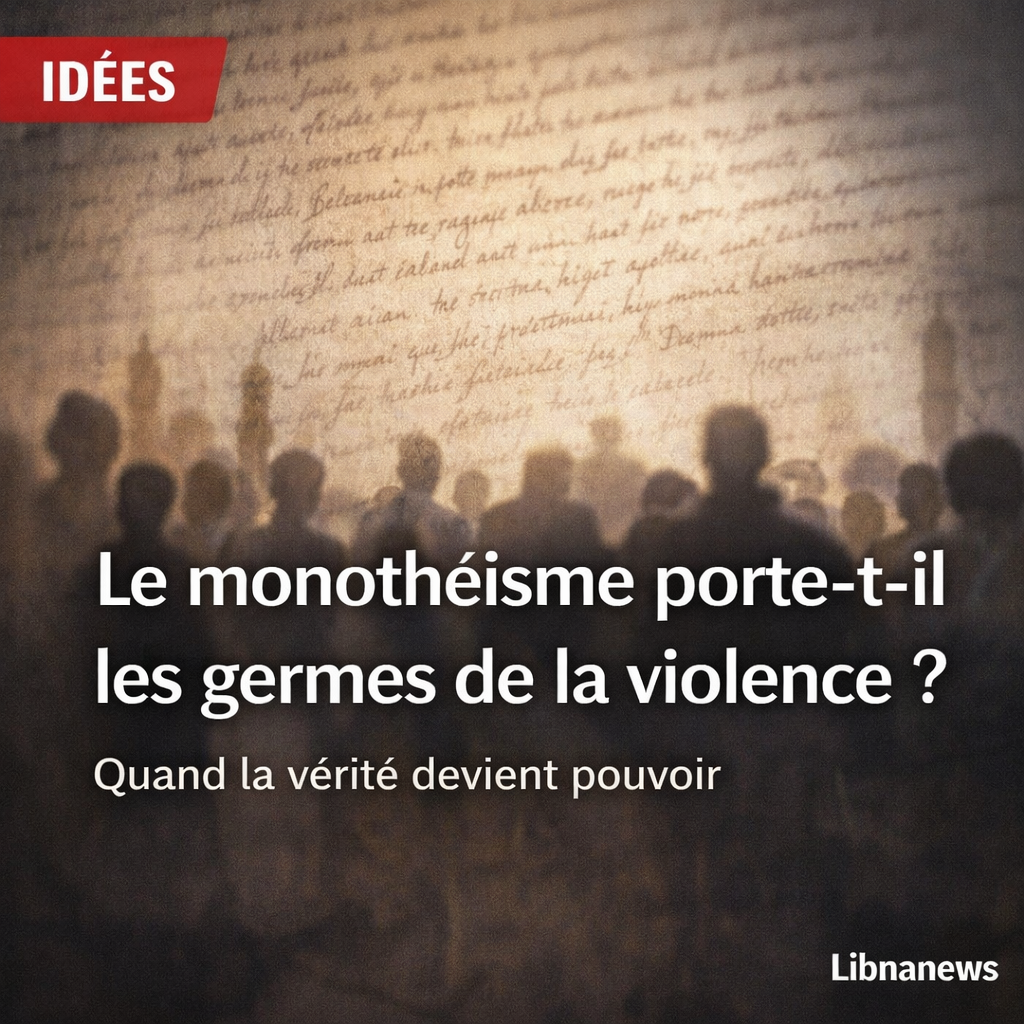Il y a des silences qui apaisent. Et il y a des silences qui écrasent.
Celui qui entoure, depuis cinq ans, l’une des plus grandes catastrophes financières de l’histoire du Liban appartient à la seconde catégorie. Ce n’est pas un silence de prudence. Ce n’est pas un silence d’enquête. C’est un silence qui protège, qui dilue, qui fatigue, jusqu’à rendre l’injustice presque normale.
Cinq ans.
Cinq ans sans juge financier véritablement saisi du cœur du dossier.
Cinq ans sans hiérarchisation claire des responsabilités.
Cinq ans sans un seul acte judiciaire capable de dire, simplement, qui a fait quoi.
Ce silence n’est pas une énigme. Il est un symptôme.
Un juge financier, lorsqu’il fait son travail, ne commence pas par punir. Il commence par nommer. Il établit les faits, puis il mesure les responsabilités. Il distingue. Il répartit. Il tranche. Il dit : ici l’État, ici la banque centrale, ici les banques commerciales. Il ne confond pas. Il ne dilue pas. Il ne se cache pas derrière la complexité.
Or ce travail fondamental n’a jamais été fait. Non pas parce qu’il serait impossible, mais parce qu’il serait insupportable pour ceux qu’il mettrait à nu.
Dans un précédent article, j’avais proposé une répartition claire des responsabilités, non par intuition, mais par analyse du fonctionnement réel du système :
– l’État, pour avoir organisé le déficit, l’endettement sans limite, l’irresponsabilité budgétaire : 50 % ;
– la Banque du Liban, pour avoir conçu, maintenu et maquillé un système de fuite en avant financière : 30 % ;
– les banques, pour avoir profité, amplifié et commercialisé ce système en connaissance de cause : 20 %.
Ces chiffres peuvent être discutés. Ils doivent l’être. C’est précisément le rôle d’un juge. Mais ce qui ne peut plus être discuté, c’est le refus même de faire ce travail. Car tant que les responsabilités ne sont pas établies, tout le reste n’est que mise en scène.
Ce refus n’est pas technique. Il est politique, institutionnel, presque existentiel. Nommer les responsabilités, c’est faire tomber le récit commode selon lequel « tout le monde est coupable » — ce récit qui permet surtout à personne de l’être vraiment. C’est rompre avec l’idée toxique que la crise serait une fatalité, un malheur collectif, une tempête sans auteur.
Or une crise sans responsables est toujours payée par les plus faibles.
Les déposants sont devenus les boucs émissaires parfaits. On leur explique, avec un calme presque obscène, qu’ils doivent contribuer, patienter, renoncer, comprendre. Comme s’ils avaient conçu le système. Comme s’ils avaient voté les budgets. Comme s’ils avaient structuré les ingénieries financières. Comme s’ils avaient eu accès à l’information, au pouvoir, aux décisions.
Ils n’ont rien fait de tout cela.
Ils ont simplement fait confiance.
Et c’est peut-être cela, au fond, qui ne leur est pas pardonné.
Tant qu’un juge financier ne posera pas noir sur blanc la part de responsabilité de chacun, il n’y aura aucune solution réelle à la crise. Il y aura des lois bricolées, des plans bancals, des mots creux — restructuration, haircut, recapitalisation — mais aucune justice. Et sans justice, il n’y a pas de reconstruction possible, seulement une gestion lente de la colère et du désespoir.
Ce silence judiciaire n’est pas neutre. Il produit un effet très précis : il transforme une crise de gouvernance et de prédation en crise des déposants. Il inverse la charge morale. Il fait passer les victimes pour des variables d’ajustement. Il rend acceptable l’inacceptable.
Ce qui est en jeu n’est pas seulement l’argent. C’est la dignité. C’est la possibilité, pour une société, de dire encore : ceci est injuste, et nous savons pourquoi. Tant que cette parole n’est pas prononcée, la crise continue, même si les chiffres changent.
Un pays ne meurt pas seulement quand il est ruiné.
Il meurt quand il n’ose plus nommer ses responsables.