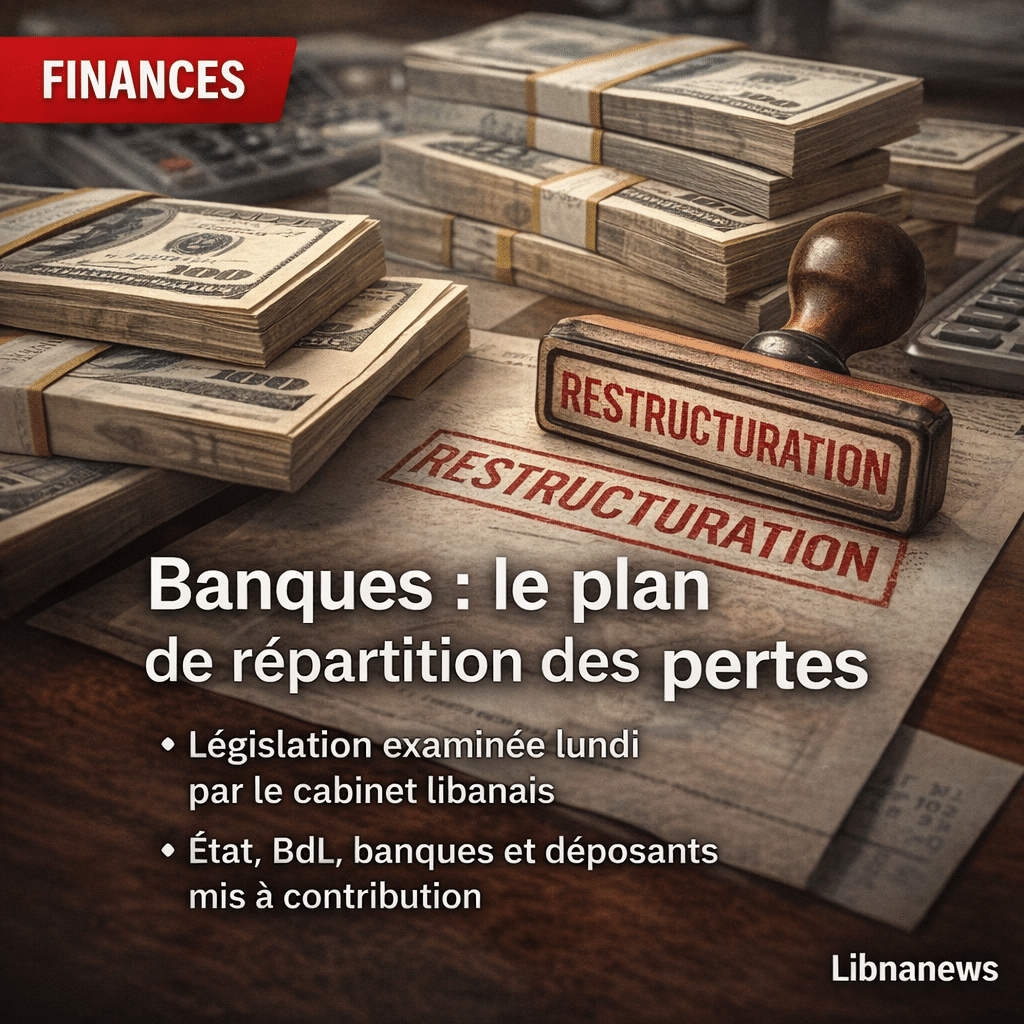Le 20 décembre 2025, l’Association des banques du Liban (ABL) a publiquement critiqué le projet de loi sur la répartition des pertes bancaires présenté la veille par le Premier ministre Nawaf Salam, qualifiant le texte de « lacunaire » et de nuisible aux intérêts du secteur. Cette réaction immédiate illustre une fois de plus le rôle central des institutions financières dans la prolongation de la crise économique qui frappe le Liban depuis 2019, une débâcle marquée par des pertes cumulées estimées à plus de 70 milliards de dollars. Alors que le gouvernement tente de structurer une sortie de crise, les banques, accusées d’avoir contribué activement à l’effondrement par leurs pratiques imprudentes, s’opposent farouchement à toute mesure qui les obligerait à assumer une part substantielle des responsabilités. Ce bras de fer, qui oppose les intérêts privés des actionnaires bancaires aux besoins urgents de la population, met en lumière les dysfonctionnements profonds d’un système financier autrefois vanté comme un pilier de l’économie régionale.
Dans un communiqué diffusé le lendemain de la présentation du projet, l’ABL a dénoncé des « graves insuffisances » dans le document, arguant qu’il porte atteinte à la stabilité du secteur et ignore les réalités opérationnelles des banques. Cette posture n’est pas nouvelle : depuis l’éclatement de la crise en octobre 2019, les établissements financiers ont systématiquement résisté aux réformes proposées, préférant pointer du doigt l’État et la Banque du Liban (BdL) pour les déficits accumulés. Pourtant, des analyses indépendantes, y compris celles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), soulignent le rôle pivotal des banques dans la genèse de la catastrophe, à travers des investissements massifs dans la dette publique et une gestion des risques défaillante qui a transformé le système bancaire en une pyramide Ponzi insoutenable.
Les racines d’une crise alimentée par les pratiques bancaires
La crise économique libanaise, qualifiée par la Banque mondiale comme l’une des plus sévères depuis le milieu du XIXe siècle, trouve son origine dans les années précédant 2019, une période où les banques ont joué un rôle prépondérant dans l’aggravation des vulnérabilités. Attirées par des rendements élevés sur les titres de dette publique, les institutions financières ont investi des sommes colossales dans les obligations d’État, financées en grande partie par les dépôts des citoyens. Ce mécanisme, soutenu par la BdL qui offrait des taux d’intérêt attractifs pour attirer les capitaux étrangers, a créé une dépendance mutuelle toxique entre l’État et le secteur bancaire. Lorsque les flux de dollars se sont taris en 2019, face à une instabilité politique croissante et une perte de confiance internationale, les banques se sont retrouvées avec des actifs illiquides et des bilans gonflés de pertes latentes.
Des estimations récentes, publiées en avril 2025 par le département d’État américain dans son rapport sur le climat des investissements, chiffrent les pertes accumulées des banques à plus de 72 milliards de dollars depuis le début de la crise. Ces pertes proviennent principalement des prêts accordés à l’État et à la BdL, qui représentent une part dominante des portefeuilles bancaires. Au lieu de diversifier leurs actifs ou de renforcer leurs réserves, les banques ont priorisé les profits à court terme, distribuant des dividendes substantiels à leurs actionnaires même lorsque les signes d’insolvabilité étaient évidents. Par exemple, entre 2015 et 2019, les établissements ont versé des milliards en rémunérations, ignorant les avertissements sur la surévaluation des actifs publics. Cette imprudence a non seulement exacerbé la dévaluation de la livre libanaise – qui a perdu plus de 95 % de sa valeur depuis 2019 – mais a aussi conduit à un gel informel des dépôts, privant des millions de Libanais de leur épargne.
Les banques ont également contribué à la crise par leur rôle dans le financement de déficits publics chroniques. La BdL, en partenariat étroit avec les institutions commerciales, a émis des certificats de dépôt à haut rendement pour couvrir les besoins budgétaires de l’État, un arrangement qui a masqué les déséquilibres fiscaux pendant des années. Lorsque la bulle a éclaté, les banques ont imposé des contrôles de capitaux unilatéraux, limitant les retraits à des montants dérisoires – souvent inférieurs à 100 dollars par mois pour les comptes en devises étrangères. Cette mesure, justifiée au nom de la stabilité, a en réalité protégé les intérêts des actionnaires au détriment des déposants, favorisant l’émergence d’une économie parallèle basée sur les transactions en espèces et le marché noir des devises.
Une opposition systématique aux efforts de restructuration
Face au projet de loi présenté par Nawaf Salam le 19 décembre 2025, les banques ont réagi avec une hostilité prévisible, réitérant leur refus de toute répartition des pertes qui les impliquerait directement. Le texte, qui vise à distribuer les déficits entre l’État, la BdL, les banques et les déposants, impose aux établissements commerciaux le remboursement en espèces d’une partie des dépôts, tout en prévoyant des mécanismes de bail-in et de consolidation du secteur. L’ABL, dans son communiqué du 20 décembre, a qualifié ces dispositions de « préjudiciables », arguant qu’elles sous-estiment les contributions déjà faites par les banques et risquent de précipiter une vague de faillites. Cette critique masque toutefois une réalité : les banques ont historiquement bloqué les réformes pour préserver leurs privilèges, comme en témoigne leur rejet du plan de récupération gouvernemental de 2022, jugé trop punitif.
Cette opposition n’est pas isolée. En août 2025, les banques ont cherché à engager un conseiller pour négocier avec la BdL sur 80 milliards de dollars de créances, une démarche perçue comme une tentative de minimiser leurs pertes plutôt que de contribuer à une solution globale. L’ABL, qui représente les intérêts collectifs du secteur, a publié en novembre 2025 un rapport mensuel avertissant d’une « crise systémique » non résolue sans intervention étatique massive, tout en blâmant les politiciens pour le meltdown financier. Pourtant, des experts indépendants soulignent que les banques ont activement participé à cette crise en accordant des prêts non performants et en facilitant l’évasion de capitaux par des figures politiquement exposées avant 2019.
Le projet de Salam, en imposant des fusions forcées et l’effacement des capitaux des actionnaires, menace directement les structures de propriété des banques, souvent liées à des familles influentes et à des réseaux confessionnels. Par exemple, des institutions comme la Bank Audi ou la Blom Bank, qui dominent le marché, ont vu leurs bilans se détériorer drastiquement, avec des pertes nettes estimées à des dizaines de milliards. Leur résistance au plan s’explique aussi par la crainte d’audits approfondis, qui pourraient révéler des irrégularités dans la gestion des dépôts. En juillet 2025, la levée partielle du secret bancaire, adoptée par le Parlement, a déjà permis des enquêtes sur des transferts suspects, mais les banques ont ralenti le processus en invoquant des contraintes techniques.
Le rôle des banques dans l’aggravation des inégalités sociales
Au-delà des aspects financiers, les pratiques des banques ont profundément creusé les inégalités au Liban, transformant une crise économique en une catastrophe sociale. Les petits déposants, représentant la majorité des clients, ont été les premiers touchés par le gel des comptes, tandis que les grands actionnaires ont pu rapatrier des fonds avant l’effondrement. Des rapports de la Banque mondiale, datant d’octobre 2025, indiquent que les pertes bancaires ont exacerbé la pauvreté, avec plus de 80 % de la population vivant sous le seuil de pauvreté en raison de l’inflation galopante et de l’inaccessibilité aux économies.
Les banques, en refusant de provisionner adéquatement pour les risques, ont transféré le fardeau sur les épaules des citoyens ordinaires. Par exemple, les prêts non performants, qui constituent jusqu’à 30 % des portefeuilles selon des évaluations récentes, reflètent une sous-estimation systématique des dangers liés à la dette publique. Cette négligence a non seulement conduit à l’insolvabilité collective du secteur – avec une soixantaine de banques en difficulté – mais a aussi entravé toute reprise économique. En 2025, les hostilités avec Israël ont aggravé la situation, avec des dommages estimés à 14 milliards de dollars par la Banque mondiale en mars, impactant directement les actifs bancaires dans les régions sud.
L’opposition au plan de Salam s’inscrit dans cette logique de préservation des intérêts privés. Le projet prévoit un clawback sur les transferts illicites effectués avant 2019, ciblant précisément les actionnaires et les personnes politiquement exposées qui ont évadé des milliards. Les banques, via l’ABL, contestent cette mesure, la qualifiant d’injuste et de rétroactive, alors qu’elle vise à récupérer des actifs pour financer les remboursements. Cette résistance prolonge l’incertitude pour les déposants, qui attendent depuis six ans une résolution, et entrave les négociations avec le FMI, essentielles pour débloquer une aide internationale.
Les critiques internes au secteur et les alternatives ignorées
Même au sein du secteur bancaire, des voix dissidentes émergent, critiquant la ligne dure de l’ABL. Des économistes comme Nassib Ghobril, de la Byblos Bank, ont publiquement regretté l’absence de propositions constructives de la part des banques, notant que leur focalisation sur la protection des capitaux ignore les impératifs de recapitalisation. En septembre 2025, un projet de loi sur la distribution des pertes, préfigurant celui de Salam, avait déjà suscité des débats internes, avec certaines banques plaidant pour une approche plus collaborative.
Pourtant, l’opposition collective persiste, favorisée par un lobbying intense auprès des parlementaires. Le plan de Salam, en prévoyant l’octroi de nouvelles licences bancaires à des capitaux étrangers (au moins cinq pour un minimum de 200 millions de dollars), vise à injecter de la concurrence et des fonds frais, mais les institutions existantes y voient une menace à leur domination. Cette attitude protectionniste a été exacerbée par les campagnes de diffamation contre le gouvernement Salam depuis sa formation en février 2025, des efforts coordonnés qui visent à discréditer les réformes au profit du statu quo.
Les implications immédiates de cette opposition se font sentir dans les négociations en cours. Le 21 décembre 2025, des sources gouvernementales ont indiqué que des amendements pourraient être apportés au projet avant son examen par le cabinet, sous la pression des banques. Cependant, cette flexibilité risque de diluer l’efficacité du texte, laissant les pertes non résolues et prolongeant la paralysie économique. Les déposants, organisés en associations, ont réagi en appelant à des manifestations, dénonçant le rôle des banques dans la perpetuation de la crise.
Les conséquences opérationnelles pour les banques en 2025
En cette fin d’année 2025, les banques libanaises font face à des défis opérationnels accrus, amplifiés par leur refus de s’engager pleinement dans les réformes. Les pertes accumulées, réévaluées à 186 billions de livres libanaises dans des projections récentes, incluent des déficits sur les bilans de la BdL et des prêts non performants. Les institutions, déjà sous-capitalisées, ont vu leurs actifs se déprécier davantage en raison des conflits régionaux, avec des branches au sud du pays particulièrement affectées par les bombardements.
L’opposition au plan de Salam, qui prévoit une consolidation du secteur via des fusions et des liquidations ordonnées, expose les banques à un risque accru d’insolvabilité. En novembre 2025, l’ABL a publié un rapport soulignant une « crise systémique » nécessitant une reconnaissance collective, mais sans proposer de concessions de leur part. Cette stance a conduit à une impasse avec le FMI, qui conditionne son assistance à une restructuration crédible, incluant une prise en charge des pertes par les acteurs responsables.
Les détails des bilans révèlent l’ampleur du problème : les banques détiennent environ 40 billions de livres en prêts non performants, tandis que leurs capitaux propres ont fondu de plus de 50 % depuis 2019. Leur résistance au bail-in, qui impliquerait la conversion de dépôts en capitaux, protège les actionnaires mais aggrave la liquidité, forçant les établissements à opérer avec des réserves minimales. En décembre 2025, des retraits limités persistent, avec des files d’attente devant les guichets, illustrant l’échec des banques à restaurer la confiance.
Les transferts évadés avant la crise, estimés à des dizaines de milliards, restent un point de friction. Le projet de clawback, contesté par l’ABL, cible ces flux, souvent facilités par les banques elles-mêmes pour des clients privilégiés. Des audits forensiques en cours, accélérés par la levée du secret bancaire en juillet, ont déjà identifié des irrégularités dans plusieurs institutions, renforçant les critiques sur leur gouvernance.
Dans ce contexte, les implications immédiates pour l’économie incluent une contraction persistante du crédit, avec les banques réticentes à prêter en raison de leurs propres contraintes. Les entreprises, privées de financement, se tournent vers le marché informel, alimentant l’inflation et le chômage. Le 22 décembre 2025, des discussions au cabinet sur le projet de loi ont révélé des tensions, avec des ministres sunnites et chiites exprimant des réserves influencées par les lobbies bancaires, soulignant les intersections confessionnelles dans cette opposition.