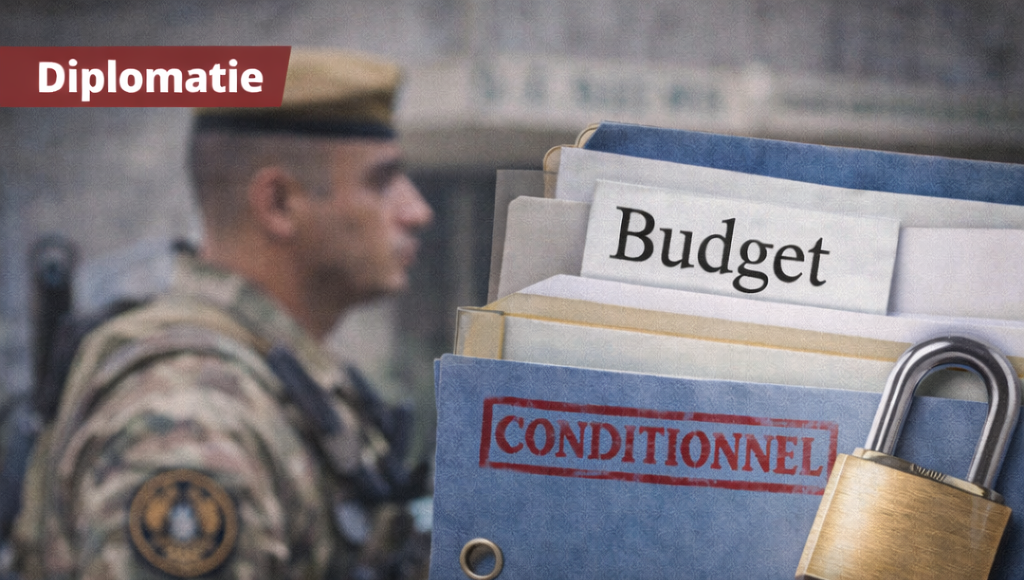Le choix du canal: l’armée comme “institution livrable”, le budget comme “trou noir politique”
Le basculement vers l’armée comme canal principal de l’aide ne repose pas sur une préférence abstraite pour l’uniforme. Il repose sur une logique de contrôle et de traçabilité. Dans les éléments disponibles, les partenaires internationaux se préparent à des rendez-vous spécifiquement dédiés au soutien de l’institution militaire, avec une préparation structurée, un calendrier et une discussion explicite sur l’utilité de “renforcer les capacités” de l’armée au regard de la phase sécuritaire jugée délicate. La comparaison implicite avec une aide transitant par le budget est défavorable à ce dernier, parce que le budget est perçu comme exposé à la fragmentation politique, aux arbitrages instables, aux priorités changeantes et à la contestation sociale. Les mêmes documents montrent que les bailleurs relient le soutien à l’armée à une séquence opérationnelle et à des jalons, notamment la poursuite d’une démarche de limitation des armes hors contrôle de l’État, avec une étape annoncée au nord du Litani. Cette structure par étapes est plus facile à “vendre” politiquement à l’étranger qu’un transfert budgétaire général, car elle permet de justifier l’effort par une mission identifiable, avec un cadre, des objectifs et une chaîne de commandement. À l’inverse, une aide budgétaire directe est perçue comme un instrument à haut risque de dilution, parce qu’elle se fond dans un ensemble de dépenses et de déficits où les donateurs ont moins de prise et moins de visibilité. Le canal “armée” devient alors une garantie minimale: il permet d’affirmer que l’argent, l’équipement ou l’appui technique servent une institution précise, avec une utilité immédiate en matière de sécurité intérieure et de stabilité.
Cette préférence est aussi une réponse à un problème de crédibilité. Les documents insistent sur la nécessité de transformer les positions politiques en plan d’exécution, en soulignant qu’un discours ferme sans plan clair n’a pas de valeur sur un dossier aussi sensible que la question des armes. Dans ce cadre, l’armée est présentée comme le seul acteur capable de porter une mise en œuvre concrète, parce qu’elle dispose d’une capacité d’action territoriale et d’un appareil opérationnel. Cela ne signifie pas que les partenaires veulent marginaliser les institutions civiles, mais qu’ils recherchent un point d’ancrage qui “tienne” malgré les turbulences. Le budget, lui, dépend d’un consensus gouvernemental, de votes, de décrets, d’exécution administrative et de recettes, dans un moment où la tension sociale sur la fiscalité et les dépenses publiques est élevée. Cette tension est visible dans les débats sur le financement des revalorisations et sur les taxes, qui montrent à quel point la dépense publique est immédiatement politisée. Les donateurs, face à ce risque, choisissent le canal où la contestation interne a moins de chances de bloquer l’usage de l’aide. Ils privilégient une institution qui peut absorber un soutien même lorsque le reste de l’État ralentit. C’est ce calcul de “livrabilité” qui explique pourquoi l’aide passe par l’armée plutôt que par le budget.
La conditionnalité réelle: l’argent suit une feuille de route, pas une promesse de réforme
La conditionnalité n’est pas toujours formulée sous forme de clauses écrites. Elle peut être intégrée à la manière dont l’aide est organisée, au calendrier des réunions, et aux thèmes imposés dans les échanges. Les documents disponibles montrent que les ambassadeurs d’un groupe de partenaires suivent de près un rapport du commandement de l’armée transmis au Conseil des ministres, et qu’ils lient leur disponibilité à soutenir l’armée à la poursuite d’une stratégie visant à limiter les armes à l’État, avec un accent sur la “deuxième phase” au nord du Litani. Ce point est central, car il transforme l’aide militaire en instrument de pression politique. Le message implicite est clair: soutenir l’armée est plus probable si l’État montre qu’il avance sur un dossier considéré comme déterminant pour la souveraineté. À l’inverse, une aide budgétaire serait plus difficile à conditionner de façon crédible, car elle peut financer des dépenses sans lien direct avec cette feuille de route. La conditionnalité devient donc une question de design: on choisit un canal qui permet d’associer l’aide à une trajectoire vérifiable, plutôt qu’un canal où l’aide se dissout et où la seule condition devient une promesse.
Cette conditionnalité se lit aussi dans la préparation des rendez-vous internationaux. Les documents décrivent un enchaînement où une réunion préparatoire se tient au Caire le 24 février, avant une conférence à Paris le 5 mars dédiée au soutien de l’armée. L’existence même de ces étapes indique une logique de contrôle. Une réunion préparatoire sert à cadrer la participation, les attentes, et la nature des engagements possibles, mais elle sert aussi à vérifier si le Liban présente un récit cohérent et un calendrier crédible. Ce mécanisme est renforcé par des lectures diplomatiques évoquant un malaise face à ce qui est décrit comme une “méthode libanaise” de gestion du temps, avec une crainte que la durée annoncée serve à des acteurs armés à reconstituer des capacités, ce qui rendrait l’aide politiquement coûteuse pour certains partenaires. Dans ce contexte, la conditionnalité devient double. Elle porte sur l’objectif, le monopole de la force, et elle porte sur le tempo, la capacité à produire des résultats avant que l’argument du “temps perdu” ne s’impose. C’est précisément ce que le budget ne permet pas d’incarner. Un budget peut absorber des fonds sans produire un signal clair de progression sur une feuille de route sécuritaire. L’armée, en revanche, peut produire des jalons et des actions visibles, ce qui rend la conditionnalité opératoire.
Le nord du Litani comme test: aider l’armée pour éviter l’escalade, mais exiger une preuve de souveraineté
Le dossier du nord du Litani joue un rôle de filtre parce qu’il cristallise la difficulté: il s’agit d’une zone où l’enjeu de souveraineté est maximal et où le risque de dérapage est élevé. Les documents insistent sur l’idée que la mise en œuvre de la stratégie de limitation des armes doit se poursuivre, et qu’elle entre dans une phase qui concerne précisément ce périmètre. Pour les partenaires, c’est le terrain où l’on peut mesurer si l’État se contente d’énoncer une orientation ou s’il est capable de la traduire en chaîne de décision, en coordination institutionnelle et en action graduelle. Le soutien à l’armée prend alors une signification particulière. Il n’est pas seulement un acte de solidarité. Il devient une manière d’armer l’État pour qu’il puisse agir sans déclencher une spirale, en renforçant une institution perçue comme capable de gérer des équilibres et de limiter les improvisations. Les documents indiquent d’ailleurs que les ambassadeurs se disent prêts à soutenir l’armée et qu’ils relient cette disponibilité à la phase annoncée. Cela revient à dire que l’aide vise à rendre possible une action de souveraineté, mais une souveraineté cadrée, graduelle et politiquement soutenable.
Dans la même logique, certains passages montrent comment la pression sécuritaire et le risque d’escalade influencent le raisonnement des donateurs. Une analyse évoque l’idée que le temps de l’exécution est crucial, en présentant l’armée comme le seul acteur capable d’agir sur un dossier aussi sensible, et en liant l’urgence à la crainte d’une escalade israélienne plus large si le dossier n’avance pas. Ce type de lecture explique pourquoi l’aide est plus facilement orientée vers l’armée que vers le budget. Les donateurs veulent pouvoir dire que leur soutien réduit un risque. Or, dans une région où les tensions peuvent se transformer rapidement en escalade, “réduire le risque” s’évalue en capacité de terrain, de coordination, de contrôle et de déploiement. Une aide budgétaire, même utile socialement, ne fournit pas ce type de signal immédiat. Elle peut même devenir un sujet de contestation interne si elle est perçue comme finançant un appareil public inefficace. À l’inverse, soutenir l’armée permet de construire un argument de stabilité: une institution renforcée, une chaîne de commandement claire, une capacité d’action, donc une probabilité moindre de vide sécuritaire ou de dérapage. C’est un argument que les capitales étrangères peuvent défendre plus facilement, surtout lorsqu’elles doivent justifier leurs choix à des opinions publiques qui demandent des résultats tangibles.
Pourquoi le budget est évité: peur de la dilution, du blocage politique et de la contestation sociale
Le budget concentre plusieurs risques qui rendent l’aide difficile à assumer. Le premier risque est la dilution. Un transfert budgétaire se fond dans un ensemble de dépenses, de déficits, de priorités concurrentes, et il devient rapidement impossible de démontrer à un parlement étranger ou à une opinion publique que l’argent a produit un effet précis. Le second risque est le blocage politique. Une aide budgétaire suppose un minimum de stabilité dans l’exécution, donc des administrations capables de dépenser selon des procédures, de rendre compte, et de maintenir un cap malgré les crises. Or les documents décrivent un environnement où l’exécution est un problème récurrent et où le pays est critiqué pour sa capacité à produire des discours forts sans les traduire en plans exécutifs. Dans un tel contexte, l’aide budgétaire devient une promesse risquée pour le donateur: si l’exécution échoue, le donateur porte une part de la responsabilité politique, sans pouvoir démontrer qu’il a financé un résultat. Le troisième risque est social. Le budget est au cœur des tensions sur les taxes, les prix et les revalorisations. Une dépense publique, même financée de l’extérieur, peut être interprétée comme alimentant une mécanique de distribution jugée injuste ou mal ciblée, surtout si, en parallèle, des taxes sur la consommation pèsent sur les ménages. Les documents montrent à quel point les décisions fiscales provoquent immédiatement des réactions politiques et sociales, et comment la question du financement des salaires des forces et de l’armée devient prioritaire dans la justification des choix. Dans ce climat, les donateurs évitent un canal qui les placerait au centre d’une querelle de redistribution.
Cette prudence explique aussi pourquoi l’aide se construit par étapes et par formats dédiés. Les documents mentionnent un travail actif de la France et des États-Unis pour obtenir un soutien international qui permette à la conférence dédiée à l’armée d’atteindre ses objectifs, avec une recherche d’aides pour l’armée et les forces de sécurité. Cette orientation vers l’armée et les forces de sécurité n’est pas seulement une préférence institutionnelle. Elle est aussi un moyen de contourner la politique budgétaire intérieure, jugée trop conflictuelle. En finançant l’armée, les donateurs pensent financer une mission et une capacité, pas une redistribution. Ils pensent aussi éviter l’image d’un financement indirect d’un système perçu comme responsable de blocages. Ce raisonnement est renforcé par l’idée, présente dans les documents, que la souveraineté passe par un “armée forte”, et que le soutien international doit être organisé autour de cette idée. Le budget, lui, ne porte pas un symbole aussi clair. Il porte un risque.
Ce que cette conditionnalité change pour l’État: une souveraineté mesurée, un calendrier surveillé, une aide qui devient levier
Lorsque l’aide passe par l’armée plutôt que par le budget, l’État libanais se retrouve face à une souveraineté “mesurée”. Les partenaires ne se contentent pas d’encourager une orientation. Ils la surveillent, ils la découpent en étapes, et ils construisent leurs engagements autour de cette progression. Les documents montrent une interaction directe entre diplomates et commandement militaire, avec des discussions sur les préparatifs d’une conférence de soutien, sur l’importance de renforcer les capacités, et sur la phase sécuritaire en cours. Ils montrent aussi que la présidence est associée à cette séquence, avec des échanges entre Joseph Aoun et Rudolf Heikal sur la préparation et sur les contacts extérieurs. Cette configuration impose une contrainte nouvelle: l’État doit maintenir une cohérence entre discours, planification et exécution, car les partenaires évaluent la progression et ajustent leur soutien en conséquence. Une politique qui hésite, qui ralentit ou qui se contredit risque de transformer l’aide en simple promesse. À l’inverse, une progression graduelle mais lisible renforce la capacité des partenaires à mobiliser des ressources, car ils peuvent dire qu’ils financent une trajectoire, pas une improvisation.
Ce modèle crée aussi un effet politique interne. Lorsque l’aide est orientée vers l’armée, le débat national se déplace vers la question du mandat, du calendrier et des “preuves” de mise en œuvre. Les institutions civiles restent centrales, mais elles sont jugées sur leur capacité à soutenir, encadrer et protéger l’exécution, plutôt que sur leur capacité à absorber des fonds. Cela peut renforcer l’idée d’un État qui se reconstruit par ses fonctions régaliennes, mais cela peut aussi créer des tensions si une partie de la société estime que la priorité donnée au sécuritaire se fait au détriment du social. Cette tension est déjà visible dans le pays, où les débats sur les taxes, les salaires et les prix structurent l’humeur publique. Le défi, pour l’État, est donc double: répondre à la demande de stabilité et de souveraineté qui conditionne l’aide, tout en évitant que cette orientation n’apparaisse comme une politique qui ignore le quotidien. Les partenaires, eux, cherchent un compromis: une armée renforcée pour éviter le vide et l’escalade, mais un État suffisamment cohérent pour que cette armée ne devienne pas un outil isolé. C’est pour cela que la conditionnalité s’exprime par le canal choisi. Ce canal dit tout: l’aide va là où le donateur pense pouvoir démontrer un résultat, et là où il pense pouvoir exercer une influence sans financer un budget perçu comme un terrain de dilution, de blocage et de contestation.