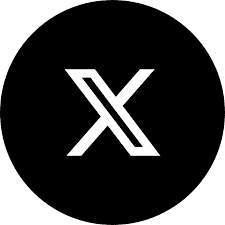À l’approche de la session du Conseil des ministres du 2 septembre 2025, où un plan de désarmement du Hezbollah doit être examiné sous la pression des États-Unis et d’Israël, le Liban se trouve à un tournant critique. La question de savoir si l’armée libanaise, affaiblie par une crise économique sans précédent et des contraintes structurelles, peut désarmer ce mouvement chiite, acteur clé du paysage politique et militaire, domine les débats. Cette exigence, inscrite dans la résolution 1701 de l’ONU et relancée par la médiation de l’émissaire américain Tom Barrack, intervient dans un contexte explosif, marqué par les violations israéliennes du cessez-le-feu de novembre 2024, avec 500 frappes ayant tué 230 combattants du Hezbollah et 83 civils. Dans un pays où la crise bancaire, héritée des fraudes massives pré-2019 et de l’absence de bilans publics depuis six ans, a détruit la confiance en l’État, l’idée d’un désarmement forcé semble irréaliste. Les manifestations populaires, notamment dans le Sud, et les fractures politiques au sein du gouvernement laissent craindre des incidents violents, voire une guerre civile, si l’armée est poussée à agir.
Une armée exsangue face à un défi titanesque
L’armée libanaise, avec environ 80 000 soldats, est souvent présentée comme un pilier d’unité dans un pays fracturé par le confessionnalisme. Mais ses capacités sont gravement entravées par la crise économique débutée en 2019. Avec un budget de 1,5 milliard de dollars, réduit par la dévaluation de la livre libanaise – qui a perdu 98 % de sa valeur – l’armée peine à assurer ses besoins de base. Les salaires des soldats, désormais inférieurs à 100 dollars par mois, ont provoqué une vague de désertions, estimée à 10 % des effectifs entre 2020 et 2024, et un moral en chute libre. « Nos soldats manquent de tout : carburant, munitions, même nourriture. Affronter le Hezbollah dans ces conditions est impensable », confie un officier supérieur.
L’équipement de l’armée est tout aussi problématique. Ses chars M48 Patton des années 1960, ses véhicules blindés M113 et son artillerie limitée à des obusiers de 155 mm sont obsolètes. Sa flotte aérienne, réduite à quelques hélicoptères Huey et Cessna armés, est incapable de rivaliser avec les capacités modernes du Hezbollah. Selon un rapport de 2024 de l’International Institute for Strategic Studies, l’armée manque de moyens en guerre électronique, renseignement et logistique. L’aide internationale, principalement des États-Unis (150 millions de dollars en 2025, contre 400 millions avant 2019) et de la France (50 millions d’euros en 2024), est insuffisante pour combler ces lacunes. En comparaison, le Hezbollah, malgré les pertes de la guerre de 2024 – 3 800 combattants tués et une partie de son arsenal détruit, selon Tsahal – dispose de 20 000 à 30 000 combattants entraînés, de roquettes, de missiles anti-chars Kornet et de drones avancés, lui conférant une supériorité militaire indéniable. « Le Hezbollah est une armée dans l’État, mieux équipée et plus mobile que nous », admet un analyste militaire.
Suivez les principaux indicateurs économiques en temps réel.
Les fractures confessionnelles, un obstacle insurmontable
L’armée libanaise est une institution multiconfessionnelle, avec environ 30 % de soldats chiites, dont beaucoup partagent une affinité idéologique avec le Hezbollah, perçu comme un rempart contre Israël. Une tentative de désarmement risquerait de fracturer l’armée, avec des défections potentielles ou des refus d’obéir parmi les unités chiites. « Si l’ordre est donné d’attaquer le Hezbollah, l’armée pourrait se désintégrer. Les soldats chiites ne tireront pas sur leurs propres communautés », avertit un ancien général. Cette fragilité interne est amplifiée par le contexte politique explosif. Le gouvernement de Nawaf Salam, formé en février 2025, est divisé. Le tandem Hezbollah-Amal, fort de six portefeuilles ministériels et de 27 sièges au Parlement, menace de boycotter la session du 2 septembre si le désarmement est à l’ordre du jour, accusant Salam de céder aux pressions américaines.
Nabih Berri, président du Parlement et leader d’Amal, a dénoncé une « manipulation diplomatique » orchestrée par Washington, qualifiant toute initiative sans consensus national d’« irresponsable ». « Forcer le désarmement sans garanties sur un retrait israélien est une recette pour le chaos », a-t-il déclaré, mettant en garde contre un « effondrement institutionnel ». À l’opposé, les partis chrétiens, comme les Kataëb et les Forces libanaises, soutiennent le désarmement pour restaurer le monopole de l’État sur la violence, conformément à l’accord de Taëf de 1989. Cette fracture confessionnelle – chiites contre chrétiens – fait craindre une escalade vers un conflit interne.
Le président Joseph Aoun, ancien commandant de l’armée, reste silencieux sur le plan, une posture prudente visant à préserver l’unité de l’institution. Mais ce silence alimente les spéculations sur un rôle de « tampon » pour l’armée, qui pourrait être appelée à intervenir entre le Hezbollah et les factions pro-désarmement, un scénario risqué. « L’armée est dans une position intenable. Elle n’a ni la force ni la légitimité pour imposer un désarmement sans déclencher une guerre civile », note un politologue.
Des pressions internationales qui aggravent les tensions
La pression pour désarmer le Hezbollah, relancée par Tom Barrack, s’inscrit dans un plan en quatre phases : décret de désarmement, déploiement de l’armée au sud du fleuve Litani, élimination des arsenaux non étatiques, et retrait conditionnel d’Israël. Mais ce plan est perçu comme un ultimatum aligné sur les exigences israéliennes, qui refusent de retirer leurs troupes des cinq positions frontalières occupées et de cesser les frappes – 500 depuis novembre 2024, causant 83 morts civils, dont 15 enfants – tant que le Hezbollah n’est pas désarmé. Ces violations de la résolution 1701 renforcent le soutien populaire au Hezbollah dans le Sud, où les manifestations à Khiyam, Marjayoun et Tyr ont dénoncé la « complicité » de Barrack avec Israël. « Pourquoi désarmer la résistance alors qu’Israël bombarde nos villages ? », s’insurge un manifestant à Tyr.
Ces protestations, soutenues par le Hezbollah et Amal, pourraient s’intensifier dès septembre, avec des appels à des mobilisations étudiantes et ouvrières. Le risque d’incidents violents est élevé, notamment si l’armée tente d’imposer le désarmement dans les bastions chiites. À Beyrouth, des heurts entre factions pro et anti-Hezbollah ont déjà éclaté, et une intervention militaire pourrait transformer ces tensions en affrontements armés.
Le soutien iranien au Hezbollah, bien qu’affaibli par la chute du régime Assad en Syrie, reste déterminant. Téhéran, qui a fourni armes, missiles et entraînements depuis 1982, adopte une posture ambiguë. « La décision appartient au Hezbollah. Nous le soutenons sans intervenir directement », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghtchi. Cette retenue n’exclut pas une escalade si l’armée agit contre le mouvement, renforçant le risque de déstabilisation régionale.
Une crise économique qui paralyse l’action de l’État
La crise économique, débutée en 2019, est un obstacle majeur. Avec un PIB en chute de 40 %, une inflation record et 80 % de la population sous le seuil de pauvreté, l’État est exsangue. Les pertes bancaires, estimées entre 70 et 100 milliards de dollars, héritées des fraudes massives pré-2019 – validées par des audits complaisants de firmes comme Deloitte et EY – restent irrésolues. L’absence de bilans publics depuis 2019 a détruit la confiance populaire, et la loi de restructuration bancaire du 31 juillet 2025, suspendue à une législation complémentaire, n’a rien réglé. « L’État n’a pas les moyens de payer ses soldats, encore moins de financer une opération contre le Hezbollah », déplore un économiste.
Cette faiblesse prive l’armée des ressources nécessaires pour moderniser son arsenal ou renforcer ses effectifs. Les aides américaines et françaises, bien en deçà des besoins, ne permettent pas de combler ce déficit. « Sans un soutien international massif, l’armée est condamnée à l’impuissance », conclut un officier.
Les risques d’une confrontation explosive
Une tentative de désarmement par l’armée serait désastreuse pour trois raisons. Premièrement, elle serait militairement vouée à l’échec face à un Hezbollah mieux armé et organisé. Deuxièmement, elle risquerait de fracturer l’armée, avec des défections chiites et des tensions internes. Troisièmement, elle pourrait déclencher une vague de violence, avec des affrontements dans le Sud et à Beyrouth, où des échauffourées entre factions pro et anti-Hezbollah ont déjà eu lieu. « Une confrontation entre l’armée et le Hezbollah transformerait les régions chiites en zones de guerre », avertit un analyste.
La session du 2 septembre est un point de rupture. Si le plan est adopté, des démissions ministérielles pourraient faire chuter le gouvernement, plongeant le pays dans une crise institutionnelle. Si le plan est rejeté, les pressions américaines et israéliennes s’intensifieront, avec un risque d’escalade militaire de Tsahal. Dans les deux cas, des incidents violents sont probables, alimentés par les manifestations et les fractures confessionnelles. « Le Liban est au bord du gouffre. Une mauvaise décision pourrait raviver les flammes de la guerre civile », prévient un député.
Une mission irréalisable sans consensus
L’armée libanaise n’a ni les moyens matériels, ni la cohésion interne, ni la légitimité politique pour désarmer le Hezbollah. Sa faiblesse structurelle, aggravée par la crise économique et l’opacité bancaire, la rend incapable d’affronter un mouvement mieux équipé et soutenu par une large base populaire. Les pressions internationales, en ignorant les violations israéliennes, renforcent la défiance envers l’État. Sans un consensus national et un engagement international pour un retrait israélien et un renforcement massif de l’armée, le désarmement reste une chimère. Le 2 septembre pourrait soit ouvrir une voie fragile vers la stabilisation, soit précipiter le Liban dans un conflit interne aux répercussions régionales dramatiques.