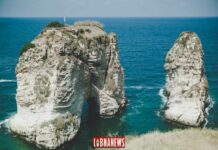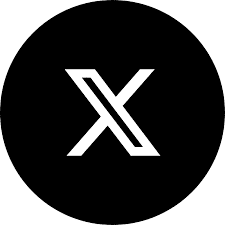La laïcité, souvent mal comprise et confondue avec l’athéisme, est un principe fondamental pour garantir une société juste et équitable. Au Liban, cette confusion est particulièrement marquée, où beaucoup peinent à concevoir qu’on puisse être à la fois laïc et croyant. Cet article vise à clarifier la notion de laïcité, expliquer la séparation des religions et de l’État, et explorer le projet de statut civil ainsi que les défis posés par les accords de Taëf.
1) Qu’est-ce que la laïcité de l’État ?
La laïcité est un principe qui assure la neutralité de l’État par rapport aux affaires religieuses. Elle ne favorise ni ne discrimine aucune religion, protégeant ainsi l’égalité de tous les citoyens, indépendamment de leurs croyances. La laïcité garantit la liberté de conscience et de religion, permettant à chacun de pratiquer sa foi ou de ne pas en avoir.
2) En quoi consiste la séparation des religions et de l’État ?
La séparation des religions et de l’État signifie que les institutions religieuses et gouvernementales fonctionnent indépendamment :
- Législation et Politique : Les lois et politiques publiques sont élaborées sans intervention religieuse.
- Autonomie Institutionnelle : Les institutions religieuses n’ont pas de pouvoir politique ni d’influence sur les décisions de l’État.
- Financement : L’État ne finance ni ne subventionne les activités religieuses. Cette séparation garantit que les affaires publiques sont gérées de manière neutre et rationnelle, sans influence religieuse, assurant ainsi une gouvernance juste pour tous les citoyens.
3) Pourquoi peut-on être religieux et avoir la foi en Dieu dans un État laïc ?
Un État laïc respecte toutes les croyances tout en restant neutre. Les citoyens sont libres de pratiquer leur religion, de participer à des rituels religieux et de vivre selon leurs convictions spirituelles. La laïcité protège cette liberté pour tous, y compris pour ceux qui choisissent de ne pas adhérer à une religion. Ainsi, être profondément religieux et pratiquer sa foi tout en soutenant un État laïc est non seulement possible, mais aussi bénéfique pour l’égalité et la liberté de tous.
4) En quoi consiste le projet de statut civil ?
Le projet de statut civil au Liban vise à établir des lois civiles pour régir les aspects personnels de la vie des citoyens, comme le mariage, le divorce et l’héritage, indépendamment des lois religieuses. Ce projet aspire à créer une société plus unifiée et égalitaire, où les droits individuels sont protégés par des lois civiles uniformes plutôt que par des systèmes juridiques confessionnels distincts. Depuis 1936, ce projet symbolise l’espoir d’une société où les lois civiles prévalent sur les lois religieuses.
Historique de l’échec du statut civil au Liban
L’échec du projet de statut civil au Liban est en grande partie attribuable à l’opposition des autorités religieuses, notamment de l’Église, qui y voient une menace à leur pouvoir et à leur influence. Depuis 1936, chaque tentative de mise en place d’un statut civil a été confrontée à une résistance acharnée des institutions religieuses, soucieuses de préserver leurs prérogatives. Malgré presque un siècle de discussions et de débats, le projet de statut civil reste une aspiration non réalisée pour beaucoup de Libanais.
5) Les accords de Taëf et l’institution du confessionnalisme
Les accords de Taëf, signés en 1989 pour mettre fin à la guerre civile libanaise, ont institutionnalisé le confessionnalisme, attribuant des quotas confessionnels aux différentes communautés religieuses dans les institutions publiques. Cette institutionnalisation a exacerbé les divisions et les inégalités, contredisant l’objectif de concorde et de vivre ensemble. Le confessionnalisme a renforcé les clivages sectaires, souvent au détriment de la mise en place d’un État véritablement laïc et d’un statut civil.
La Laïcité : Un Défi aux États Religieux Environnants
La laïcité de l’État libanais pose un défi considérable aux États religieux environnants, comme Israël en tant qu’État juif, l’Arabie Saoudite en tant qu’État sunnite et l’Iran en tant qu’État chiite. En adoptant une laïcité rigoureuse, le Liban pourrait devenir un modèle de tolérance et de coexistence pacifique dans une région souvent marquée par les conflits religieux. Ce serait une victoire majeure contre l’hérésie des États religieux, affirmant le droit de chaque individu à la liberté de conscience et à l’égalité devant la loi.
Pourquoi la laïcité de l’État libanais est une nécessité ontologique
La nécessité ontologique d’un État laïc signifie qu’il s’agit d’une exigence fondamentale liée à l’essence même de l’existence du Liban en tant qu’État moderne et pluraliste. Ontologique, du grec « ontos » (être) et « logos » (discours), renvoie à l’étude de l’être et de l’existence. Pour le Liban, pays à la mosaïque religieuse complexe, la laïcité est essentielle pour assurer une coexistence pacifique et harmonieuse.
Un État laïc est le seul cadre capable de garantir l’égalité de traitement pour tous les citoyens, sans considération de leur appartenance religieuse. Il permet de transcender les divisions confessionnelles, de promouvoir l’unité nationale et de protéger les droits individuels. Sans laïcité, le Liban risque de rester embourbé dans des conflits sectaires qui minent son développement et sa stabilité.
En conclusion, clarifier la notion de laïcité et la distinguer de l’athéisme est crucial pour avancer vers une société plus juste et égalitaire au Liban. L’adoption d’un statut civil, malgré les défis posés par le confessionnalisme, demeure une étape essentielle pour garantir les droits individuels et promouvoir la coexistence pacifique entre toutes les communautés religieuses du pays. La laïcité pourrait non seulement transformer le Liban mais aussi inspirer une réforme plus large dans la région, favorisant la paix et la tolérance.
Bernard Raymond Jabre